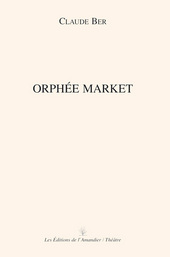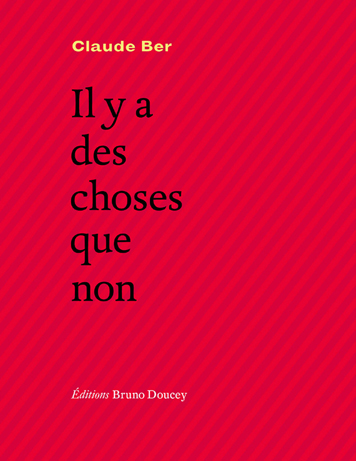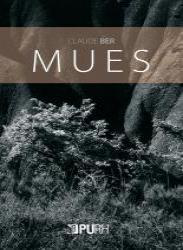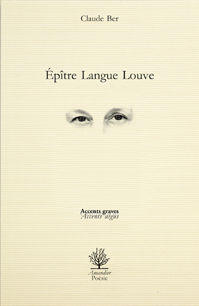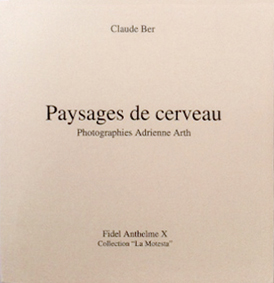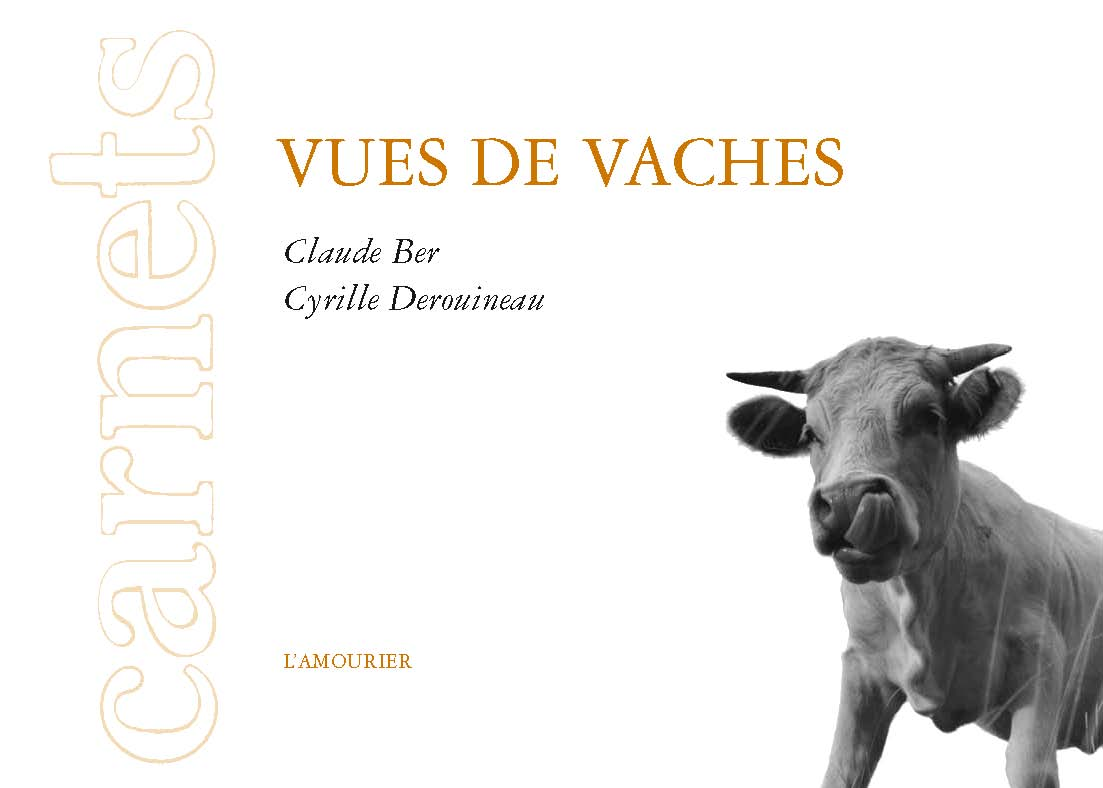BIOBIBLIOGRAPHIE

Françoise Ascal vit et travaille dans un village de Seine et Marne. Elle est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Elle a longtemps animé des ateliers d’art plastique en milieu hospitalier. Elle collabore régulièrement avec des peintres, des vidéastes et des musiciens.
Elle est membre du comité de rédaction de remue.net.
A travers différentes formes ( poèmes, récits, carnets, livres d’artistes) ses textes interrogent la matière autobiographique, croisent l’intime et le collectif dans le souci de se confronter, selon les mots de Pavèse, au “métier de vivre”.
Le Centre National du Livre lui a accordé plusieurs bourses de création (1993, 1999, 2003). En janvier 2010 elle a bénéficié d’une résidence du Conseil Régional d’ Île-de-France au Parc culturel de Rentilly. Elle a été l’invitée de nombreux Festivals en France ( Voix de la Méditerranée, Les Tombées de la nuit , Musique et Mémoire , etc. ) et à l’étranger ( Rencontre Internationale des Écrivains de Montréal , Festival Mondial de Poésie de Caracas au Venezuela ) .
Elle est actuellement en résidence à Aniane dans l’Hérault pour effectuer un travail de mémoire avec le photographe Philippe Bertin ( autour de l’histoire de l’abbaye d’Aniane devenue un temps colonie pénitentiaire pour enfants) .
BIBLIOGRAPHIE ( poèmes, proses, récits)
Le Pré Atelier La Feugraie, 1985
La Part du feu Atelier La Feugraie, 1987
L’ Ombre et l’éclat Atelier La Feugraie, 1990
Fracas d’écume Coédition Atelier La Feugraie/Le Noroît (Québec), 1992
Cendres vives Éditions Paroles d’Aube (réunion en volume de Le Pré, La Part du feu, L’Ombre et l’éclat) 1995
Dans le sillage d’Icare Éditions Cirrus (avec 12 dessins de Jacques-Pierre Amée) 1997
Le Carré du ciel Atelier La Feugraie, 1998
Le Fil de l’oubli Éditions Calligrammes, 1998
L’ Encre du sablier Éditions Double Cloche (Livre d’artiste imprimé en sérigraphie, tiré à quarante exemplaires, avec onze estampes du peintre Yves Picquet) 1999
L’Issue Les Petits Classiques du Grand Pirate (avec une photographie de Gaël Ascal) avril 1999
Le Vent seul Éditions Double Cloche (avec cinq estampes d’Yves Picquet , imprimé en sérigraphie, tiré à trente exemplaires) 1999
Le Sentier des signes Éditions Arfuyen (avec douze calligraphies originales de Ghani Alani) 1999
La Hutte aux écritures Éditions A Travers (livre d’artiste avec le peintre Jacques Clauzel ) 2001
L’Arpentée Éditions Wigwam , mai 2003
Un automne sur la colline Éditions Apogée, septembre 2003
La Table de veille Éditions Apogée, novembre 2004
Mille étangs avec des peintures de Philippe Aubry et une lettre de Denise Desautels, Éditions Travers, mars 2006
Cendres Vives suivi de Le Carré du ciel ( nouvelle édition) ) Éditions Apogée, mars 2006
Issues Éditions Apogée mars 2006
Si seulement Editions Calligrammmes ( avec huit fusains d’Alexandre Hollan) juin 2008
Perdre trace Editions Tipaza ( avec huit peintures d’Alain Boullet) juin 2008
Rouge Rothko éditions Apogée, janvier 2009
Noir-Racine éditions Al Manar, livre d’artiste avec des aquarelles de Marie Alloy, septembre 2009
Langue de sable « livre pauvre » de Daniel Leuwers, manuscrit, six exemplaires, avec des peintures de Jean-Pierre Thomas, septembre 2009
Un désir d’aube édition Atelier de Villemorge, livre d’artiste avec un bois gravé de Jacky Essirard, décembre 2009
Un rêve de verticalité éditions Apogée, septembre 2011 ( autour de Gaston Bachelard avec des contributions de Marie Alloy, Laurent Contamin, Antoine Emaz, Alain Freixe, Abdellatif Laâbi, Werner Lambersy, Béatrice Libert, Jean-Luc Pouliquen, Florence Trocmé ).
A paraître au printemps 2012 :
Lignées, éditions Æncrages & Co, avec des estampes de Gérard Titus-Carmel
Françoise Ascal f.ascal@free.fr
Elle est membre du comité de rédaction de remue.net.
A travers différentes formes ( poèmes, récits, carnets, livres d’artistes) ses textes interrogent la matière autobiographique, croisent l’intime et le collectif dans le souci de se confronter, selon les mots de Pavèse, au “métier de vivre”.
Le Centre National du Livre lui a accordé plusieurs bourses de création (1993, 1999, 2003). En janvier 2010 elle a bénéficié d’une résidence du Conseil Régional d’ Île-de-France au Parc culturel de Rentilly. Elle a été l’invitée de nombreux Festivals en France ( Voix de la Méditerranée, Les Tombées de la nuit , Musique et Mémoire , etc. ) et à l’étranger ( Rencontre Internationale des Écrivains de Montréal , Festival Mondial de Poésie de Caracas au Venezuela ) .
Elle est actuellement en résidence à Aniane dans l’Hérault pour effectuer un travail de mémoire avec le photographe Philippe Bertin ( autour de l’histoire de l’abbaye d’Aniane devenue un temps colonie pénitentiaire pour enfants) .
BIBLIOGRAPHIE ( poèmes, proses, récits)
Le Pré Atelier La Feugraie, 1985
La Part du feu Atelier La Feugraie, 1987
L’ Ombre et l’éclat Atelier La Feugraie, 1990
Fracas d’écume Coédition Atelier La Feugraie/Le Noroît (Québec), 1992
Cendres vives Éditions Paroles d’Aube (réunion en volume de Le Pré, La Part du feu, L’Ombre et l’éclat) 1995
Dans le sillage d’Icare Éditions Cirrus (avec 12 dessins de Jacques-Pierre Amée) 1997
Le Carré du ciel Atelier La Feugraie, 1998
Le Fil de l’oubli Éditions Calligrammes, 1998
L’ Encre du sablier Éditions Double Cloche (Livre d’artiste imprimé en sérigraphie, tiré à quarante exemplaires, avec onze estampes du peintre Yves Picquet) 1999
L’Issue Les Petits Classiques du Grand Pirate (avec une photographie de Gaël Ascal) avril 1999
Le Vent seul Éditions Double Cloche (avec cinq estampes d’Yves Picquet , imprimé en sérigraphie, tiré à trente exemplaires) 1999
Le Sentier des signes Éditions Arfuyen (avec douze calligraphies originales de Ghani Alani) 1999
La Hutte aux écritures Éditions A Travers (livre d’artiste avec le peintre Jacques Clauzel ) 2001
L’Arpentée Éditions Wigwam , mai 2003
Un automne sur la colline Éditions Apogée, septembre 2003
La Table de veille Éditions Apogée, novembre 2004
Mille étangs avec des peintures de Philippe Aubry et une lettre de Denise Desautels, Éditions Travers, mars 2006
Cendres Vives suivi de Le Carré du ciel ( nouvelle édition) ) Éditions Apogée, mars 2006
Issues Éditions Apogée mars 2006
Si seulement Editions Calligrammmes ( avec huit fusains d’Alexandre Hollan) juin 2008
Perdre trace Editions Tipaza ( avec huit peintures d’Alain Boullet) juin 2008
Rouge Rothko éditions Apogée, janvier 2009
Noir-Racine éditions Al Manar, livre d’artiste avec des aquarelles de Marie Alloy, septembre 2009
Langue de sable « livre pauvre » de Daniel Leuwers, manuscrit, six exemplaires, avec des peintures de Jean-Pierre Thomas, septembre 2009
Un désir d’aube édition Atelier de Villemorge, livre d’artiste avec un bois gravé de Jacky Essirard, décembre 2009
Un rêve de verticalité éditions Apogée, septembre 2011 ( autour de Gaston Bachelard avec des contributions de Marie Alloy, Laurent Contamin, Antoine Emaz, Alain Freixe, Abdellatif Laâbi, Werner Lambersy, Béatrice Libert, Jean-Luc Pouliquen, Florence Trocmé ).
A paraître au printemps 2012 :
Lignées, éditions Æncrages & Co, avec des estampes de Gérard Titus-Carmel
Françoise Ascal f.ascal@free.fr
EXTRAITS DE TEXTES
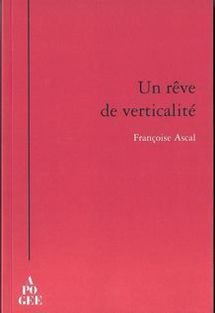
UN RÊVE DE VERTICALITÉ
éditions Apogée 2011
Journal de Rentilly
Autour de Gaston Bachelard
(Extraits)
Rentilly, hiver 2010
Quelques flocons.
Le silence.
Sensation de profondeur, de calme.
Espace qu’il va falloir apprivoiser.
Temps suspendu, derrière les grandes fenêtres, temps de blancheur dans lequel je dois me glisser.
En douceur.
Ou peut-être en violence.
Je ne sais pas encore.
*
Il y a dix ans exactement, à la même heure, je roulais dans une autre blancheur, dans l’effroi des arbres mutilés, foudroyés, abattus. La tempête venait de sévir. Je traversais le chaos des petites routes de Seine et Marne pour rejoindre et caresser le visage de ma mère, une dernière fois. Ce 6 janvier, la paix venait de tomber sur son corps de vieille dame usée.
Dix ans plus tard, j’entre dans une forêt cicatrisée.
J’ai devant moi le temps d’une gestation pour faire naître un livre.
Que Bachelard m’emporte sans nostalgie vers l’ailleurs, vers le vif-argent du vivant, cet imprévisible que j’espère.
*
En cette période , le parc n’est pas ouvert au public. Aucun bruit ne trouble ma solitude. L’atelier pourrait être une salle monastique.
Retraite volontaire dont je n’attends pas un retirement , mais une ouverture. Occasion d’aiguiser l’écoute, le regard, à la faveur de cette eau calme.
Désir de transparence : voir/entendre, le fond comme la surface, ensemble.
*
Ce sera donc une expérience, un séjour dégagé de la glu du quotidien qui poisse les mains, qu’on le veuille ou non, qu’on sache ou non que rien ne se passe loin de lui/ hors de lui.
*
J’irai à la rencontre des arbres.
Les saluer .
Les toucher de la paume.
Le ciel est bas, d’un gris tendre.
A moi de rejoindre le feu .
A moi d’habiter en poète ce fragment d’espace.
*
Le poids du lieu. Impossible de l’ignorer. Comme si la terre n’avait pas le même âge partout, la même gravité. La cour rectangulaire, les pavés, le kiosque, les écuries, le graphisme noir et dur des branches derrière les vitres pèsent plusieurs siècles. Nous autres, humains de passage, empruntons quelques éclats à la durée, histoire d’avoir moins peur.
Pourtant la mort bat, ici aussi. Travaille sous l’écorce.
Mais plus discrètement qu’ailleurs.
*
Profondeur du silence.
Les mots en paraissent plus proches. A fleur de terre. Rien ne vient s’interposer entre le regard et le mot qui a envie de naître. Ici, je peux entendre le besoin des mots d’apparaître. Même sous la neige.
Qui a besoin de nous ? de moi ?
Comment savoir dans le tumulte ordinaire ?
Se peut-il qu’une phrase réclame attention, ici, dans ce silence habité ? une phrase pas plus importante qu’une pousse de pissenlit ? une phrase qui n’ajoutera rien, n’aura rien à offrir de nouveau sous le soleil.
Non, je n’entends pas des voix , je ne me crois pas investie d’une mission !
Il est juste question d’une infime vibration sur la peau.
Un « vent d’aigrette » peut-être, celui qu’André Breton sentait sur ses tempes lorsque la poésie l’émouvait ? Ce serait trop dire. La phrase dont je parle est nue, inutile, perdue d’avance autant qu’obstinée à vivre.
*
Ecrire : un entreprise d’ arrachement à la partie lourde de l’être.
Ecrire pour respirer. Parce que la vie coupe le souffle.
*
Son nom fait lever une constellation d’images dont certaines se sont enfouies dans ma chair, comme des graines.
Il me faut aujourd’hui visiter ce jardin. Accueillir les herbes folles, honorer les persistantes, les toujours-vivaces-en-dépit-de qui m’ont aidée à grandir.
Gaston Bachelard. Air terre eau feu. Autant dire le monde, sa pulpe, son ciel et ses étoiles. Autant dire la substance humaine. Hydrogène, oxygène, azote, carbone, nous partageons la matière du monde. Le calcium de nos os est le même que celui des planètes les plus lointaines.
A mesure que nos doigts courent sur le clavier, que le virtuel se déploie, vertigineux, il se peut que nous devenions amnésiques.
Bientôt nous ne pourrons plus contempler la grande fresque de Gauguin intitulée D’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ?
Nous aurons oublié sa langue.
Prendre peur serait raisonnable.
*
Solitude heureuse.
Ma colonne vertébrale cherche la verticalité.
Ce sont les lignes avoisinantes qui agissent.
Dans la cour rectangulaire, les troncs des tilleuls se dressent, puissants, sereins. Les fréquenter permet d’entrer dans un mode de perception fine.
Ici, écouter, c’est voir. Et voir, c’est revoir. Revoir le jour après la nuit. Ouvrir les pores de sa propre peau, comme autant de minuscules fenêtres élargissant la prison.
Prison du corps et de l’âme inquiète.
Prison obscure où s’ébattent nos peurs, où survivent d’archaïques démons.
La beauté, lorsqu’elle surgit , fissure nos édifices, qu’ils soient de craintes ou de certitudes. Depuis Rimbaud qui l’a trouvée amère, les artistes préfèrent en ricaner. Le temps n’est plus à la célébration.
Mais faut-il renoncer à entretenir l’étincelle ?
L’écriture ne pourrait-elle donner à la beauté ses chances d’éclosion, non pas la chercher, non pas la servir, mais lui permettre de naître ?
Si le monde est en sang, en chaos, en violence toujours renouvelée, si le sens bégaye, faut-il à notre tour bégayer ? Dresser un miroir sur nos seuls faillites ? Abandonner à eux-mêmes les éclats de lumière, fragiles comme nos abeilles en voie de disparition?
*
Suis-je toujours vivante ?
Est-ce que j’appartiens encore à la communauté qui aujourd’hui agit , croît, espère, se projette ?
Tenter de comprendre ce monde nouveau qui apparaît, l’explorer sans a priori. Lui poser des questions. Mêmes naïves, mêmes chargées d’une émotion d’un autre âge.
C’est du statut de ma peau dont il est question.
Peau et expériences. Peau et émotions. Peau et mémoire.
Mon corps d’encore vivante, esprit jardin chair enfance battements de cœurs nuages, indémêlables.
Comment ne s’affolerait-il pas ?
N’est-il pas menacé ?
Condamnée à trancher dans ses radicelles ?
A bétonner ses obscurités si peu fonctionnelles ?
A entrer dans le moule tendu ?
Mon « Je » d’aujourd’hui n’est pas rentable.
Comme ces friches en lisière de villes qu’il faut éradiquer.
*
ROUGE ROTHKO
édition Apogée 2009
(extrait )
WOLS AU CAMP DES MILLES
Aquarelle ( détail)
Ce n’est qu’un moment banal de l’Histoire, entre Aix-en-Provence et Marseille, dans un village français ordinaire.
Des sans- papiers, déjà.
Rejetés par Berlin, réfugiés à Paris avant que la déclaration de guerre ne les transforme en indésirables.
Parmi eux Ernst, Bellmer, Liebknecht, Springer , Wols …
Au cours des années 1939 et 1940, ils sont parqués pour un temps variable dans une tuilerie réquisitionnée par les autorités. Tous attendent une décision administrative, un coup de tampon en forme de coup de dés, un verdict de la « commission permanente de criblage ».
Il y a peu, en Allemagne, les œuvres de ces dégénérés ont été brûlées publiquement sur ordre du Führer. Aujourd’hui, en France, ils continuent à dessiner, à peindre sur ce qu’ils trouvent, du mauvais papier, des bouts de presque rien. Ou sur les murs du réfectoire, lorsque les gardiens sont accommodants..
Courte trêve.
La guerre se durcit. Tous luttent contre la bêtise, la faim, le désespoir. Certains se suicident. D’autres parviennent à s’enfuir. D’autres encore gagnent un statut de « prestataires » qui les libèrent. Ils ne savent pas qu’un jour les musées se glorifieront de leurs moindres miettes.
Lui, regarde les puces. Les puces, il connaît. Elles sont partout dans le camp. Elles se glissent sous la chemise, dans la paillasse, envahissent sol et murs, saturent jusqu’à l’invisible. Avec une précision d’entomologiste, il dessine les pattes velues, l’œil rond, la trompe vorace.
Il s’absorbe, pénètre à l’intérieur, passe outre le brun châtaigne.
Il a toujours su franchir les murs, les coques, les peaux. Ici aussi , dans le camp des Milles, il voyage.
« Centre de rassemblement ». Ainsi s’appelle la tuilerie-briquetterie des Milles.
Lorsque la première vague de détenus en sortira, l’usine changera encore de nom, jalonnant ainsi l’avancée du pire. En moins de deux ans, de 1940 à 1942, à mesure que se précisent les lois anti-juives, elle deviendra « camp d’internement », puis « camp de transit », puis « camp de déportation ».
On saura plus tard ce qu’il en fut de certaines journées de l’été 1942, au cours desquelles « gardes et policiers eux-mêmes dominent mal leur émotion » dit un rapport officiel en date du 24 août.
Par chance, celui qui regardait les puces a pu quitter le camp en octobre 1940. Sauvé par son mariage avec une française. Durant les deux années suivantes, le couple s’use à attendre un hypothétique visa. Aquarelles, dessins, notes s’accumulent.
Mais se peut-il que l’air du temps obstrue jusqu’aux pores de la peau ?
Plumes et pinceaux poussent des barges de cauchemars. Vers l’intérieur. Vers le fin fond. La vision bute, non sur des murs, mais sur du mou. La vision tourne en boucle , suffoque et s’enfonce dans l’infiniment petit, l’infiniment instable. Réseau des nerfs, des veines, des cellules en perpétuelle alerte. Matières de l’ insaisissable, ensanglantées.
Près d’ Auschwitz, l’étang n’est plus qu’une mare. Asphyxiée par un excès de « dépôts ». Le fond a presque rejoint la surface. Les tombereaux de cendres humaines jetés chaque jour dans ses eaux l’ont comblée.
Sans répit, le peintre creuse et fore dans d’intimes souterrains.
Les siens ?
Les nôtres ?
A son insu peut-être, il entretient pour nous « la flamme sacrée de l’inquiétude » .
*
édition Apogée 2009
(extrait )
WOLS AU CAMP DES MILLES
Aquarelle ( détail)
Ce n’est qu’un moment banal de l’Histoire, entre Aix-en-Provence et Marseille, dans un village français ordinaire.
Des sans- papiers, déjà.
Rejetés par Berlin, réfugiés à Paris avant que la déclaration de guerre ne les transforme en indésirables.
Parmi eux Ernst, Bellmer, Liebknecht, Springer , Wols …
Au cours des années 1939 et 1940, ils sont parqués pour un temps variable dans une tuilerie réquisitionnée par les autorités. Tous attendent une décision administrative, un coup de tampon en forme de coup de dés, un verdict de la « commission permanente de criblage ».
Il y a peu, en Allemagne, les œuvres de ces dégénérés ont été brûlées publiquement sur ordre du Führer. Aujourd’hui, en France, ils continuent à dessiner, à peindre sur ce qu’ils trouvent, du mauvais papier, des bouts de presque rien. Ou sur les murs du réfectoire, lorsque les gardiens sont accommodants..
Courte trêve.
La guerre se durcit. Tous luttent contre la bêtise, la faim, le désespoir. Certains se suicident. D’autres parviennent à s’enfuir. D’autres encore gagnent un statut de « prestataires » qui les libèrent. Ils ne savent pas qu’un jour les musées se glorifieront de leurs moindres miettes.
Lui, regarde les puces. Les puces, il connaît. Elles sont partout dans le camp. Elles se glissent sous la chemise, dans la paillasse, envahissent sol et murs, saturent jusqu’à l’invisible. Avec une précision d’entomologiste, il dessine les pattes velues, l’œil rond, la trompe vorace.
Il s’absorbe, pénètre à l’intérieur, passe outre le brun châtaigne.
Il a toujours su franchir les murs, les coques, les peaux. Ici aussi , dans le camp des Milles, il voyage.
« Centre de rassemblement ». Ainsi s’appelle la tuilerie-briquetterie des Milles.
Lorsque la première vague de détenus en sortira, l’usine changera encore de nom, jalonnant ainsi l’avancée du pire. En moins de deux ans, de 1940 à 1942, à mesure que se précisent les lois anti-juives, elle deviendra « camp d’internement », puis « camp de transit », puis « camp de déportation ».
On saura plus tard ce qu’il en fut de certaines journées de l’été 1942, au cours desquelles « gardes et policiers eux-mêmes dominent mal leur émotion » dit un rapport officiel en date du 24 août.
Par chance, celui qui regardait les puces a pu quitter le camp en octobre 1940. Sauvé par son mariage avec une française. Durant les deux années suivantes, le couple s’use à attendre un hypothétique visa. Aquarelles, dessins, notes s’accumulent.
Mais se peut-il que l’air du temps obstrue jusqu’aux pores de la peau ?
Plumes et pinceaux poussent des barges de cauchemars. Vers l’intérieur. Vers le fin fond. La vision bute, non sur des murs, mais sur du mou. La vision tourne en boucle , suffoque et s’enfonce dans l’infiniment petit, l’infiniment instable. Réseau des nerfs, des veines, des cellules en perpétuelle alerte. Matières de l’ insaisissable, ensanglantées.
Près d’ Auschwitz, l’étang n’est plus qu’une mare. Asphyxiée par un excès de « dépôts ». Le fond a presque rejoint la surface. Les tombereaux de cendres humaines jetés chaque jour dans ses eaux l’ont comblée.
Sans répit, le peintre creuse et fore dans d’intimes souterrains.
Les siens ?
Les nôtres ?
A son insu peut-être, il entretient pour nous « la flamme sacrée de l’inquiétude » .
*
ISSUES
éditions Apogée, 2006
(extrait )
L’Arpentée
Et dire qu’il faudra quitter ce berceau de lumière...
ce suspens ...
ce maintenant de toujours,
retrouvé chaque soir à l’heure où le soleil penche, là-bas vers l’ouest, répandant en ondes généreuses ses dernières vagues sur le noyer amical, ouvert, paisiblement ouvert à l’est du jardin, tandis que les vrilles de la glycine se courbent un peu plus, comme pour boire la fraîcheur qui monte de la terre.
“Doux royaume de la terre” ...disais-tu, à l’instant de disparaître.
Doux royaume tracé par l’aile du martinet haut dans le ciel, bordé par un chant de merle ivre de juin.
Doux royaume lacéré par le meurtre.
Doux royaume éclaboussé de sang à l’instant même où le nectar qui descend dans ma gorge calme la plaie toujours ouverte de la lucidité, la plaie de la conscience, de l’impossible oubli, la plaie du monde égorgé depuis le premier jour, le premier fils, depuis la multiplication débridée des Caïn dissimulés en chaque homme, derrière d’invisibles frondes abattant sans répit les martinets du ciel, rompant sans répit les limites des jardins clos, décimant sans répit les doux royaumes de la terre avant même l’heure de l’adieu.
1
Au loin la rivière roule d’obscures promesses.
Le sapin tutélaire veille,
ancêtre tenace gardant sous son aile les âmes innombrables des lapins d’autrefois, bouquet d’âmes innocentes ayant connu l’effroi sous la lame agile en ce lieu précis, misérables créatures liées aux misérables paysans, les unes et les autres aujourd’hui confondues dans l’absence, dans la radiation de tout ce ce qui fut, une fois, une unique fois présence, atomes de chair pareillement broyés sous la meule qui jamais ne crisse, jamais ne grince, terreau de misère faisant croître le sapin haut et ferme, à l’ombre duquel j’écris ce jour, traversée d’une calme joie — légère puisque sans fondement, sans raisons, sans réponses. Sans consolation.
Là -haut, le vent souffle.
Là-haut, un busard trace de grands cercles dans le bleu du ciel avant de rejoindre son poste de guet , au sommet d’un frêne.
Sous la terre et le grès rose, sous les étangs , les bouleaux, les bruyères, les anciens n’en finissent pas de se décomposer.
Le vent tourmente la peau des vivants,
attise les signes.
Au vif de l’été la plante du pied s’impatiente.
2
Il faut choisir.
Arpenter le pays des étangs ou la page.
Écrire exige une privation.
Il faut se tenir à la table, sédentaire enracinée, indifférente aux appels archaïques. Et même ne pas trop lever le nez face au vent qui courbe les herbes jusqu’à la lisière qu’on sait très fraîche avec son ruisseau dissimulé.
Oui, accepter de se river à l’ ici miniature, l’ ici fait de trois planches de bois mal assemblées, vieille table qui branle à chaque syllabe, mais assigne une place à ce qui naît dans le mouvement de la main.
Main aveugle. Ne sachant ce qui la conduit ni où mène ce petit jeu irrépressible.
Main appartenant à celle qui aurait aimé marcher en direction des étangs, qui était venue dans ce pays pour “ça”, et qui croyant avoir choisi n’ a fait que se soumettre.
Non seulement main-aveugle, mais pire: Vouloir-aveugle. Vouloir envahissant logé sous la langue peut-être, ou dans la gorge, ou bien encore lové comme un serpent à l’endroit précis du plexus, anneaux repliés sous la chaleur de juillet, si bien que le corps tout entier de celle qui écrit n’est qu’un repaire de forces étrangères à elle-même.
L’arpentée, c’est elle. Non les étangs du désir, non la page noircie en vain, toujours en vain.
L’arpentée est sans repos, sans possession.
Seule la table de trois planches mal équarries semble lui appartenir.
3
“Travail de deuil”...
Ne veux pas le faire, ce boulot. Veux laisser les plaies ouvertes, veux être traversée par d’éternelles douleurs intimes. Veux les nourrir, leur donner la becquée pour que jamais jamais ne meurent les visages aimés. Un jamais de pacotille, on le sait, à la mesure du dérisoire, un jamais naïf de fillette, une promesse d’ivrogne, une volonté d’irréalité, une crispation d’utopie, une insoumission . Non. Pas de travail de deuil. Pas d’accommodement. Pas de douceur. Pas de résignation. Pas de sagesse. Mais le mal nourricier, la blessure fertile, la blessure-rivière-vive travaillant au secret du corps, irriguant la chair, jaillissant en rébellion, en étincelles de tristesses lumineuses. Contre l’oubli.
Et pourtant.
“ Mémoire qui tue...
mémoire qui étouffe à petit feu..”. Excès de déchets organiques, pourriture lente formant vase au fond du cœur. Et l’on suffoque, et l’on s’égare à vouloir trouver le chemin inédit, le sans-trace, le non-balisé par les ancêtres, par la forge du temps, par la puissance de l’Histoire ou la pression des événements, même futiles, même anodins, même attendus. Sortir. Out. Sortir. Out. EXIT. SORTIR. ANY WHERE OUT THE WORLD. Trouver la passe, trouver l’issue, trouver la fente la faille la fêlure la fenêtre la face ou la farce, mais sortir. Sortir du pré du pré vu du pré paré du pré cité du pré posé du pré dit , quitter les pré dispositions, abandonner tout centre de gravité, rejoindre le nu d’un intervalle, la vacuité d’un interstice, percer la poche du circonscrit.
4
L’orage menace.
La chaleur s’alourdit.
Ombres oranges sur la prairie.
Une fissure.
Un trou d’épingle.
Celui qu’il fallait pour gober l’œuf?
Celui qu’il faudrait pour rejoindre le germe —à rebours— caché au centre de la coquille close?
Écriture plombée.... noirceur...
Fichée en terre, côté décomposition. En échec de lumière, en échec d’ailes, en panne de plénitude.
Voudrais écumer. Voudrais des naseaux de bêtes féroces, des muscles de taureaux rageurs. Voudrais faire exploser les liens les laisses les ceintures les colliers les bracelets les bagues, voudrais jaillir nue, désentravée, n’être qu’énergie vitale, pure force solaire, loin du beuglement grégaire, loin de la mastication des vaches bouffeuses de colchiques, loin de leurs sabots stagnant dans l’argile molle des champs défoncés, l’argile trompeuse, l’argile informe prometteuse de formes jamais tenues.
5
Au bord de quelque chose, toujours.
Dans l’insécurité native.
Au bord d’une compréhension. Ou d’une décision définitive.
Au bord d’une imminence.
Un franchissement de col, à partir duquel tout pourrait s’inverser, la vision s’agrandir, le souffle s’apaiser.
Ne plus avoir à haleter pour atteindre le sommet, jouir du paysage en amorçant la descente, laisser aller un pied après l’autre sur le sentier accueillant, celui qu’on sait rejoindre le havre, là-bas au creux de la vallée, ardemment pressenti depuis l’autre versant.
Mais le col n’est jamais là où l’on croit.
Est-ce le col de la Mort, miroir du tout premier franchi, écho du col dilaté des mères,
nous expulsant hors de l’ombre chaude?
Légèreté, légèreté, je t’appelle,
Je te donne en secret un nom d’oiseau,
Je te nourrirai dans ma paume avec le meilleur de moi-même,
J’abandonnerai mes lourds vêtements,
je te laisserai rompre du bec les attaches usées mais tenaces,
les dépouilles mortes qui encombrent le champ du ciel
J’aurai pour toi le bleu soyeux des étangs du désir
J’attiserai le feu qui consume,
Je brûlerai les oripeaux pendus à mon cœur,
viandes flasques pourvoyeuses de pourriture
sang sale virant au noir
attirant mouches et vers voraces
Légèreté légèreté,
Je chanterai pour toi un air soufi jamais entendu
J’inventerai dans ma gorge une coulée de miel né des roseaux
un souffle sûr
porteur de messages clairs
un souffle vaste autant que ferme
sur lequel nous embarquerons
et tu m’enseigneras l’art et le savoir-ailé
le pur-ici sans poids
la transparence cachée sous tes paupières
au centre de ton iris
de mésange de rouge-gorge de libellule de grenouille de lézard couleuvre vairon cétoine abeille grillon vanesse chat lapin chien folâtre
de ton iris de nouveau-né
un instant surpris
dans l’enchantement dérobé
du monde
éditions Apogée, 2006
(extrait )
L’Arpentée
Et dire qu’il faudra quitter ce berceau de lumière...
ce suspens ...
ce maintenant de toujours,
retrouvé chaque soir à l’heure où le soleil penche, là-bas vers l’ouest, répandant en ondes généreuses ses dernières vagues sur le noyer amical, ouvert, paisiblement ouvert à l’est du jardin, tandis que les vrilles de la glycine se courbent un peu plus, comme pour boire la fraîcheur qui monte de la terre.
“Doux royaume de la terre” ...disais-tu, à l’instant de disparaître.
Doux royaume tracé par l’aile du martinet haut dans le ciel, bordé par un chant de merle ivre de juin.
Doux royaume lacéré par le meurtre.
Doux royaume éclaboussé de sang à l’instant même où le nectar qui descend dans ma gorge calme la plaie toujours ouverte de la lucidité, la plaie de la conscience, de l’impossible oubli, la plaie du monde égorgé depuis le premier jour, le premier fils, depuis la multiplication débridée des Caïn dissimulés en chaque homme, derrière d’invisibles frondes abattant sans répit les martinets du ciel, rompant sans répit les limites des jardins clos, décimant sans répit les doux royaumes de la terre avant même l’heure de l’adieu.
1
Au loin la rivière roule d’obscures promesses.
Le sapin tutélaire veille,
ancêtre tenace gardant sous son aile les âmes innombrables des lapins d’autrefois, bouquet d’âmes innocentes ayant connu l’effroi sous la lame agile en ce lieu précis, misérables créatures liées aux misérables paysans, les unes et les autres aujourd’hui confondues dans l’absence, dans la radiation de tout ce ce qui fut, une fois, une unique fois présence, atomes de chair pareillement broyés sous la meule qui jamais ne crisse, jamais ne grince, terreau de misère faisant croître le sapin haut et ferme, à l’ombre duquel j’écris ce jour, traversée d’une calme joie — légère puisque sans fondement, sans raisons, sans réponses. Sans consolation.
Là -haut, le vent souffle.
Là-haut, un busard trace de grands cercles dans le bleu du ciel avant de rejoindre son poste de guet , au sommet d’un frêne.
Sous la terre et le grès rose, sous les étangs , les bouleaux, les bruyères, les anciens n’en finissent pas de se décomposer.
Le vent tourmente la peau des vivants,
attise les signes.
Au vif de l’été la plante du pied s’impatiente.
2
Il faut choisir.
Arpenter le pays des étangs ou la page.
Écrire exige une privation.
Il faut se tenir à la table, sédentaire enracinée, indifférente aux appels archaïques. Et même ne pas trop lever le nez face au vent qui courbe les herbes jusqu’à la lisière qu’on sait très fraîche avec son ruisseau dissimulé.
Oui, accepter de se river à l’ ici miniature, l’ ici fait de trois planches de bois mal assemblées, vieille table qui branle à chaque syllabe, mais assigne une place à ce qui naît dans le mouvement de la main.
Main aveugle. Ne sachant ce qui la conduit ni où mène ce petit jeu irrépressible.
Main appartenant à celle qui aurait aimé marcher en direction des étangs, qui était venue dans ce pays pour “ça”, et qui croyant avoir choisi n’ a fait que se soumettre.
Non seulement main-aveugle, mais pire: Vouloir-aveugle. Vouloir envahissant logé sous la langue peut-être, ou dans la gorge, ou bien encore lové comme un serpent à l’endroit précis du plexus, anneaux repliés sous la chaleur de juillet, si bien que le corps tout entier de celle qui écrit n’est qu’un repaire de forces étrangères à elle-même.
L’arpentée, c’est elle. Non les étangs du désir, non la page noircie en vain, toujours en vain.
L’arpentée est sans repos, sans possession.
Seule la table de trois planches mal équarries semble lui appartenir.
3
“Travail de deuil”...
Ne veux pas le faire, ce boulot. Veux laisser les plaies ouvertes, veux être traversée par d’éternelles douleurs intimes. Veux les nourrir, leur donner la becquée pour que jamais jamais ne meurent les visages aimés. Un jamais de pacotille, on le sait, à la mesure du dérisoire, un jamais naïf de fillette, une promesse d’ivrogne, une volonté d’irréalité, une crispation d’utopie, une insoumission . Non. Pas de travail de deuil. Pas d’accommodement. Pas de douceur. Pas de résignation. Pas de sagesse. Mais le mal nourricier, la blessure fertile, la blessure-rivière-vive travaillant au secret du corps, irriguant la chair, jaillissant en rébellion, en étincelles de tristesses lumineuses. Contre l’oubli.
Et pourtant.
“ Mémoire qui tue...
mémoire qui étouffe à petit feu..”. Excès de déchets organiques, pourriture lente formant vase au fond du cœur. Et l’on suffoque, et l’on s’égare à vouloir trouver le chemin inédit, le sans-trace, le non-balisé par les ancêtres, par la forge du temps, par la puissance de l’Histoire ou la pression des événements, même futiles, même anodins, même attendus. Sortir. Out. Sortir. Out. EXIT. SORTIR. ANY WHERE OUT THE WORLD. Trouver la passe, trouver l’issue, trouver la fente la faille la fêlure la fenêtre la face ou la farce, mais sortir. Sortir du pré du pré vu du pré paré du pré cité du pré posé du pré dit , quitter les pré dispositions, abandonner tout centre de gravité, rejoindre le nu d’un intervalle, la vacuité d’un interstice, percer la poche du circonscrit.
4
L’orage menace.
La chaleur s’alourdit.
Ombres oranges sur la prairie.
Une fissure.
Un trou d’épingle.
Celui qu’il fallait pour gober l’œuf?
Celui qu’il faudrait pour rejoindre le germe —à rebours— caché au centre de la coquille close?
Écriture plombée.... noirceur...
Fichée en terre, côté décomposition. En échec de lumière, en échec d’ailes, en panne de plénitude.
Voudrais écumer. Voudrais des naseaux de bêtes féroces, des muscles de taureaux rageurs. Voudrais faire exploser les liens les laisses les ceintures les colliers les bracelets les bagues, voudrais jaillir nue, désentravée, n’être qu’énergie vitale, pure force solaire, loin du beuglement grégaire, loin de la mastication des vaches bouffeuses de colchiques, loin de leurs sabots stagnant dans l’argile molle des champs défoncés, l’argile trompeuse, l’argile informe prometteuse de formes jamais tenues.
5
Au bord de quelque chose, toujours.
Dans l’insécurité native.
Au bord d’une compréhension. Ou d’une décision définitive.
Au bord d’une imminence.
Un franchissement de col, à partir duquel tout pourrait s’inverser, la vision s’agrandir, le souffle s’apaiser.
Ne plus avoir à haleter pour atteindre le sommet, jouir du paysage en amorçant la descente, laisser aller un pied après l’autre sur le sentier accueillant, celui qu’on sait rejoindre le havre, là-bas au creux de la vallée, ardemment pressenti depuis l’autre versant.
Mais le col n’est jamais là où l’on croit.
Est-ce le col de la Mort, miroir du tout premier franchi, écho du col dilaté des mères,
nous expulsant hors de l’ombre chaude?
Légèreté, légèreté, je t’appelle,
Je te donne en secret un nom d’oiseau,
Je te nourrirai dans ma paume avec le meilleur de moi-même,
J’abandonnerai mes lourds vêtements,
je te laisserai rompre du bec les attaches usées mais tenaces,
les dépouilles mortes qui encombrent le champ du ciel
J’aurai pour toi le bleu soyeux des étangs du désir
J’attiserai le feu qui consume,
Je brûlerai les oripeaux pendus à mon cœur,
viandes flasques pourvoyeuses de pourriture
sang sale virant au noir
attirant mouches et vers voraces
Légèreté légèreté,
Je chanterai pour toi un air soufi jamais entendu
J’inventerai dans ma gorge une coulée de miel né des roseaux
un souffle sûr
porteur de messages clairs
un souffle vaste autant que ferme
sur lequel nous embarquerons
et tu m’enseigneras l’art et le savoir-ailé
le pur-ici sans poids
la transparence cachée sous tes paupières
au centre de ton iris
de mésange de rouge-gorge de libellule de grenouille de lézard couleuvre vairon cétoine abeille grillon vanesse chat lapin chien folâtre
de ton iris de nouveau-né
un instant surpris
dans l’enchantement dérobé
du monde