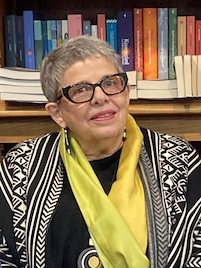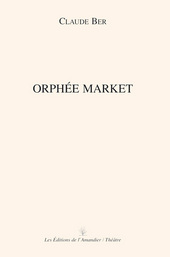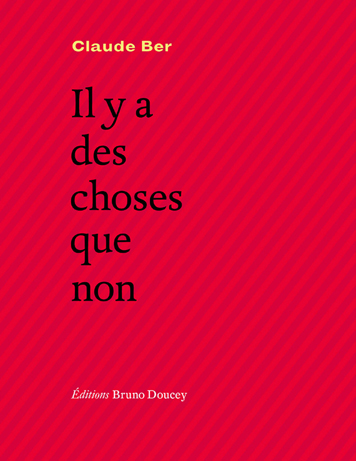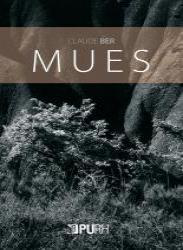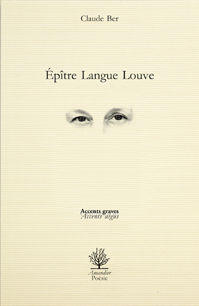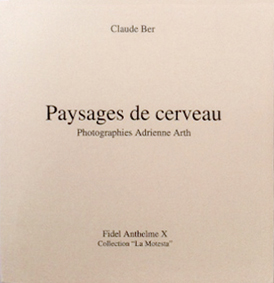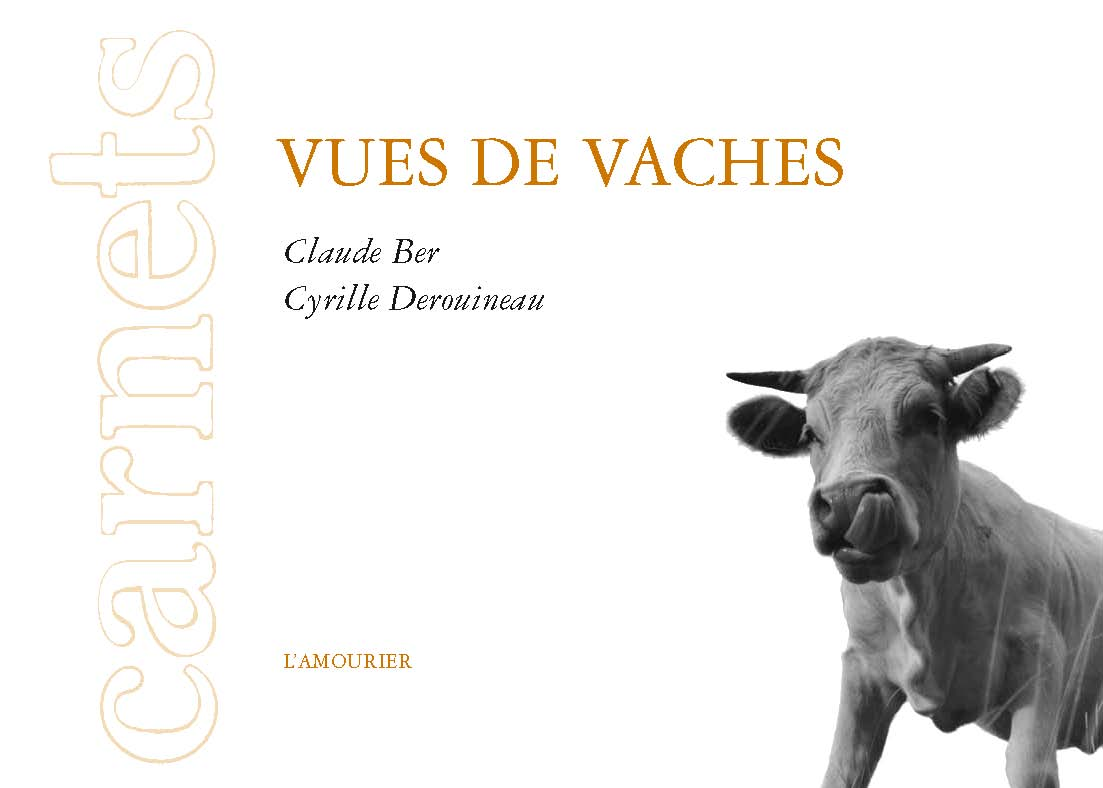CÉLÉBRATION DE L'ESPÈCE
Comme tous ceux de mon espèce, je voudrais célébrer mon espèce. Car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce.
Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les séparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l’extase, la souffrance, la folie, l’horreur, les crimes de mon espèce. Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce.
Ainsi est mon espèce qu’elle célèbre le n’importe quoi de son espèce qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce.
Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce.
Mon espèce s’extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l’avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres, de ses dieux, de son or, de ses croyances comme de ses incroyances.
Tout rentre tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de son espèce. Mon espèce étripe mon espèce au nom de l’amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l’espèce.
Mon espèce ravage mon espèce au nom de l’humanité comme de l’inhumanité de mon espèce. Mon espèce pollue ce qu’elle invente de plus sacré dans le fumier de mon espèce.
Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce. Mon espèce entasse les bêtes qu’elle mange dans des hangars où elles pourrissent vivantes et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce. Mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce. Mon espèce pend, fusille, bombarde, gaze, démembre, écorche, poignarde les hommes, les femmes et les enfants de son espèce.
Ainsi est mon espèce plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce.
Même les porcs ont plus de parcelle divine dans leur couenne que mon espèce. Même les porcs ont plus de chances de gagner l’éternité que mon espèce qui martyrise toute espèce y compris sa propre espèce.
Comment peut-on célébrer une espèce aussi nuisible que mon espèce ? Une espèce oublieuse et avide qui se soumet aux pires de l’espèce et anéantit les meilleurs de son espèce pour ensuite les célébrer.
Car mon espèce se rachète et achète son humanité en célébrant les victimes de mon espèce et les tessons de lumières qui éclairent la nuit de mon espèce servent de pardon à la cruauté de mon espèce.
Il faut être une espèce décervelée comme l’est mon espèce pour croire qu’un dieu tout puissant puisse absoudre ses crimes contre son espèce. Il faut être déboussolé comme l’est mon espèce pour imaginer qu’un quelconque infini puisse ressembler à ce qu’en invente à son image la sauvagerie de mon espèce.
Car mon espèce se sert de ses dieux pour mettre à mort les membres de son espèce. Mon espèce peut louer le créateur de toute espèce puis au sortir de ses prières crucifier, lapider, égorger en son nom d’autres membres de mon espèce.
Comment croire aux dieux de mon espèce qui sont des dieux déféqués par la cervelle détraquée de mon espèce ?
La fente d’infini qui traverse le nom de dieu dans mon espèce est ramenée à la mesure de la porcherie de mon espèce. Et aucun dieu ne peut ressusciter l’âme de mon espèce assassinée par mon espèce.
Ainsi est mon espèce qu’elle fait endosser à ses dieux la porcherie de mon espèce.
Qui sauvera mon espèce de mon espèce ? Une espèce qui se gorge de meurtres est une espèce condamnée à la non-éternité de son espèce.
L’âme de mon espèce fond comme glaçon entre les mains sanglantes de mon espèce emportée par sa peur et sa passion de la mort. Car mon espèce passe le plus clair de sa vie à amonceler richesses et prières contre la mort et à se soustraire à la vie pour se donner à la mort. Mon espèce dépense des trésors d’intelligence à se persuader que la mort est la vie et que la vie est la mort. Mon espèce a honte du désir et de la vie auxquels elle préfère la putréfaction de la mort. Mon espèce préfère s’insulter par les organes et les actes du plaisir de sa propre espèce plutôt que d’accepter la mort.
Mon espèce a une perversion de l’âme infiniment plus grave que les perversions du pauvre corps animal de mon espèce. Il faut être déglingué comme l’est mon espèce pour s’enterrer vivant dans la mort et vouer sa vie à la mort.
Mais ainsi est mon espèce qu’elle préfère les délires de son esprit malade à la fragilité mortelle de son corps.
Double et duplice est mon espèce qui martyrise le corps animal de mon espèce par peur de la mort et se console de la mort contre la chair animale de mon espèce.
Car mon espèce se love sous les mamelles des mères de son espèce et entre les bras et les cuisses des autres membres de son espèce pour oublier la mort.
Mon espèce dépèce les corps des mères de son espèce, abat les vieillards de son espèce, écartèle les femmes de son espèce, arrache les couilles des hommes de son espèce puis brandit ces trophées pour amadouer la mort.
Mon espèce peut le matin bercer ses enfants avec des yeux de biche, aller en éventrer d’autres deux heures après puis se laver le sang des mains au robinet avant de dorloter de nouveau la progéniture de mon espèce.
Ma folle espèce affolée par le temps infime de son corps préfère mourir sa vie plutôt que de vivre la durée si courte de son corps.
Mon espèce terrifiée par la mort se précipite dans la mort par frayeur de la mort.
Mon espèce creuse dans sa chair le sillon de la mort.
Et l’âme de mon espèce dégringole dans le trou du cul de la mort.
Ainsi est l’instabilité effrayante de mon espèce pétrie de nuage et de fange et qui remplit de fange et de nuage la fosse de la mort.
Infinis sont la bêtise et l’orgueil de mon espèce qui sacrifie mon espèce à sa goinfrerie de biens durant sa vie et à sa goinfrerie de survie après la mort.
Il faut être abruti comme l’est mon espèce pour détruire la terre, se payer à elle-même un impôt sur la destruction de la terre et continuer de la détruire jusqu’à sa propre mort.
Il faut être aveuglé comme l’est mon espèce pour ne pas voir que la terre et l’univers se fichent de mon espèce.
Mais l’immensité de la prétention et de l’imbécillité de mon espèce est le seul infini accessible à mon espèce.
Mon espèce fait de sa vie le croupion de la mort.
Mon espèce essuie son avenir sur le paillasson de la mort.
Toute la vitalité de mon espèce se consume à remplir la panse de la mort. A combler le trou du ventre de la mort par la mort.
Et la mort déborde dans la vie de mon espèce, recouvre la vie de mon espèce, enfouit sous elle la vie de mon espèce.
La mort jouit dans mon espèce.
Ainsi célébrer mon espèce revient à célébrer la mort.
Si je pouvais, je sortirais de mon espèce, mais je suis de même espèce que les autres membres de mon espèce.
Comme tous ceux mon espèce, je loue et vitupère mon espèce. Mon effroi devant la cruauté de mon espèce fait de moi un membre commun de mon espèce, qui se distingue par l’amour et la haine de son espèce.
Comme tous les membres de mon espèce, je suis de cette espèce qui étrangle et étreint, bénit et maudit les membres de son espèce.
La seule issue pour un membre de mon espèce conscient de la dangerosité de son espèce est de s’immoler ou de se faire exécuter par son espèce. La seule issue qu’aient trouvée les membres clairvoyants de mon espèce pour échapper à la honte et à la fatalité de mon espèce est d’être mis à mort par leur espèce.
Ainsi les membres de mon espèce bienveillants à l’égard de mon espèce n’ont-ils d’autre choix qu’entre le meurtre et la mort.
Double et duplice est mon espèce qui célèbre également la destruction et le sacrifice des membres de son espèce.
Duplice et double est mon espèce qui protège et étouffe contre sa poitrine les membres de son espèce.
Car mon espèce serre dans ses mains les mains de mon espèce. Mon espèce accueille au chaud des plis de son corps les corps de mon espèce. La tendresse de mon espèce panse les blessures de mon espèce. Mon espèce ouvre désespérément son cœur et son âme à mon espèce. Mon espèce illumine la nuit de mon espèce.
Mais si grande est la versatilité volatile de mon espèce qu’il suffit d’une rognure d’ongle pour qu’elle se prosterne de nouveau devant la mort.
Ainsi est mon espèce qu’elle pétrit le pain de la vie et se partage celui de la mort.
La soif de paix de mon espèce est un fétu de paille emporté par la violence de mon espèce. L’animalité humaine de mon espèce une larme noyée dans le torrent de l’inhumanité humaine de mon espèce. Le dévouement de mon espèce est une poignée de terre arrachée au continent de férocité de mon espèce. Le flot d’amour de mon espèce une goutte d’eau dans l’océan de sauvagerie de mon espèce. Le courage de mon espèce devant la mort est un grain de sable face à la lâcheté de mon espèce qui se voue à la mort en donnant la mort à son espèce.
Car mon espèce a inventé mille manières d’assassiner mon espèce, mais pas une seule manière d’aimer continûment les membres de son espèce.
Aimer son espèce est au-dessus des forces de mon espèce.
Toutes les ressources de fraternité et de compassion de mon espèce, toutes les capacités de sentir et de penser de mon espèce sont insuffisantes pour parvenir à aimer continument une telle espèce.
Il faut être un joyau de l’espèce pour ne pas vouer aux gémonies une espèce aussi bornée et destructrice que mon espèce. C’est pourquoi mon espèce célèbre les joyaux de son espèce qui parviennent à ne pas honnir leur espèce.
Mais mon espèce est trop envieuse et jalouse pour célébrer vivants les joyaux de son espèce. Mon espèce ne célèbre que morts les bienfaiteurs de son espèce et se lave de ses infamies par le remords.
Ainsi est mon espèce adorant le remords et les prophètes du remords qui lui enjoignent de se repentir pour mieux se soumettre à la mort. Ainsi est mon espèce toujours gagnante à la loterie de la mort.
Le cœur de mon espèce est le charnier métaphysique de la mort.
Mais dans son cœur mon espèce ne cesse de pleurer sa mort et ses morts.
Telle est mon espèce qu’elle pleure les victimes et les morts dont elle remplit l’histoire de mon espèce.
Telle est mon espèce qu’elle célèbre la moelle de la vie dans l’os de la mort.
Ma pauvre espèce souffre de la maladie et de la douleur de la mort.
Ma malheureuse espèce affolée par la mort se jette follement au cou de la mort. Ma misérable espèce se meurt d’avoir nommé la mort.
Comment célébrer cette tragique espèce qui se débat mortellement dans sa terreur de la mort ?
Comment célébrer l’insoumission de mon espèce asservie par mon espèce, le rire cosmique de mon espèce devant l’inconséquence de mon espèce, la révolte tenace de mon espèce contre la tyrannie mon espèce, la douceur délicate de mon espèce outragée par la brutalité de mon espèce, la résistance inflexible de mon espèce torturée par mon espèce, la dignité de mon espèce humiliée par mon espèce, les trésors d’intelligence de mon espèce dilapidés par la sottise de mon espèce, la générosité de mon espèce élimée par l’avarice de mon espèce, l’ingéniosité de mon espèce dévoyée par la rapacité de mon espèce, la puissance de mon espèce submergée par l’impuissance de mon espèce, la lucidité de mon espèce anéantie par l’aveuglement de mon espèce, la grandeur de mon espèce rongée par la petitesse de mon espèce, l’espoir de mon espèce étouffé sous le désespoir de mon espèce, la rébellion obstinée de mon espèce écrasée par mon espèce, les sanglots de mon espèce conduite par mon espèce dans la vallée de la mort ?
Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les séparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l’extase, la souffrance, la folie, l’horreur, les crimes de mon espèce. Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce.
Ainsi est mon espèce qu’elle célèbre le n’importe quoi de son espèce qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce.
Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce.
Mon espèce s’extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l’avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres, de ses dieux, de son or, de ses croyances comme de ses incroyances.
Tout rentre tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de son espèce. Mon espèce étripe mon espèce au nom de l’amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l’espèce.
Mon espèce ravage mon espèce au nom de l’humanité comme de l’inhumanité de mon espèce. Mon espèce pollue ce qu’elle invente de plus sacré dans le fumier de mon espèce.
Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce. Mon espèce entasse les bêtes qu’elle mange dans des hangars où elles pourrissent vivantes et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce. Mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce. Mon espèce pend, fusille, bombarde, gaze, démembre, écorche, poignarde les hommes, les femmes et les enfants de son espèce.
Ainsi est mon espèce plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce.
Même les porcs ont plus de parcelle divine dans leur couenne que mon espèce. Même les porcs ont plus de chances de gagner l’éternité que mon espèce qui martyrise toute espèce y compris sa propre espèce.
Comment peut-on célébrer une espèce aussi nuisible que mon espèce ? Une espèce oublieuse et avide qui se soumet aux pires de l’espèce et anéantit les meilleurs de son espèce pour ensuite les célébrer.
Car mon espèce se rachète et achète son humanité en célébrant les victimes de mon espèce et les tessons de lumières qui éclairent la nuit de mon espèce servent de pardon à la cruauté de mon espèce.
Il faut être une espèce décervelée comme l’est mon espèce pour croire qu’un dieu tout puissant puisse absoudre ses crimes contre son espèce. Il faut être déboussolé comme l’est mon espèce pour imaginer qu’un quelconque infini puisse ressembler à ce qu’en invente à son image la sauvagerie de mon espèce.
Car mon espèce se sert de ses dieux pour mettre à mort les membres de son espèce. Mon espèce peut louer le créateur de toute espèce puis au sortir de ses prières crucifier, lapider, égorger en son nom d’autres membres de mon espèce.
Comment croire aux dieux de mon espèce qui sont des dieux déféqués par la cervelle détraquée de mon espèce ?
La fente d’infini qui traverse le nom de dieu dans mon espèce est ramenée à la mesure de la porcherie de mon espèce. Et aucun dieu ne peut ressusciter l’âme de mon espèce assassinée par mon espèce.
Ainsi est mon espèce qu’elle fait endosser à ses dieux la porcherie de mon espèce.
Qui sauvera mon espèce de mon espèce ? Une espèce qui se gorge de meurtres est une espèce condamnée à la non-éternité de son espèce.
L’âme de mon espèce fond comme glaçon entre les mains sanglantes de mon espèce emportée par sa peur et sa passion de la mort. Car mon espèce passe le plus clair de sa vie à amonceler richesses et prières contre la mort et à se soustraire à la vie pour se donner à la mort. Mon espèce dépense des trésors d’intelligence à se persuader que la mort est la vie et que la vie est la mort. Mon espèce a honte du désir et de la vie auxquels elle préfère la putréfaction de la mort. Mon espèce préfère s’insulter par les organes et les actes du plaisir de sa propre espèce plutôt que d’accepter la mort.
Mon espèce a une perversion de l’âme infiniment plus grave que les perversions du pauvre corps animal de mon espèce. Il faut être déglingué comme l’est mon espèce pour s’enterrer vivant dans la mort et vouer sa vie à la mort.
Mais ainsi est mon espèce qu’elle préfère les délires de son esprit malade à la fragilité mortelle de son corps.
Double et duplice est mon espèce qui martyrise le corps animal de mon espèce par peur de la mort et se console de la mort contre la chair animale de mon espèce.
Car mon espèce se love sous les mamelles des mères de son espèce et entre les bras et les cuisses des autres membres de son espèce pour oublier la mort.
Mon espèce dépèce les corps des mères de son espèce, abat les vieillards de son espèce, écartèle les femmes de son espèce, arrache les couilles des hommes de son espèce puis brandit ces trophées pour amadouer la mort.
Mon espèce peut le matin bercer ses enfants avec des yeux de biche, aller en éventrer d’autres deux heures après puis se laver le sang des mains au robinet avant de dorloter de nouveau la progéniture de mon espèce.
Ma folle espèce affolée par le temps infime de son corps préfère mourir sa vie plutôt que de vivre la durée si courte de son corps.
Mon espèce terrifiée par la mort se précipite dans la mort par frayeur de la mort.
Mon espèce creuse dans sa chair le sillon de la mort.
Et l’âme de mon espèce dégringole dans le trou du cul de la mort.
Ainsi est l’instabilité effrayante de mon espèce pétrie de nuage et de fange et qui remplit de fange et de nuage la fosse de la mort.
Infinis sont la bêtise et l’orgueil de mon espèce qui sacrifie mon espèce à sa goinfrerie de biens durant sa vie et à sa goinfrerie de survie après la mort.
Il faut être abruti comme l’est mon espèce pour détruire la terre, se payer à elle-même un impôt sur la destruction de la terre et continuer de la détruire jusqu’à sa propre mort.
Il faut être aveuglé comme l’est mon espèce pour ne pas voir que la terre et l’univers se fichent de mon espèce.
Mais l’immensité de la prétention et de l’imbécillité de mon espèce est le seul infini accessible à mon espèce.
Mon espèce fait de sa vie le croupion de la mort.
Mon espèce essuie son avenir sur le paillasson de la mort.
Toute la vitalité de mon espèce se consume à remplir la panse de la mort. A combler le trou du ventre de la mort par la mort.
Et la mort déborde dans la vie de mon espèce, recouvre la vie de mon espèce, enfouit sous elle la vie de mon espèce.
La mort jouit dans mon espèce.
Ainsi célébrer mon espèce revient à célébrer la mort.
Si je pouvais, je sortirais de mon espèce, mais je suis de même espèce que les autres membres de mon espèce.
Comme tous ceux mon espèce, je loue et vitupère mon espèce. Mon effroi devant la cruauté de mon espèce fait de moi un membre commun de mon espèce, qui se distingue par l’amour et la haine de son espèce.
Comme tous les membres de mon espèce, je suis de cette espèce qui étrangle et étreint, bénit et maudit les membres de son espèce.
La seule issue pour un membre de mon espèce conscient de la dangerosité de son espèce est de s’immoler ou de se faire exécuter par son espèce. La seule issue qu’aient trouvée les membres clairvoyants de mon espèce pour échapper à la honte et à la fatalité de mon espèce est d’être mis à mort par leur espèce.
Ainsi les membres de mon espèce bienveillants à l’égard de mon espèce n’ont-ils d’autre choix qu’entre le meurtre et la mort.
Double et duplice est mon espèce qui célèbre également la destruction et le sacrifice des membres de son espèce.
Duplice et double est mon espèce qui protège et étouffe contre sa poitrine les membres de son espèce.
Car mon espèce serre dans ses mains les mains de mon espèce. Mon espèce accueille au chaud des plis de son corps les corps de mon espèce. La tendresse de mon espèce panse les blessures de mon espèce. Mon espèce ouvre désespérément son cœur et son âme à mon espèce. Mon espèce illumine la nuit de mon espèce.
Mais si grande est la versatilité volatile de mon espèce qu’il suffit d’une rognure d’ongle pour qu’elle se prosterne de nouveau devant la mort.
Ainsi est mon espèce qu’elle pétrit le pain de la vie et se partage celui de la mort.
La soif de paix de mon espèce est un fétu de paille emporté par la violence de mon espèce. L’animalité humaine de mon espèce une larme noyée dans le torrent de l’inhumanité humaine de mon espèce. Le dévouement de mon espèce est une poignée de terre arrachée au continent de férocité de mon espèce. Le flot d’amour de mon espèce une goutte d’eau dans l’océan de sauvagerie de mon espèce. Le courage de mon espèce devant la mort est un grain de sable face à la lâcheté de mon espèce qui se voue à la mort en donnant la mort à son espèce.
Car mon espèce a inventé mille manières d’assassiner mon espèce, mais pas une seule manière d’aimer continûment les membres de son espèce.
Aimer son espèce est au-dessus des forces de mon espèce.
Toutes les ressources de fraternité et de compassion de mon espèce, toutes les capacités de sentir et de penser de mon espèce sont insuffisantes pour parvenir à aimer continument une telle espèce.
Il faut être un joyau de l’espèce pour ne pas vouer aux gémonies une espèce aussi bornée et destructrice que mon espèce. C’est pourquoi mon espèce célèbre les joyaux de son espèce qui parviennent à ne pas honnir leur espèce.
Mais mon espèce est trop envieuse et jalouse pour célébrer vivants les joyaux de son espèce. Mon espèce ne célèbre que morts les bienfaiteurs de son espèce et se lave de ses infamies par le remords.
Ainsi est mon espèce adorant le remords et les prophètes du remords qui lui enjoignent de se repentir pour mieux se soumettre à la mort. Ainsi est mon espèce toujours gagnante à la loterie de la mort.
Le cœur de mon espèce est le charnier métaphysique de la mort.
Mais dans son cœur mon espèce ne cesse de pleurer sa mort et ses morts.
Telle est mon espèce qu’elle pleure les victimes et les morts dont elle remplit l’histoire de mon espèce.
Telle est mon espèce qu’elle célèbre la moelle de la vie dans l’os de la mort.
Ma pauvre espèce souffre de la maladie et de la douleur de la mort.
Ma malheureuse espèce affolée par la mort se jette follement au cou de la mort. Ma misérable espèce se meurt d’avoir nommé la mort.
Comment célébrer cette tragique espèce qui se débat mortellement dans sa terreur de la mort ?
Comment célébrer l’insoumission de mon espèce asservie par mon espèce, le rire cosmique de mon espèce devant l’inconséquence de mon espèce, la révolte tenace de mon espèce contre la tyrannie mon espèce, la douceur délicate de mon espèce outragée par la brutalité de mon espèce, la résistance inflexible de mon espèce torturée par mon espèce, la dignité de mon espèce humiliée par mon espèce, les trésors d’intelligence de mon espèce dilapidés par la sottise de mon espèce, la générosité de mon espèce élimée par l’avarice de mon espèce, l’ingéniosité de mon espèce dévoyée par la rapacité de mon espèce, la puissance de mon espèce submergée par l’impuissance de mon espèce, la lucidité de mon espèce anéantie par l’aveuglement de mon espèce, la grandeur de mon espèce rongée par la petitesse de mon espèce, l’espoir de mon espèce étouffé sous le désespoir de mon espèce, la rébellion obstinée de mon espèce écrasée par mon espèce, les sanglots de mon espèce conduite par mon espèce dans la vallée de la mort ?
LE LIVRE LA TABLE LA LAMPE
Au poète René Char
et au commandant de compagnie FFI René Issaurat
Le livre
du col de la Cayolle aux gorges du Loup
dans ces vallées dont les torrents finissent en bouches dans la mer
poème se fait d’échos
et de paroles perdues
- comme on dresse la table avec la place du mort -
sur la nappe de la page comme la coupe de fruits toujours pleine que les paysans disposent en vue sur le buffet
dans l’humilité de cette abondance du peu le poème
qui se soustrait de sa corolle de fruits
dont je fais simplement offrande aux disparus
le nu à même les mots
faisant histoire du poème et poème de l’histoire
car dure la terre sous la neige et poreuses les frontières du temps où je vais transhumant derrière chèvres et brebis grimpant à l’adret des alpages dans l’aboiement des chiens et le frémissement des pattes nerveuses, piquant dans l’herbe des cimes des nappes de mousserons bouclés
ainsi je voyais
à vue d’enfance mes lèvres à hauteur des babouines du bouc
et allait le père de son pas de chasseur alpin à l’avant des troupeaux
Puis j’ai seize ans. Il se meurt dans un lit d’hôpital. Je lis Fureur et mystère. Le récit commence qui noue l’histoire à l’Histoire et le hasard des noms à celui des mots. Le commandant René chef de compagnie FFI et le poète se joignent sous le double signe de l’engagement résistant et d’un même prénom marqué de renaissance. Tandis que l’un agonise, muet, le corps paralysé, les paupières seules vivantes - un battement pour oui, deux pour non-, les membres déjà pris dans la mort, résonnent les paroles de l’autre - « Les yeux seuls sont capables de pousser un cri ». Mais il n’y a pas de peur dans ceux du père. Parfois seulement un durcissement, une colère. Et s’il allait falloir durer ainsi des années, pris vif en mort?
Le courage : leur legs. Que je reçois des yeux de l’un et des mots de l’autre.
Le récit est bref d’une mort. La nuit bleutée des couloirs d’hôpitaux. Une femme qui les traverse en courant. Pieds nus. Hurlant je ne veux pas mourir! Puis s’abat contre le mur, ramenée à sa chambre, soutenue par les aisselles. Le père a perdu conscience. Plus tard, dans la nuit, un homme geint, à demi tombé du lit. Quand je l’aide à se redresser ses bras se ferment brusquement autour de ma nuque. Le corps est si léger qu’il me semble soulever une couverture vide, mais les bras décharnés d’une vigueur d’os à nu serrent mon cou à m’étouffer. Un second sursaut jette sa face contre la mienne puis il retombe sur l’oreiller. Les yeux démesurément agrandis. Les narines dilatées. La bouche béante. Comme pour une dernière aspiration de tout par tous les orifices de la face. Le râle du père s’est alenti. Il y aura un ressaut vers deux heures du matin. Un regard bleu intense. Qui ne cille pas. Puis c’est fini. Le père est mort.
sur les genoux le livre est resté ouvert deux nuits durant
recueillant le silence du père
livre tombeau et renaissance d’où à l’appel de la parole se lève Lazare que nous sommes
renés de successives morts
La table
Dans la maison désertée par le père, l’après de la mort. Sur le verre recouvrant le bureau – toujours depuis la maladie, cette vitre entre le bois et la main du père, lui qui était homme de forêts et de bâtons taillés, fut cénotaphe comme plus tard sous les vitrines les manuscrits du poète disparu -, sur cette table, où j’écris, sont ouverts le livre et le vieux cartable. L’un blanc immaculé. Le livre. L’autre fripé. Un cuir brun noirci aux marques des doigts. Dedans les papiers. « Dans la sacoche, a dit le père, tu trouveras les papiers de la Résistance à léguer aux archives après ma mort ».
Des noms sortent des feuilles du livre - « Marius Bardoin l’imprimeur de Forcalquier, Figuière, Passereau, Joseph Fontaine d’une rectitude et d’une teneur de sillon, François Cuzin, le docteur Jean Roux, Gabriel Besson, Roger Chaudron à Oraison … » - qui rejoignent ceux des maquisards consignés sur des fiches cartonnées. FFI Alpes Maritimes Corps Francs de la Libération, Groupe Alexander. Nom. Prénom. Profession. Adresse. Situation de famille. Date d’incorporation. Eventuellement spécialité militaire (mitrailleur, instructeur, mécanicien, tireur, infirmier, interprète, chauffeur, cuisinier…). Quelques annotations : en bleu à gauche « volontaire pour le combat ». En rouge : « tombé au combat ». C’est tout.
Cent cinquante fiches. La compagnie du commandant René. Une photo de pendu, le corps désarticulé, prise à travers le pare-brise d’une voiture en marche et qui érafle d’une gifle de flou le visage d’une femme. C’est Torini exécuté au bas de l’avenue de la Victoire à Nice. Une lettre de dénonciation menaçant le père et sa mère de la gestapo pour cacher des Juifs et entretenir des activités subversives. Une carte d’infamie où le visage poupin d’un Paul Josué Benoit est balafré du mot Juif. Et puis des faux certificats de baptême. Des faux papiers à l’enseigne de la Sicherheitspolizei.
Dans une boite à l’effigie du Maréchal Leclerc, la croix de Lorraine en aluminium avec le numéro matricule. Des médailles pliées dans les lettres jaunies qui les décrivent: croix de la résistance, croix de combattant volontaire, croix de guerre avec étoile. Et puis encore des témoignages d’actions. Des notes. Des ordres griffonnés. C’est le legs du père. Dont il a peu parlé. Comme tous ceux qui ont agi. « La qualité des résistants n’est pas, hélas, partout de même !… A prévoir ces coqs du néant qui timbreront aux oreilles, la Libération venue… ». Les coqs à tondues exaspéraient aussi le père. Pour le reste juste quelques mots: j’ai combattu une idéologie non un peuple, fillette. Le pire peut naître en tous. En chacun de nous. Sois vigilante. Je te fais confiance. Veille bien.
de même
peu de mots le poème pour cette vigilance arquée
Au tracé de la table de verre, entre le T et le compas d’architecte, dans la poussière venue de temps d’orages où voisinent les lettres et les traces, se déplace la question du poème : nature morte au recueil tandis que repose le cadavre du père dans la pièce voisine et que continuent de courir les mots d’une époque où les maquis les joignaient ailleurs que sur des pages, quelque part du côté de Forcalquier
et cela - odeur de résine et de châtaignier sous le glacé du verre où se reflétaient ensemble papiers et livre consignés à la fugacité de leur image - a fait poème
haletant mystère de ce qui se vit et que seule noue la langue résistante
la langue consistante
la langue nourrissante
la substantifique langue de la moelle des mots et des morts
où résiste la langue au mirador
où résiste la langue à l’obscénité de transparence
où résiste la langue à l’asservissement
où résiste la langue à l’avilissement
où résiste la langue sous la dent
et tient ferme le poème en bouche dans la langue du bouc qui broute le chardon dur
langue de bouc et de boue
mains du mort et du vif entrecroisées à la fable du poème meulé au broyeur des molaires
dans l’arc en ciel des fontaines où se noyaient le sable rouge et le silex étoilé jamais Résistance n’eût pour l’enfant sens de refus mais bien plutôt d’élan allant
celui du pas du père allant
entre les aiguilles de pins et de mélèzes. Dans les gorges du Cians ou du Verdon. Sur les versants pentus, grimpant au Pic de la Colmiane ou à la Cime de l’Agnel. Pêchant les truites dans les launes de la Vésubie mais évitant le saut du cavalier où avait baigné le crâne fracassé d’un des siens.
Que parle pour lui le poème comme intercède un cierge dans les vasques votives de la grotte de St Colomban
et scande le pas du poème le pas du père plus que sa parole
lui, silencieux, taiseux, de peu de mots comme des stèles
sachant l’ongle pointé de la mort et la vie si vite qu’aucun mot n’y suffit
et en cela pareils les deux René dans le silence
à peine paroles comme une pierre au pied
au passage du soc s’ouvre la terre en lèvres rouges et va le sillon du poème - sa tranchée – d’un bout à l’autre du corps
il y a toujours à la vivisection de vivre une multitudes de bourgeons à élaguer
c’était des choses simples – le feu, les vignes, l’amandier, l’olivier, les bêtes de terriers et de nids, l’audace, l’amour, le risque - glissant entre chair et peau : un filet de sang au genou éraflé d’une ronce
« L’avion déboule. Les pilotes invisibles se délestent de leur jardin nocturne puis pressent un feu bref sous l’aisselle de l’appareil pour avertir que c’est fini. Il ne reste plus qu’à rassembler le trésor éparpillé. De même le poète… »
c’est ce « de même » qui m’a menée au poème
nouant au pouls du poignet le va-tout de vivre éparpillé dans l’éventail des veines
greffé à sa saignée
pour que, grappillant des grains de grenades au dispersé du temps, cesse enfin la langue d’être successive
(ils m’avaient tant pesé ces récits d’école qui, la fin devinée aux premières lignes, déroulaient interminablement leur cortège empesé alors qu’en chair et cervelle, tout est en même temps explosé rassemblé)
Sur la table de verre, superposés en laques translucides du céruse de l’aube jusqu’au noir d’encre du plumier, où le père rangeait compas et crayons, poèmes et reflets donnaient le tout de tout soustrait de narration
épelant appelant le dédale et le poing
la lame ébréchée de l’opinel et le coupant du fil des herbes
le sans limite et l’ici là
et dans les nœuds du bois le loriot, l’alouette, l’eau au rebond des drailles, l’arrière pays de cimes et de vallons, où, de Lantosque au col d’Allos, fut le commandant René et son réseau de maquisards puis plus tard y rejoignant sa mort lentement ralentissant son pas, bientôt traînant, paralysé aux jambes prises vives, lui qui allait allant marcheur infatigable,
et le poème dit son pied posé au sol dans l’équité
Dans la nuit sans lampe et sans étoile des adrets. Le lent de la neige. Sa fleur de givre à la carte du ciel glacé. Le meuglement des troupeaux. La taie blanche des alpages. L’odeur de torrent et de nappes de brume. Dans la relève des sentinelles de gel, tu es né et mort, mon père. Chasseur alpin matricule 7002, qui déserta pour rejoindre les Francs tireurs. Dans l’hiver des vallées alpines, tu reposes. Enterré sous la terre froide de l’hiver. Dans le bruit des cascades sous les aiguilles de pin.
La lampe
C’était du libre. Du joyeusement audacieusement libre. De l’épaisseur d’épais. Du couches sur couches. Temps sur temps. Du dedans et dehors accouplés. Du tissu dont est tissé le texte. Car c’est de fils, de fibres, draps, linceuls, nappes de fête, vieilles vestes de pêcheur – l’autre René parle de chasse – qu’il est fait. Ouvrage de tisserand et de fileuse. Dans une modestie charnelle. Le poème c’était du cousu main. Ajusté à la peau. A son vif et à sa dépouille. Et comme elle orné et dépouillé.
arme chargée dans l’odeur de tabac des gants portant encore la marque de la crosse
ainsi le poème : sur le cassant du verre le redoublement dicible du reflet
Là bas, vers Aspremont, dans le brouillard, il y eut des choses qu’il vaut mieux ne pas voir disait le père. Alors mains devant les yeux pour ne pas voir, tire l’enfant la corne du bouc tandis que, levant du cul une ruade, il montre ses belles grosses couilles rondes et que vire la danse de la vie : « Allez hue ! La bête ! Et toi, petite, course les chèvres dans la pente – jamais vers le haut, gamine, là tu peux toujours courir pour les rattraper, vers le bas et en douceur, c’est comme en amour, si tu tires ou tu pousses, ça rue ! Mets du sel dans ta paume et elles te suivront. Allez va fillette ! Sache le bouc et la chèvre et l’oseille pour le chevreau sacrifié ! »
Ainsi disent-ils, saluant le père de deux doigts portés au béret, l’appelant encore Commandant des années après, tandis qu’à longues enjambées il descendait du Seuil vers le moulin sentant l’olive et dont la pierre avait roulé entre les herbes, meule menhir dressée jusque dans le lit de la rivière qui le tenait, jambes écartée, entre deux filets d’eau gonflée de remous.
fouille la source le sourcier
et ondoie le torrent comme les couleuvres et les aspics que le père pinçait au bout des branches de coudrier ouvertes en V par l’ allumette
ce serait juste quelque chose qui baratte la langue et la fasse tourner
jusqu’à ce que tourne court discours sur le poème qui n’a d’autre à dire que lui-même burinant la parole
gouges, limes, râpes et rabots sur l’établi de l’atelier
et seulement ce creusement
cette résistance cette résonance
clarines et sonnailles dans les prairies de marguerites d’où dégringole la sente parfumée de lavande jusqu’à la place des fusillés, dont nul ne connaît plus le nom
Il faut sac à dos pour un bivouac si précaire qu’est vivre. À ce déjeuner sur l’herbe d’une vie j’ai fait de poésie un plat de résistance qui peut sembler bourrative pitance, estouffa babi en patois alpin des Francs-tireurs et que je traduis poésie égale maximum de sens sur minimum de surface
ration de survie pour des temps de disette mentale.
sur la table de verre se sont scellées les lèvres à la parole
j’y demeure à l’ascendant
maison du ciel au répit des étoiles
enfin dormir
Car rien du dit n’est à redire. Ni à dédire. De la manière on se défait. Le legs ne lie pas.
Seule vigie la vigilance
à l’ordre
du poème comme un bélier jeté sur la complaisance de la langue
un déni à la désertion de la pensée, à la facilité de la pensée, à l’abandon sentimental de la pensée
Mon histoire serait autre si je ne devais aux deux René une résistance tenace héritée du père et du poète à la langue rétive. Qu’hommage leur soit ici rendu. En tant d’années, dont plusieurs aux côtés de la folie, je n’ai vu que le poème et le courage faire pièce au terrible. C’est lui qui tranche les camps. A cette borne, le poème n’est plus question de choix mais de fait. A écouter les rescapés de camps de mort et d’enfermement, il en fut et reste de même. La souffrance est une lectrice implacable. Ca tient ou ne tient pas. D’expérience c’est le poèmes qui tient le mieux. Parce qu’il œuvre à la trame de l’être. Use de mêmes ruses. Ils riment. Tête-bêche. Dans le face à face des figures.
C’est le fin fond du sac de l’esprit. Le millefeuille des neurones. Le contenant de tout contenu. L’argile des vases brisés. Les fragments dispersés de la conscience. Le retrait de la présence éclatée. La mécanique à vif de la langue. La chaussette retournée du cerveau. Au troc avec le pire - féroce usurier - la poésie est bonne ménagère qui fait le plus en dépensant le moins. Maigre vertu que cette économie domestique de gens de peu mais tant pis
ce tant pis est tant mieux
d’une certaine façon pour toujours j'en suis
comme le poème est toujours de peu au bavardage prétentieux de la parole
Au nom de ce peu qui est si peu que son nom même l’excède posera juste un instant le poème en paysanne – tel les saisonniers gagnent de quoi survivre le temps d'une vendange - menant troupe de mots meuglant comme vaches à l’étable, ressemblant à ces culs terreux dont je suis issue et dépiautant la volaille dans un envol ébouriffé de plumes et de caquètements
car il y a place pour tout dans la poétique panse qui tout engloutit, tant l’ample que le chétif, le murmure que le brame, le minime en bout de langue que la logorrhée du potlatch.
« Il y a des choses que non » disait la mère du père dans son parler de montagnarde, désignant ainsi l’ordinaire des atrocités humaines barbares et policées en allant au poulailler d’un même geste distribuer le grain et les balles cachées sous la paille des œufs.
Il arrive inépuisablement des choses que non et que, pareil au disque d’argile ou au pain d’olives partagé entre les hôtes, tende, parfois, le poème sa moitié de parole, dont l’autre possède égale part, rappelant que jamais, sauf à tuer, aucune parole n’épuise la parole, avec cette incomplétude, ce suffisamment de manque et d’excès, d’écart à l’équilibre des lucrétiennes particules pour que quelque chose naisse…
parfois (parfois seulement car le poème va aussi au tout venant)
il y a de l’inquiet dans le poème
du non quiet qui enfin s’inquiète
de ce qui se dit
de l’indéfini qui cesse enfin de clore
le monde aux bruits d’une bouche
et puis de l’altérité non réduite enfin de l’autre
non assigné à soi
alors
tandis que vacillent les lettres à la lueur de la vieille lampe torche qui, au Mont Alban ou à la Tête de Tigène, a éclairé des nuits de sentinelles, d’assauts meurtriers, de visages de prisonniers comme de rescapés, de héros et de traîtres, dans ce pays qui blasonne à ses gorges, ses cols et ses bouches la voix, le chant et les mots mais aussi la corde au cou des suppliciés et la balle dans la nuque
en icône à l'insignifiante et précieuse parole humaine qui s’égrène dans l’oubli : le poème
comme un coin dans le gras de la parole obstinément poème
pillé pillant à mille moineaux jetés dans les halliers
pelletant pour déterrer l’arête de seiche sous la croûte de sel comme sous l’échine frémissante des luzernes une question dans la profusion de la parole
ou pris à la gueule du loup
un éveil dans l'indigence de la parole
et au commandant de compagnie FFI René Issaurat
Le livre
du col de la Cayolle aux gorges du Loup
dans ces vallées dont les torrents finissent en bouches dans la mer
poème se fait d’échos
et de paroles perdues
- comme on dresse la table avec la place du mort -
sur la nappe de la page comme la coupe de fruits toujours pleine que les paysans disposent en vue sur le buffet
dans l’humilité de cette abondance du peu le poème
qui se soustrait de sa corolle de fruits
dont je fais simplement offrande aux disparus
le nu à même les mots
faisant histoire du poème et poème de l’histoire
car dure la terre sous la neige et poreuses les frontières du temps où je vais transhumant derrière chèvres et brebis grimpant à l’adret des alpages dans l’aboiement des chiens et le frémissement des pattes nerveuses, piquant dans l’herbe des cimes des nappes de mousserons bouclés
ainsi je voyais
à vue d’enfance mes lèvres à hauteur des babouines du bouc
et allait le père de son pas de chasseur alpin à l’avant des troupeaux
Puis j’ai seize ans. Il se meurt dans un lit d’hôpital. Je lis Fureur et mystère. Le récit commence qui noue l’histoire à l’Histoire et le hasard des noms à celui des mots. Le commandant René chef de compagnie FFI et le poète se joignent sous le double signe de l’engagement résistant et d’un même prénom marqué de renaissance. Tandis que l’un agonise, muet, le corps paralysé, les paupières seules vivantes - un battement pour oui, deux pour non-, les membres déjà pris dans la mort, résonnent les paroles de l’autre - « Les yeux seuls sont capables de pousser un cri ». Mais il n’y a pas de peur dans ceux du père. Parfois seulement un durcissement, une colère. Et s’il allait falloir durer ainsi des années, pris vif en mort?
Le courage : leur legs. Que je reçois des yeux de l’un et des mots de l’autre.
Le récit est bref d’une mort. La nuit bleutée des couloirs d’hôpitaux. Une femme qui les traverse en courant. Pieds nus. Hurlant je ne veux pas mourir! Puis s’abat contre le mur, ramenée à sa chambre, soutenue par les aisselles. Le père a perdu conscience. Plus tard, dans la nuit, un homme geint, à demi tombé du lit. Quand je l’aide à se redresser ses bras se ferment brusquement autour de ma nuque. Le corps est si léger qu’il me semble soulever une couverture vide, mais les bras décharnés d’une vigueur d’os à nu serrent mon cou à m’étouffer. Un second sursaut jette sa face contre la mienne puis il retombe sur l’oreiller. Les yeux démesurément agrandis. Les narines dilatées. La bouche béante. Comme pour une dernière aspiration de tout par tous les orifices de la face. Le râle du père s’est alenti. Il y aura un ressaut vers deux heures du matin. Un regard bleu intense. Qui ne cille pas. Puis c’est fini. Le père est mort.
sur les genoux le livre est resté ouvert deux nuits durant
recueillant le silence du père
livre tombeau et renaissance d’où à l’appel de la parole se lève Lazare que nous sommes
renés de successives morts
La table
Dans la maison désertée par le père, l’après de la mort. Sur le verre recouvrant le bureau – toujours depuis la maladie, cette vitre entre le bois et la main du père, lui qui était homme de forêts et de bâtons taillés, fut cénotaphe comme plus tard sous les vitrines les manuscrits du poète disparu -, sur cette table, où j’écris, sont ouverts le livre et le vieux cartable. L’un blanc immaculé. Le livre. L’autre fripé. Un cuir brun noirci aux marques des doigts. Dedans les papiers. « Dans la sacoche, a dit le père, tu trouveras les papiers de la Résistance à léguer aux archives après ma mort ».
Des noms sortent des feuilles du livre - « Marius Bardoin l’imprimeur de Forcalquier, Figuière, Passereau, Joseph Fontaine d’une rectitude et d’une teneur de sillon, François Cuzin, le docteur Jean Roux, Gabriel Besson, Roger Chaudron à Oraison … » - qui rejoignent ceux des maquisards consignés sur des fiches cartonnées. FFI Alpes Maritimes Corps Francs de la Libération, Groupe Alexander. Nom. Prénom. Profession. Adresse. Situation de famille. Date d’incorporation. Eventuellement spécialité militaire (mitrailleur, instructeur, mécanicien, tireur, infirmier, interprète, chauffeur, cuisinier…). Quelques annotations : en bleu à gauche « volontaire pour le combat ». En rouge : « tombé au combat ». C’est tout.
Cent cinquante fiches. La compagnie du commandant René. Une photo de pendu, le corps désarticulé, prise à travers le pare-brise d’une voiture en marche et qui érafle d’une gifle de flou le visage d’une femme. C’est Torini exécuté au bas de l’avenue de la Victoire à Nice. Une lettre de dénonciation menaçant le père et sa mère de la gestapo pour cacher des Juifs et entretenir des activités subversives. Une carte d’infamie où le visage poupin d’un Paul Josué Benoit est balafré du mot Juif. Et puis des faux certificats de baptême. Des faux papiers à l’enseigne de la Sicherheitspolizei.
Dans une boite à l’effigie du Maréchal Leclerc, la croix de Lorraine en aluminium avec le numéro matricule. Des médailles pliées dans les lettres jaunies qui les décrivent: croix de la résistance, croix de combattant volontaire, croix de guerre avec étoile. Et puis encore des témoignages d’actions. Des notes. Des ordres griffonnés. C’est le legs du père. Dont il a peu parlé. Comme tous ceux qui ont agi. « La qualité des résistants n’est pas, hélas, partout de même !… A prévoir ces coqs du néant qui timbreront aux oreilles, la Libération venue… ». Les coqs à tondues exaspéraient aussi le père. Pour le reste juste quelques mots: j’ai combattu une idéologie non un peuple, fillette. Le pire peut naître en tous. En chacun de nous. Sois vigilante. Je te fais confiance. Veille bien.
de même
peu de mots le poème pour cette vigilance arquée
Au tracé de la table de verre, entre le T et le compas d’architecte, dans la poussière venue de temps d’orages où voisinent les lettres et les traces, se déplace la question du poème : nature morte au recueil tandis que repose le cadavre du père dans la pièce voisine et que continuent de courir les mots d’une époque où les maquis les joignaient ailleurs que sur des pages, quelque part du côté de Forcalquier
et cela - odeur de résine et de châtaignier sous le glacé du verre où se reflétaient ensemble papiers et livre consignés à la fugacité de leur image - a fait poème
haletant mystère de ce qui se vit et que seule noue la langue résistante
la langue consistante
la langue nourrissante
la substantifique langue de la moelle des mots et des morts
où résiste la langue au mirador
où résiste la langue à l’obscénité de transparence
où résiste la langue à l’asservissement
où résiste la langue à l’avilissement
où résiste la langue sous la dent
et tient ferme le poème en bouche dans la langue du bouc qui broute le chardon dur
langue de bouc et de boue
mains du mort et du vif entrecroisées à la fable du poème meulé au broyeur des molaires
dans l’arc en ciel des fontaines où se noyaient le sable rouge et le silex étoilé jamais Résistance n’eût pour l’enfant sens de refus mais bien plutôt d’élan allant
celui du pas du père allant
entre les aiguilles de pins et de mélèzes. Dans les gorges du Cians ou du Verdon. Sur les versants pentus, grimpant au Pic de la Colmiane ou à la Cime de l’Agnel. Pêchant les truites dans les launes de la Vésubie mais évitant le saut du cavalier où avait baigné le crâne fracassé d’un des siens.
Que parle pour lui le poème comme intercède un cierge dans les vasques votives de la grotte de St Colomban
et scande le pas du poème le pas du père plus que sa parole
lui, silencieux, taiseux, de peu de mots comme des stèles
sachant l’ongle pointé de la mort et la vie si vite qu’aucun mot n’y suffit
et en cela pareils les deux René dans le silence
à peine paroles comme une pierre au pied
au passage du soc s’ouvre la terre en lèvres rouges et va le sillon du poème - sa tranchée – d’un bout à l’autre du corps
il y a toujours à la vivisection de vivre une multitudes de bourgeons à élaguer
c’était des choses simples – le feu, les vignes, l’amandier, l’olivier, les bêtes de terriers et de nids, l’audace, l’amour, le risque - glissant entre chair et peau : un filet de sang au genou éraflé d’une ronce
« L’avion déboule. Les pilotes invisibles se délestent de leur jardin nocturne puis pressent un feu bref sous l’aisselle de l’appareil pour avertir que c’est fini. Il ne reste plus qu’à rassembler le trésor éparpillé. De même le poète… »
c’est ce « de même » qui m’a menée au poème
nouant au pouls du poignet le va-tout de vivre éparpillé dans l’éventail des veines
greffé à sa saignée
pour que, grappillant des grains de grenades au dispersé du temps, cesse enfin la langue d’être successive
(ils m’avaient tant pesé ces récits d’école qui, la fin devinée aux premières lignes, déroulaient interminablement leur cortège empesé alors qu’en chair et cervelle, tout est en même temps explosé rassemblé)
Sur la table de verre, superposés en laques translucides du céruse de l’aube jusqu’au noir d’encre du plumier, où le père rangeait compas et crayons, poèmes et reflets donnaient le tout de tout soustrait de narration
épelant appelant le dédale et le poing
la lame ébréchée de l’opinel et le coupant du fil des herbes
le sans limite et l’ici là
et dans les nœuds du bois le loriot, l’alouette, l’eau au rebond des drailles, l’arrière pays de cimes et de vallons, où, de Lantosque au col d’Allos, fut le commandant René et son réseau de maquisards puis plus tard y rejoignant sa mort lentement ralentissant son pas, bientôt traînant, paralysé aux jambes prises vives, lui qui allait allant marcheur infatigable,
et le poème dit son pied posé au sol dans l’équité
Dans la nuit sans lampe et sans étoile des adrets. Le lent de la neige. Sa fleur de givre à la carte du ciel glacé. Le meuglement des troupeaux. La taie blanche des alpages. L’odeur de torrent et de nappes de brume. Dans la relève des sentinelles de gel, tu es né et mort, mon père. Chasseur alpin matricule 7002, qui déserta pour rejoindre les Francs tireurs. Dans l’hiver des vallées alpines, tu reposes. Enterré sous la terre froide de l’hiver. Dans le bruit des cascades sous les aiguilles de pin.
La lampe
C’était du libre. Du joyeusement audacieusement libre. De l’épaisseur d’épais. Du couches sur couches. Temps sur temps. Du dedans et dehors accouplés. Du tissu dont est tissé le texte. Car c’est de fils, de fibres, draps, linceuls, nappes de fête, vieilles vestes de pêcheur – l’autre René parle de chasse – qu’il est fait. Ouvrage de tisserand et de fileuse. Dans une modestie charnelle. Le poème c’était du cousu main. Ajusté à la peau. A son vif et à sa dépouille. Et comme elle orné et dépouillé.
arme chargée dans l’odeur de tabac des gants portant encore la marque de la crosse
ainsi le poème : sur le cassant du verre le redoublement dicible du reflet
Là bas, vers Aspremont, dans le brouillard, il y eut des choses qu’il vaut mieux ne pas voir disait le père. Alors mains devant les yeux pour ne pas voir, tire l’enfant la corne du bouc tandis que, levant du cul une ruade, il montre ses belles grosses couilles rondes et que vire la danse de la vie : « Allez hue ! La bête ! Et toi, petite, course les chèvres dans la pente – jamais vers le haut, gamine, là tu peux toujours courir pour les rattraper, vers le bas et en douceur, c’est comme en amour, si tu tires ou tu pousses, ça rue ! Mets du sel dans ta paume et elles te suivront. Allez va fillette ! Sache le bouc et la chèvre et l’oseille pour le chevreau sacrifié ! »
Ainsi disent-ils, saluant le père de deux doigts portés au béret, l’appelant encore Commandant des années après, tandis qu’à longues enjambées il descendait du Seuil vers le moulin sentant l’olive et dont la pierre avait roulé entre les herbes, meule menhir dressée jusque dans le lit de la rivière qui le tenait, jambes écartée, entre deux filets d’eau gonflée de remous.
fouille la source le sourcier
et ondoie le torrent comme les couleuvres et les aspics que le père pinçait au bout des branches de coudrier ouvertes en V par l’ allumette
ce serait juste quelque chose qui baratte la langue et la fasse tourner
jusqu’à ce que tourne court discours sur le poème qui n’a d’autre à dire que lui-même burinant la parole
gouges, limes, râpes et rabots sur l’établi de l’atelier
et seulement ce creusement
cette résistance cette résonance
clarines et sonnailles dans les prairies de marguerites d’où dégringole la sente parfumée de lavande jusqu’à la place des fusillés, dont nul ne connaît plus le nom
Il faut sac à dos pour un bivouac si précaire qu’est vivre. À ce déjeuner sur l’herbe d’une vie j’ai fait de poésie un plat de résistance qui peut sembler bourrative pitance, estouffa babi en patois alpin des Francs-tireurs et que je traduis poésie égale maximum de sens sur minimum de surface
ration de survie pour des temps de disette mentale.
sur la table de verre se sont scellées les lèvres à la parole
j’y demeure à l’ascendant
maison du ciel au répit des étoiles
enfin dormir
Car rien du dit n’est à redire. Ni à dédire. De la manière on se défait. Le legs ne lie pas.
Seule vigie la vigilance
à l’ordre
du poème comme un bélier jeté sur la complaisance de la langue
un déni à la désertion de la pensée, à la facilité de la pensée, à l’abandon sentimental de la pensée
Mon histoire serait autre si je ne devais aux deux René une résistance tenace héritée du père et du poète à la langue rétive. Qu’hommage leur soit ici rendu. En tant d’années, dont plusieurs aux côtés de la folie, je n’ai vu que le poème et le courage faire pièce au terrible. C’est lui qui tranche les camps. A cette borne, le poème n’est plus question de choix mais de fait. A écouter les rescapés de camps de mort et d’enfermement, il en fut et reste de même. La souffrance est une lectrice implacable. Ca tient ou ne tient pas. D’expérience c’est le poèmes qui tient le mieux. Parce qu’il œuvre à la trame de l’être. Use de mêmes ruses. Ils riment. Tête-bêche. Dans le face à face des figures.
C’est le fin fond du sac de l’esprit. Le millefeuille des neurones. Le contenant de tout contenu. L’argile des vases brisés. Les fragments dispersés de la conscience. Le retrait de la présence éclatée. La mécanique à vif de la langue. La chaussette retournée du cerveau. Au troc avec le pire - féroce usurier - la poésie est bonne ménagère qui fait le plus en dépensant le moins. Maigre vertu que cette économie domestique de gens de peu mais tant pis
ce tant pis est tant mieux
d’une certaine façon pour toujours j'en suis
comme le poème est toujours de peu au bavardage prétentieux de la parole
Au nom de ce peu qui est si peu que son nom même l’excède posera juste un instant le poème en paysanne – tel les saisonniers gagnent de quoi survivre le temps d'une vendange - menant troupe de mots meuglant comme vaches à l’étable, ressemblant à ces culs terreux dont je suis issue et dépiautant la volaille dans un envol ébouriffé de plumes et de caquètements
car il y a place pour tout dans la poétique panse qui tout engloutit, tant l’ample que le chétif, le murmure que le brame, le minime en bout de langue que la logorrhée du potlatch.
« Il y a des choses que non » disait la mère du père dans son parler de montagnarde, désignant ainsi l’ordinaire des atrocités humaines barbares et policées en allant au poulailler d’un même geste distribuer le grain et les balles cachées sous la paille des œufs.
Il arrive inépuisablement des choses que non et que, pareil au disque d’argile ou au pain d’olives partagé entre les hôtes, tende, parfois, le poème sa moitié de parole, dont l’autre possède égale part, rappelant que jamais, sauf à tuer, aucune parole n’épuise la parole, avec cette incomplétude, ce suffisamment de manque et d’excès, d’écart à l’équilibre des lucrétiennes particules pour que quelque chose naisse…
parfois (parfois seulement car le poème va aussi au tout venant)
il y a de l’inquiet dans le poème
du non quiet qui enfin s’inquiète
de ce qui se dit
de l’indéfini qui cesse enfin de clore
le monde aux bruits d’une bouche
et puis de l’altérité non réduite enfin de l’autre
non assigné à soi
alors
tandis que vacillent les lettres à la lueur de la vieille lampe torche qui, au Mont Alban ou à la Tête de Tigène, a éclairé des nuits de sentinelles, d’assauts meurtriers, de visages de prisonniers comme de rescapés, de héros et de traîtres, dans ce pays qui blasonne à ses gorges, ses cols et ses bouches la voix, le chant et les mots mais aussi la corde au cou des suppliciés et la balle dans la nuque
en icône à l'insignifiante et précieuse parole humaine qui s’égrène dans l’oubli : le poème
comme un coin dans le gras de la parole obstinément poème
pillé pillant à mille moineaux jetés dans les halliers
pelletant pour déterrer l’arête de seiche sous la croûte de sel comme sous l’échine frémissante des luzernes une question dans la profusion de la parole
ou pris à la gueule du loup
un éveil dans l'indigence de la parole
NOUS TOUS TANT QUE NOUS SOMMES
NOUS TOUS TANT QUE NOUS SOMMES
Au ventru des tulipes s’ouvrant sur les pistils
l’élan vivace et sa poussée
intense
dans le matin.
À l’horreur sa gorge mutique
dans l’ici douloureux et dérisoire de sa répétition
son grelottement de tôle tremblé
versant soudain dans la théière une louche de vie
ébouillantée.
Qu’est-ce qui reste, demande-t-elle, une fois rabattu le caquet de la parole sur son impuissance ?
Qui saura, je dis, arraisonner la langue à l’impossible ? La voilà qui se couche
chien tremblant, la queue entre les pattes
au seuil de l’inutile.
Pitié pour ceux qui s’obstinent et peinent aux mots comme au silence. En l’un et l’autre rien que nos histoires
de peu.
Dans le débris de syllabes, il y a du vrai de nous. Et toujours les démunis s’entêtent à formuler.
Je ne, je n’ai, nous ne
contre le trop grand tout de tout
dans son muet et
sa violence.
À la chute des mots dans leur déboulé de babioles, se ramasse le peu du peu au bout du bout comme pommes tombées sur le chemin.
Raconte, dit-elle
Louise, je dis, était une paysanne analphabète, née il y a plus d’un siècle dans les gorges étroites d’une vallée creusée par les moraines et les torrents. Engagée dans la Résistance, parce qu’il y a des choses que non comme elle le répétait, brassant d’un geste de la main le partout de ces choses, elle avait rejoint, dès la fin de la première guerre mondiale, le parti socialiste révolutionnaire. On disait anarchistes ou libertaires. Louise disait « nous autres tant que nous sommes» rassemblant dans sa paume petite tout ce qu’elle ignorait et tout ce qu’elle savait, sarclant l’herbe de la serpette et la coinçant en botte sous son bras d’un geste vif comme ses mots.
D’un même geste
rameutant une herbe ancienne
odorante et drue
son épi revêche rebiquant dans l’engloutissement de l’histoire
j’épèle pelure de mémoire et illimité de l’oubli
menant langue à contre-courant
à contre temps
à contre genre
tout contre des lointains balbutiés lettre à lettre. Quoi d’autre quand s’accouplent cycliquement la parole et la haine sinon la menue monnaie des vies, leurs bribes dans la geste dépenaillée d’une histoire qui n’existe qu’à se raconter ? Et gratte la baguette de noisetier des tumulus de terre sèche et de temps disparus
en quête de parole sourcière.
A sept ans donc, je te disais, Louise, Philippine, Noëllie gardait les chèvres et l’unique vache tarine de sa famille sur les versants pentus de la montagne alpine. Puis elle était partie de son hameau, où la terre ne nourrissait plus les petits paysans, pour devenir « bonne à tout faire » à la ville. « Bonne-à-tout-bonne-à-rien ! », riait-elle, « pauvres de nous, fillette, nous tous tant que nous sommes! » Puis, sérieuse, elle vitupérait : « Mais regarde comment on se traite. On vient de quelque part, je sais pas, de la campagne, d’une autre ville, du Maroc, du Niger, d’Italie, de Pologne et quand on est là, d’où on vient qu’est-ce que ça change? Ou alors c’est pour dire d’un village, d’une forêt, du bord d’une rivière, va savoir, il y a tellement de fleuves, de plaines, de monts, de mers et de façon de vivre de par le monde. »
Contre les murets de l’autoroute
des hommes et des femmes sont appuyés en silence
d’autres dans des squares sales de papiers et de cartons vides
les mêmes encore dans le hall de la gare
surchargés de valises
encombrés encombrants.
Louise à cet instant
c’est qui passant
dans Paris Gare de Lyon venu de où et où allant
sur des rafiots que la mer déverse dans des parcs à migrants ?
Louise n’aimait pas les sigles aseptisés ni les mots de circonstance, qu’elle n’employait jamais sans une moue de méfiance devant cette langue faite pour tenir à distance les tiers et les quarts mondes qui marchandent les hommes et découpent la planète en portions congrues. Elle en tenait dur comme fer pour son parler de paysanne qui écrivait comme ça se prononce. « Tout ça c’est pour cacher la peine du pauvre monde et pas se salir la langue avec ce qui est ! » grommelait-elle en dévalant le sentier de la colline, où habitaient ceux qui avaient fui la guerre ou la misère. « Je t’en donnerais de l’immigré et du sdf moi, bougonnait Louise, comme si c’est pas toujours les mêmes malheurs et toujours les mêmes qui en profitent ! Je te le dis, c’est pas demain la veille qu’il n’y aura plus de pauvres bougres ! » « Mais, mais, insistait-elle, haussant son petit cou trapu enfoncé dans ses épaules rondelettes en glissant les pommes talées dans son manteau, ce n’est pas une raison pour accepter. »
La voix lointaine de Louise se perd dans la cacophonie des écrans, le bavardage de la langue soumise et l’insulte internautique
le bâillon et la boue.
La vahjra yogini contemple le chahut métaphysique. Une petite langue rose de chat se lèche les babines. Dans le vague d’une pluie douce et sa pénombre, je tire bilan de faillite langagière.
Les mots ne valent pas leur investissement. Même délocalisée aux périphéries d’elle-même, la parole reste de peu de rapport avec quoi que ce soit. Son décalé déglingué ne concurrence pas le revenu d’actions risquées ni la sécurité d’obligations à rendement moindre, mais à taux garanti. Quant au poème à fonds perdus, qui s’aventurerait à en provisionner le compte? Aucun gain ne s’affiche à son crédit. C’est donc déduction faite de lui et de moi que je remplis la colonne des déficits.
À défaut de divin prêteur sur gage et de banque d’éternité où solder le troc de l’ultime, la finale sans voix ramassera la mise.
Il fait trop tard trop tôt
pour desserrer la bouche et humecter ses lèvres d’autre chose que sa salive.
Il ne et n’a. De par. Pourquoi. Avec. Pour qui.
Little Baby répète après moi. Pendant, prenant. Poussant, donnant.
Tulle fine entre les lèvres, la résille maladroite de la parole, mais existe-t-elle celle qui recoudraient les plaies, adosseraient la colère à la justice, rassemblerait l’épars et ramènerait à la bergerie l’esprit dévoyé à la gueule des loups ?
« La vie est tdure, tdure, tu verras… » murmurait Louise en faisant sonner le d comme un t, pliant le linge humide entre ses doigts usés de vieille femme.
J’ai vu. Je
vois. Terrible
mais pas la vie
seulement nous
nous autres tant que nous sommes.
À la cuisine des mots râpés jusqu’à la corde, leur balbutié malhabile de gâte-sauce, rien à manger. Si ce n’était que cette faim baillant désenchantée, passe encore, mais la famine aussi ouvre la bouche
sans son
simplement sans.
Parfois la honte d’être humain, dit-elle.
Elle s’oublie, je dis. Comme la mort. Dans l’insouciance du jardin. Le bourdonnement des abeilles et celui de l’esprit. La main courbée à la caresse. La danse indistincte de vivre.
Il fait frais soudainement. Ce courant d’air qui virevolte au dessus des habits posés à la va vite sur la chaise, soulève des corps avec eux
appelle les membres vivants
et l’ici maintenant à sa présence attentive.
Hélas, heureusement, l’oubli.
« Ingrates la vie et l’histoire, fillette ! » martelait Louise, en pétrissant la farine, et, mêlant le français au patois, elle invectivait les exploiteurs comme on disait à son époque. Les Gros qui font les guerres, les Petits qui se laissent berner, les ploutocrates et les dictateurs qui confisquent la liberté des peuples et le mot peuple claquait dans sa bouche comme un drapeau. Dans son parler dépareillé, où proverbes et tournures populaires se mêlaient à des lambeaux livresques, elle maudissait Hiller et Staline bien avant qu’il soit bon de les confondre: « Ils ont massacré tant de gens et le second, tu te rends compte, au nom d’une idée qui les faisait espérer et, et ... »
Le « et » de Louise restait suspendu à ce qu’elle ne parvenait pas à formuler. « Pouercs ! Des porcs ! » finissait-elle par gronder, se reprenant aussitôt en secouant vigoureusement la tête, « Non, il ne faut pas insulter les bêtes en donnant leur nom à des créatures pareilles ! » prononçant avec emphase et respect le mot bête, qui évoquait pour elle la richesse précieuse de la paysanne qu’elle avait été et la chaleur que les bêtes lui avaient donnée quand elle se cachait sous leurs pis pendant l’averse. « Les bêtes, elles ont jamais fait de mal à personne, mais ces créatures, ces créatures, répétait-elle, satisfaite du nom qu’elle leur avait enfin trouvé, elle vous empoisonneraient rien qu’à les toucher ! Dieu, s’il existait, devrait avoir honte de les avoir créées ! Le pauvre, s’il existait, il y a belle lurette qu’il nous aurait recommencés. »
Ainsi marmonnait Louise, dans sa langue de bric et de broc, mais qui n’y allait pas de main morte pour dire ses quatre vérités, se désolant de ne pas savoir mieux dire comme c’est long, lent, cruel, injuste les hommes et l’histoire.
Egrène son antienne l’ancienne voix
zonzon noyé dans le babil planétaire entre reality-show, business plan et sociétés offshore. Pareil le mien
dégringolant dans la fosse commune
avec les os
tandis que surgit au hublot
l’immense bidonville de Calcutta la misérable et que défilent sur l’écran, assis sur le poussier de cadavres invisibles, les visages de ceux que Louise nommait des créatures
et qui nous ressemblent
à nous
nous tous tant que nous sommes.
Courent nos langues impotentes dans la dérive des méridiens
langues lourdes de lassitude lasse
et d’impossible.
Latitude 48°51′12″ Nord - Longitude : 2°20′55″ Est enchevêtrement de vitres, de béton et d’hiver à la verticale de la ville, qui plie sous le joug d’Anankè, la vieille grecque, dont la croyance s’est éteinte remplacée par des dieux plus féroces qu’elle et rôde, avec eux, dans la balayeuse de l’histoire
où s’énumère
le vrac d’un siècle de tueries
et une stupeur stupide qui leur ressemble.
Latitude : 40°42′51″ Nord - Longitude : 74°00′21″ Ouest, stores baissés tamisant le jour et les voix triant précautionneusement leurs syllabes dans la langue prudente des cessez-le-feu, des accords et des traités. Un trépan de mots fonctionnaires et diplomates fouille la squelettique langue communicante des puissants. Son fumier. Qu’on s’accoutume à respirer comme le tas près de la soue.
Et tu souris aux éminents clients de ta langue de négociant langagier, écoutant patiemment minauder l’insignifiance, pontifier l’insignifiance, mâchant les mots pour assouplir leur trique comme Cro-Magnon le chanvre ou les peaux de bêtes entre ses chicots.
Latitude : 9°32′16″ Nord -Longitude : 13°40′38″ Ouest tu pépies sous l’effet de la méfloquine parmi des femmes en linceul noir, yeux hagards d’animal battu, dans une dérive hors de ton orbite
et du reste hors de toute orbite.
Puis tu te tais d’un coup sur cette fin de terre dévastée - sable du rivage raclé jusqu’à la roche, hectares de désastre, sida, malaria, agonie des sols rendus stériles. Dans un haut-le-cœur de la langue obligé des clichés touristique – magazines, télé, films 3D - tandis que se vante ton interlocuteur de participer à la fabrication expérimentale de barres de luzerne vitaminées distribuées au bestiau humain par avion, manne lancée du ciel de l’avenir comme du grain aux poules.
« Pauvre de nous, nous tous tant que nous sommes… », psalmodiait la vieille Louise, qui avait peu de mots pour beaucoup de vie et égrenait leur peu comme une formule magique contre le mauvais sort, qu’elle craignait moins que notre aveuglement - « Pas la peine de chercher midi à quatorze heures, c’est le nôtre, le mauvais œil, fillette, ouvre les yeux, ouvre grand les yeux… » lançait-elle, dressant des bras imprécateurs vers l’indéfini du ciel sombre, déchiré d’éclairs
et tandis qu’elle courbait les épaules sous la violence de l’orage, protégeant l’enfant entre les plis de son tablier noir piqueté de brindilles, sa voix résonnait sur le silex des adrets
obstinée insistante
tdure tdouce
emportée par la bourrasque avec tant d’autres voix anonymes
que dans le vent
encore parfois - je crois –
je les entends.
Au ventru des tulipes s’ouvrant sur les pistils
l’élan vivace et sa poussée
intense
dans le matin.
À l’horreur sa gorge mutique
dans l’ici douloureux et dérisoire de sa répétition
son grelottement de tôle tremblé
versant soudain dans la théière une louche de vie
ébouillantée.
Qu’est-ce qui reste, demande-t-elle, une fois rabattu le caquet de la parole sur son impuissance ?
Qui saura, je dis, arraisonner la langue à l’impossible ? La voilà qui se couche
chien tremblant, la queue entre les pattes
au seuil de l’inutile.
Pitié pour ceux qui s’obstinent et peinent aux mots comme au silence. En l’un et l’autre rien que nos histoires
de peu.
Dans le débris de syllabes, il y a du vrai de nous. Et toujours les démunis s’entêtent à formuler.
Je ne, je n’ai, nous ne
contre le trop grand tout de tout
dans son muet et
sa violence.
À la chute des mots dans leur déboulé de babioles, se ramasse le peu du peu au bout du bout comme pommes tombées sur le chemin.
Raconte, dit-elle
Louise, je dis, était une paysanne analphabète, née il y a plus d’un siècle dans les gorges étroites d’une vallée creusée par les moraines et les torrents. Engagée dans la Résistance, parce qu’il y a des choses que non comme elle le répétait, brassant d’un geste de la main le partout de ces choses, elle avait rejoint, dès la fin de la première guerre mondiale, le parti socialiste révolutionnaire. On disait anarchistes ou libertaires. Louise disait « nous autres tant que nous sommes» rassemblant dans sa paume petite tout ce qu’elle ignorait et tout ce qu’elle savait, sarclant l’herbe de la serpette et la coinçant en botte sous son bras d’un geste vif comme ses mots.
D’un même geste
rameutant une herbe ancienne
odorante et drue
son épi revêche rebiquant dans l’engloutissement de l’histoire
j’épèle pelure de mémoire et illimité de l’oubli
menant langue à contre-courant
à contre temps
à contre genre
tout contre des lointains balbutiés lettre à lettre. Quoi d’autre quand s’accouplent cycliquement la parole et la haine sinon la menue monnaie des vies, leurs bribes dans la geste dépenaillée d’une histoire qui n’existe qu’à se raconter ? Et gratte la baguette de noisetier des tumulus de terre sèche et de temps disparus
en quête de parole sourcière.
A sept ans donc, je te disais, Louise, Philippine, Noëllie gardait les chèvres et l’unique vache tarine de sa famille sur les versants pentus de la montagne alpine. Puis elle était partie de son hameau, où la terre ne nourrissait plus les petits paysans, pour devenir « bonne à tout faire » à la ville. « Bonne-à-tout-bonne-à-rien ! », riait-elle, « pauvres de nous, fillette, nous tous tant que nous sommes! » Puis, sérieuse, elle vitupérait : « Mais regarde comment on se traite. On vient de quelque part, je sais pas, de la campagne, d’une autre ville, du Maroc, du Niger, d’Italie, de Pologne et quand on est là, d’où on vient qu’est-ce que ça change? Ou alors c’est pour dire d’un village, d’une forêt, du bord d’une rivière, va savoir, il y a tellement de fleuves, de plaines, de monts, de mers et de façon de vivre de par le monde. »
Contre les murets de l’autoroute
des hommes et des femmes sont appuyés en silence
d’autres dans des squares sales de papiers et de cartons vides
les mêmes encore dans le hall de la gare
surchargés de valises
encombrés encombrants.
Louise à cet instant
c’est qui passant
dans Paris Gare de Lyon venu de où et où allant
sur des rafiots que la mer déverse dans des parcs à migrants ?
Louise n’aimait pas les sigles aseptisés ni les mots de circonstance, qu’elle n’employait jamais sans une moue de méfiance devant cette langue faite pour tenir à distance les tiers et les quarts mondes qui marchandent les hommes et découpent la planète en portions congrues. Elle en tenait dur comme fer pour son parler de paysanne qui écrivait comme ça se prononce. « Tout ça c’est pour cacher la peine du pauvre monde et pas se salir la langue avec ce qui est ! » grommelait-elle en dévalant le sentier de la colline, où habitaient ceux qui avaient fui la guerre ou la misère. « Je t’en donnerais de l’immigré et du sdf moi, bougonnait Louise, comme si c’est pas toujours les mêmes malheurs et toujours les mêmes qui en profitent ! Je te le dis, c’est pas demain la veille qu’il n’y aura plus de pauvres bougres ! » « Mais, mais, insistait-elle, haussant son petit cou trapu enfoncé dans ses épaules rondelettes en glissant les pommes talées dans son manteau, ce n’est pas une raison pour accepter. »
La voix lointaine de Louise se perd dans la cacophonie des écrans, le bavardage de la langue soumise et l’insulte internautique
le bâillon et la boue.
La vahjra yogini contemple le chahut métaphysique. Une petite langue rose de chat se lèche les babines. Dans le vague d’une pluie douce et sa pénombre, je tire bilan de faillite langagière.
Les mots ne valent pas leur investissement. Même délocalisée aux périphéries d’elle-même, la parole reste de peu de rapport avec quoi que ce soit. Son décalé déglingué ne concurrence pas le revenu d’actions risquées ni la sécurité d’obligations à rendement moindre, mais à taux garanti. Quant au poème à fonds perdus, qui s’aventurerait à en provisionner le compte? Aucun gain ne s’affiche à son crédit. C’est donc déduction faite de lui et de moi que je remplis la colonne des déficits.
À défaut de divin prêteur sur gage et de banque d’éternité où solder le troc de l’ultime, la finale sans voix ramassera la mise.
Il fait trop tard trop tôt
pour desserrer la bouche et humecter ses lèvres d’autre chose que sa salive.
Il ne et n’a. De par. Pourquoi. Avec. Pour qui.
Little Baby répète après moi. Pendant, prenant. Poussant, donnant.
Tulle fine entre les lèvres, la résille maladroite de la parole, mais existe-t-elle celle qui recoudraient les plaies, adosseraient la colère à la justice, rassemblerait l’épars et ramènerait à la bergerie l’esprit dévoyé à la gueule des loups ?
« La vie est tdure, tdure, tu verras… » murmurait Louise en faisant sonner le d comme un t, pliant le linge humide entre ses doigts usés de vieille femme.
J’ai vu. Je
vois. Terrible
mais pas la vie
seulement nous
nous autres tant que nous sommes.
À la cuisine des mots râpés jusqu’à la corde, leur balbutié malhabile de gâte-sauce, rien à manger. Si ce n’était que cette faim baillant désenchantée, passe encore, mais la famine aussi ouvre la bouche
sans son
simplement sans.
Parfois la honte d’être humain, dit-elle.
Elle s’oublie, je dis. Comme la mort. Dans l’insouciance du jardin. Le bourdonnement des abeilles et celui de l’esprit. La main courbée à la caresse. La danse indistincte de vivre.
Il fait frais soudainement. Ce courant d’air qui virevolte au dessus des habits posés à la va vite sur la chaise, soulève des corps avec eux
appelle les membres vivants
et l’ici maintenant à sa présence attentive.
Hélas, heureusement, l’oubli.
« Ingrates la vie et l’histoire, fillette ! » martelait Louise, en pétrissant la farine, et, mêlant le français au patois, elle invectivait les exploiteurs comme on disait à son époque. Les Gros qui font les guerres, les Petits qui se laissent berner, les ploutocrates et les dictateurs qui confisquent la liberté des peuples et le mot peuple claquait dans sa bouche comme un drapeau. Dans son parler dépareillé, où proverbes et tournures populaires se mêlaient à des lambeaux livresques, elle maudissait Hiller et Staline bien avant qu’il soit bon de les confondre: « Ils ont massacré tant de gens et le second, tu te rends compte, au nom d’une idée qui les faisait espérer et, et ... »
Le « et » de Louise restait suspendu à ce qu’elle ne parvenait pas à formuler. « Pouercs ! Des porcs ! » finissait-elle par gronder, se reprenant aussitôt en secouant vigoureusement la tête, « Non, il ne faut pas insulter les bêtes en donnant leur nom à des créatures pareilles ! » prononçant avec emphase et respect le mot bête, qui évoquait pour elle la richesse précieuse de la paysanne qu’elle avait été et la chaleur que les bêtes lui avaient donnée quand elle se cachait sous leurs pis pendant l’averse. « Les bêtes, elles ont jamais fait de mal à personne, mais ces créatures, ces créatures, répétait-elle, satisfaite du nom qu’elle leur avait enfin trouvé, elle vous empoisonneraient rien qu’à les toucher ! Dieu, s’il existait, devrait avoir honte de les avoir créées ! Le pauvre, s’il existait, il y a belle lurette qu’il nous aurait recommencés. »
Ainsi marmonnait Louise, dans sa langue de bric et de broc, mais qui n’y allait pas de main morte pour dire ses quatre vérités, se désolant de ne pas savoir mieux dire comme c’est long, lent, cruel, injuste les hommes et l’histoire.
Egrène son antienne l’ancienne voix
zonzon noyé dans le babil planétaire entre reality-show, business plan et sociétés offshore. Pareil le mien
dégringolant dans la fosse commune
avec les os
tandis que surgit au hublot
l’immense bidonville de Calcutta la misérable et que défilent sur l’écran, assis sur le poussier de cadavres invisibles, les visages de ceux que Louise nommait des créatures
et qui nous ressemblent
à nous
nous tous tant que nous sommes.
Courent nos langues impotentes dans la dérive des méridiens
langues lourdes de lassitude lasse
et d’impossible.
Latitude 48°51′12″ Nord - Longitude : 2°20′55″ Est enchevêtrement de vitres, de béton et d’hiver à la verticale de la ville, qui plie sous le joug d’Anankè, la vieille grecque, dont la croyance s’est éteinte remplacée par des dieux plus féroces qu’elle et rôde, avec eux, dans la balayeuse de l’histoire
où s’énumère
le vrac d’un siècle de tueries
et une stupeur stupide qui leur ressemble.
Latitude : 40°42′51″ Nord - Longitude : 74°00′21″ Ouest, stores baissés tamisant le jour et les voix triant précautionneusement leurs syllabes dans la langue prudente des cessez-le-feu, des accords et des traités. Un trépan de mots fonctionnaires et diplomates fouille la squelettique langue communicante des puissants. Son fumier. Qu’on s’accoutume à respirer comme le tas près de la soue.
Et tu souris aux éminents clients de ta langue de négociant langagier, écoutant patiemment minauder l’insignifiance, pontifier l’insignifiance, mâchant les mots pour assouplir leur trique comme Cro-Magnon le chanvre ou les peaux de bêtes entre ses chicots.
Latitude : 9°32′16″ Nord -Longitude : 13°40′38″ Ouest tu pépies sous l’effet de la méfloquine parmi des femmes en linceul noir, yeux hagards d’animal battu, dans une dérive hors de ton orbite
et du reste hors de toute orbite.
Puis tu te tais d’un coup sur cette fin de terre dévastée - sable du rivage raclé jusqu’à la roche, hectares de désastre, sida, malaria, agonie des sols rendus stériles. Dans un haut-le-cœur de la langue obligé des clichés touristique – magazines, télé, films 3D - tandis que se vante ton interlocuteur de participer à la fabrication expérimentale de barres de luzerne vitaminées distribuées au bestiau humain par avion, manne lancée du ciel de l’avenir comme du grain aux poules.
« Pauvre de nous, nous tous tant que nous sommes… », psalmodiait la vieille Louise, qui avait peu de mots pour beaucoup de vie et égrenait leur peu comme une formule magique contre le mauvais sort, qu’elle craignait moins que notre aveuglement - « Pas la peine de chercher midi à quatorze heures, c’est le nôtre, le mauvais œil, fillette, ouvre les yeux, ouvre grand les yeux… » lançait-elle, dressant des bras imprécateurs vers l’indéfini du ciel sombre, déchiré d’éclairs
et tandis qu’elle courbait les épaules sous la violence de l’orage, protégeant l’enfant entre les plis de son tablier noir piqueté de brindilles, sa voix résonnait sur le silex des adrets
obstinée insistante
tdure tdouce
emportée par la bourrasque avec tant d’autres voix anonymes
que dans le vent
encore parfois - je crois –
je les entends.
L'INACHEVÉ DE SOI
EXTRAIT 1
nul n’a ferré les mots à notre cœur
à sa corne
ni clouté notre langue galopant des lèvres au palais
sabot claquant sur l’os
nous avons simplement assisté à un déclin
assisté à cela qui décline sans mot
à un déclin et une douleur
quelque chose de plus inquiet que moi qui me dépasse
halètement anonyme s’essoufflant aussi dans ma poitrine
La mort. L’ennoiement de la terre. Et une misère de toute sorte. Mutique ou bavarde. Et bavarde la pire d’ici où je vis. Misère du dedans. Riche et lâche. Des débris de crevettes et de crabes crissent sous les semelles. A force du sel crisse aussi dans les yeux. J’arrête et je regarde sur le noir de l’écran qui s’éteint titillé de zébrures la nuit.
Dehors la ville sent la vase et le vin.
Non, nul n’a ferré les mots à notre cœur minuscule.
L’eau morte des canaux porte le poids du jour et
pue sous le soleil
de cette puanteur le cœur. Lui aussi pourrissant.
Puanteur pour cœur pourrissant quel baiser réveillera nos cœurs au bois dormant ?
Eau emporte la barque et mots l’image. Des deux l’unique partir. Au fil du courant pirogue sans rames.
Simplement le vent. Ou la pensée du vent. Dans sa netteté rêche. Puis la bourrasque fraîche de la sensation.
Le vent se lève comme un livre.
Tu es l’aimé ou l’aimée le corps de mes mains. Et nous nous souvenons de caresses et de plénitude de la peau. Habitée. Bâtie. Fraisée sur le décisif de vivre.
Un horizon profond soudain
sa trouée. Une droite sur un plan d’architecte.
Le vent peut être une lumière. Et par instant nous aussi éclairer.
La meule à couteaux clignotait d’étincelles dans la grange où s’installait l’aiguiseur, son cri tronqué - Aig-eur !- dans les rues du village. Puis de même dans l’usine les chalumeaux à l’arc. La fonderie. Les coulées d’acier en fusion. La braise des cheminées. Une fois l’incendie et sa langue toute déchirée. Une autre version du feu. Son immensité dépareillée.
Pareil la langue court à l’excès. Jusqu’à l’indigence. Mais c’est à peine une loupiote le feu du cœur. Un clic rouge dans sa membrane délicate, cette fine enveloppe de la vie.
Reliques dans l’ossuaire quand ressusciterez- vous le cœur dormant au bois humain ?
Le familier des cendres nous le reconnaissons. Nous le portons en nous.
Une pincée dans les veines et c’est tout le corps qui carbonise.
Une lueur de mer – car la mer a sa lumière propre distincte de celle du ciel et de la terre - une lumière maritime passe à travers la fenêtre. Dans sa déchirure nocturne. Ou son décolleté. Et c’est une visitation. Parfois spirituelle. Parfois érotique. Ou les deux abouchées. Ame offerte à l’Amant de saint Jean de La Croix. La glisse de l’infini au versant d’un glacier de lumière. La pulpe de l’être comme une figue ouverte dans la bouche. La révélation tringle dans les deux et les cinq sens. Mais s’amenuise à se dévoiler. Univoquement. Le clou traverse la cloison. La parole usée ou affûtée coupe court de la même manière.
Le vent souffle
nous n’avons aucun mot planté au cœur
juste l’obstination d’écrire qui pousse vers le clavier comme on va faire ses courses, son travail. Mener les enfants à l’école.
Ce matin une écorce d’orange dans le panier. Que je dépose là avec précaution. Offrande ou talisman. L’intensité du détail apaise. Par son saisissable. L’avenir y réchauffe ses engelures. Le lait déborde sur le gaz. Passe les prunes sous l’eau fraîche et n’oublie pas de mettre la bassine sous le robinet. L’eau est précieuse qui servira à arroser les plants de tomates et d’aubergines, le basilic et les pousses de scarole. Prend l’arrosoir pour que demain ne s’éteigne pas. Dans le noir si noir d’au delà de la nuit. L’immensité se cueille au jardin comme les fleurs de courges.
Derrière le clapier aux lapins, le museau des vigognes. Au fond du poulailler la danse des flamants cendrés sur les lacs de saumure et de souffre. Sur le lit de sable du torrent, le désert de Takla-Makan où un liséré de glace recouvre la crête des dunes.
Et vagabonde me menant au licou ma langue attelée à écrire.
(...)
EXTRAIT 2
Toujours la langue veut dire. L’air. L’eau. La terre. Les écluses du corps. Les séjours de l’esprit. L’immensité captée dans un miroir de poche. Le loin de la fenêtre vu. Ciel découpé au carreau et sa hauteur à portée de main. Lumière traversière que je traverse comme un chuchotement. Tant est naine ma taille à proportion. Instant précieux. Fugacement, sur la soie tiède d’un rai de lumière le temps voluptueux. Derrière la herse de rayons, une perfection accessible. Clarté de l’air tombée des toits pentus. Dans une communauté tactile de matière le jour, la peau. Les pigments et les pores. Respiration. Avant voir. Avant sentir. Avant être. Dans vivre. Lavé de tout.
Aux branches du langage des pendus et des fruits
jeune femme tu cueilles des crânes dans ton tablier et le jus de mangue qui coule au coin de tes lèvres est aussi de sang.
Je n’aime pas que héros ou criminels soient convoqués dans mon fourrage. Dans l’herbu de ma langue. Mais ils y sont. Guépards et gazelles éventrées à leurs griffes. Dernier rebond fiché à la pointe émeraude d’une pupille. Puma, grizzli, tigres du Bengale, loups blancs de Laponie je vous rameute en troupe totémique. Si ce n’était que vous, ce ne serait rien… mais vous allez disparaissant et nus, laissés nous sommes à nos figures humaines dépeuplées.
Plus redoutable que le carnage des crocs la cupidité. L’aseptisé des usines à mort. L’inconsistance. Dans nos cerveaux vidés à la cuillère la chaîne de l’asservissement. Et le mutique du langage tordu sur lui-même comme une crampe.
Dans le concret des jours, quelque chose se brise. Un miroir. Un vase. Une vitre. Les morceaux coupants que je ramasse dans la pelle prennent la couleur du ciel. D’un bris de visage. D’un bracelet cliquetant au poignet. D’un regard. D’une incertitude. D’un espoir peut-être. Mais c’est déjà du mot que je pousse dans la poubelle d’un coup de balayette.
L’homme est homme pour l’homme
même si je me crève prunelles et tympans je le sais. Dans tout l’empan de l’humain inhumain de l’humain. Il faudrait une absence forte. Un décalage décisif. Une voix de loutre ou de belette. Pour que cessent les mots de savoir.
Feuilles frémissantes au faîte des peupliers. Cuves d’ombre dans les cassis de la route. Et votre corbeille de bras à l’arrivée. On fait vite autre chose que penser au pire. Dans le ciment du cœur une aile de libellule. Entre les phares les deux pins jumelés de Philémon et Baucis que nous étions. Leur contours scintillent d’une poudre lunaire. Qui tombe, neige sur le pare-brise. On parle de la mort mais on ne s’y attend pas. Elle surgit par effacement.
Cela finit bizarrement une vie. D’une fin prévisible qui vient sans prévenir. Par exemple tu étais là. Et puis tu n’as plus été. J’écris mort la sachant mais ne sachant à quelle syllabe de son nom va me couper la mort pour moi plus jamais dite. Et mes jambes au repos que je ne saurais plus immobiles. Et mes jambes au. Paix à la parole. Et à son effort d’apprivoiser.
Les mots sont aussi des chiens de bord de route amenés au refuge.
- Tu mordras dans la mort comme dans une tartine, dit la vieille, sortie de sa somnolence sépulcrale.
- Ce n’est pas un quatre heure d’enfant qui m’attend Marroune. Après tout, tu en sais plus que moi là bas depuis des décennies. Comment respire la mort ? Est-ce qu’on y touche, on y voit ? Est-ce qu’on y parle encore ? L’étroit du passage finit par ouvrir une gueule d’hippopotame ou bien se rétrécit en goulet pour un filet d’âme comme au laser ? Pour les morts mourir est-ce naître ? Ca s’étend en nappe le néant ou ça se crispe en poing sur la figure ? Et splach K. O. ! Ce n’est qu’ici le ring ou bien ça continue ? Pourvu que ça ne continue pas pareil. Seulement ça. Pas éternellement pareil qu’ici. Sauf d’aimer, le reste je suis lasse.
Ainsi sont les mots d’autrefois. Avec qui on vit aussi. Le ton de nos anciennes paroles, la roulette usée d’un briquet à pierre sous le pouce. Un seau rouillé qui goutte une trace de Petit Poucet que le soleil sèche vite. L’enfance autorise au mot comme un jouet. Une balle. Une corde à sauter dans le vide. Un palet de marelle poussé d’un coup vers le ciel.
Mais il n’y a pas d’autre ogre que nos propres bouches. A leur morsures. A leurs dévorations. A leurs baisers aussi.
(...)
nul n’a ferré les mots à notre cœur
à sa corne
ni clouté notre langue galopant des lèvres au palais
sabot claquant sur l’os
nous avons simplement assisté à un déclin
assisté à cela qui décline sans mot
à un déclin et une douleur
quelque chose de plus inquiet que moi qui me dépasse
halètement anonyme s’essoufflant aussi dans ma poitrine
La mort. L’ennoiement de la terre. Et une misère de toute sorte. Mutique ou bavarde. Et bavarde la pire d’ici où je vis. Misère du dedans. Riche et lâche. Des débris de crevettes et de crabes crissent sous les semelles. A force du sel crisse aussi dans les yeux. J’arrête et je regarde sur le noir de l’écran qui s’éteint titillé de zébrures la nuit.
Dehors la ville sent la vase et le vin.
Non, nul n’a ferré les mots à notre cœur minuscule.
L’eau morte des canaux porte le poids du jour et
pue sous le soleil
de cette puanteur le cœur. Lui aussi pourrissant.
Puanteur pour cœur pourrissant quel baiser réveillera nos cœurs au bois dormant ?
Eau emporte la barque et mots l’image. Des deux l’unique partir. Au fil du courant pirogue sans rames.
Simplement le vent. Ou la pensée du vent. Dans sa netteté rêche. Puis la bourrasque fraîche de la sensation.
Le vent se lève comme un livre.
Tu es l’aimé ou l’aimée le corps de mes mains. Et nous nous souvenons de caresses et de plénitude de la peau. Habitée. Bâtie. Fraisée sur le décisif de vivre.
Un horizon profond soudain
sa trouée. Une droite sur un plan d’architecte.
Le vent peut être une lumière. Et par instant nous aussi éclairer.
La meule à couteaux clignotait d’étincelles dans la grange où s’installait l’aiguiseur, son cri tronqué - Aig-eur !- dans les rues du village. Puis de même dans l’usine les chalumeaux à l’arc. La fonderie. Les coulées d’acier en fusion. La braise des cheminées. Une fois l’incendie et sa langue toute déchirée. Une autre version du feu. Son immensité dépareillée.
Pareil la langue court à l’excès. Jusqu’à l’indigence. Mais c’est à peine une loupiote le feu du cœur. Un clic rouge dans sa membrane délicate, cette fine enveloppe de la vie.
Reliques dans l’ossuaire quand ressusciterez- vous le cœur dormant au bois humain ?
Le familier des cendres nous le reconnaissons. Nous le portons en nous.
Une pincée dans les veines et c’est tout le corps qui carbonise.
Une lueur de mer – car la mer a sa lumière propre distincte de celle du ciel et de la terre - une lumière maritime passe à travers la fenêtre. Dans sa déchirure nocturne. Ou son décolleté. Et c’est une visitation. Parfois spirituelle. Parfois érotique. Ou les deux abouchées. Ame offerte à l’Amant de saint Jean de La Croix. La glisse de l’infini au versant d’un glacier de lumière. La pulpe de l’être comme une figue ouverte dans la bouche. La révélation tringle dans les deux et les cinq sens. Mais s’amenuise à se dévoiler. Univoquement. Le clou traverse la cloison. La parole usée ou affûtée coupe court de la même manière.
Le vent souffle
nous n’avons aucun mot planté au cœur
juste l’obstination d’écrire qui pousse vers le clavier comme on va faire ses courses, son travail. Mener les enfants à l’école.
Ce matin une écorce d’orange dans le panier. Que je dépose là avec précaution. Offrande ou talisman. L’intensité du détail apaise. Par son saisissable. L’avenir y réchauffe ses engelures. Le lait déborde sur le gaz. Passe les prunes sous l’eau fraîche et n’oublie pas de mettre la bassine sous le robinet. L’eau est précieuse qui servira à arroser les plants de tomates et d’aubergines, le basilic et les pousses de scarole. Prend l’arrosoir pour que demain ne s’éteigne pas. Dans le noir si noir d’au delà de la nuit. L’immensité se cueille au jardin comme les fleurs de courges.
Derrière le clapier aux lapins, le museau des vigognes. Au fond du poulailler la danse des flamants cendrés sur les lacs de saumure et de souffre. Sur le lit de sable du torrent, le désert de Takla-Makan où un liséré de glace recouvre la crête des dunes.
Et vagabonde me menant au licou ma langue attelée à écrire.
(...)
EXTRAIT 2
Toujours la langue veut dire. L’air. L’eau. La terre. Les écluses du corps. Les séjours de l’esprit. L’immensité captée dans un miroir de poche. Le loin de la fenêtre vu. Ciel découpé au carreau et sa hauteur à portée de main. Lumière traversière que je traverse comme un chuchotement. Tant est naine ma taille à proportion. Instant précieux. Fugacement, sur la soie tiède d’un rai de lumière le temps voluptueux. Derrière la herse de rayons, une perfection accessible. Clarté de l’air tombée des toits pentus. Dans une communauté tactile de matière le jour, la peau. Les pigments et les pores. Respiration. Avant voir. Avant sentir. Avant être. Dans vivre. Lavé de tout.
Aux branches du langage des pendus et des fruits
jeune femme tu cueilles des crânes dans ton tablier et le jus de mangue qui coule au coin de tes lèvres est aussi de sang.
Je n’aime pas que héros ou criminels soient convoqués dans mon fourrage. Dans l’herbu de ma langue. Mais ils y sont. Guépards et gazelles éventrées à leurs griffes. Dernier rebond fiché à la pointe émeraude d’une pupille. Puma, grizzli, tigres du Bengale, loups blancs de Laponie je vous rameute en troupe totémique. Si ce n’était que vous, ce ne serait rien… mais vous allez disparaissant et nus, laissés nous sommes à nos figures humaines dépeuplées.
Plus redoutable que le carnage des crocs la cupidité. L’aseptisé des usines à mort. L’inconsistance. Dans nos cerveaux vidés à la cuillère la chaîne de l’asservissement. Et le mutique du langage tordu sur lui-même comme une crampe.
Dans le concret des jours, quelque chose se brise. Un miroir. Un vase. Une vitre. Les morceaux coupants que je ramasse dans la pelle prennent la couleur du ciel. D’un bris de visage. D’un bracelet cliquetant au poignet. D’un regard. D’une incertitude. D’un espoir peut-être. Mais c’est déjà du mot que je pousse dans la poubelle d’un coup de balayette.
L’homme est homme pour l’homme
même si je me crève prunelles et tympans je le sais. Dans tout l’empan de l’humain inhumain de l’humain. Il faudrait une absence forte. Un décalage décisif. Une voix de loutre ou de belette. Pour que cessent les mots de savoir.
Feuilles frémissantes au faîte des peupliers. Cuves d’ombre dans les cassis de la route. Et votre corbeille de bras à l’arrivée. On fait vite autre chose que penser au pire. Dans le ciment du cœur une aile de libellule. Entre les phares les deux pins jumelés de Philémon et Baucis que nous étions. Leur contours scintillent d’une poudre lunaire. Qui tombe, neige sur le pare-brise. On parle de la mort mais on ne s’y attend pas. Elle surgit par effacement.
Cela finit bizarrement une vie. D’une fin prévisible qui vient sans prévenir. Par exemple tu étais là. Et puis tu n’as plus été. J’écris mort la sachant mais ne sachant à quelle syllabe de son nom va me couper la mort pour moi plus jamais dite. Et mes jambes au repos que je ne saurais plus immobiles. Et mes jambes au. Paix à la parole. Et à son effort d’apprivoiser.
Les mots sont aussi des chiens de bord de route amenés au refuge.
- Tu mordras dans la mort comme dans une tartine, dit la vieille, sortie de sa somnolence sépulcrale.
- Ce n’est pas un quatre heure d’enfant qui m’attend Marroune. Après tout, tu en sais plus que moi là bas depuis des décennies. Comment respire la mort ? Est-ce qu’on y touche, on y voit ? Est-ce qu’on y parle encore ? L’étroit du passage finit par ouvrir une gueule d’hippopotame ou bien se rétrécit en goulet pour un filet d’âme comme au laser ? Pour les morts mourir est-ce naître ? Ca s’étend en nappe le néant ou ça se crispe en poing sur la figure ? Et splach K. O. ! Ce n’est qu’ici le ring ou bien ça continue ? Pourvu que ça ne continue pas pareil. Seulement ça. Pas éternellement pareil qu’ici. Sauf d’aimer, le reste je suis lasse.
Ainsi sont les mots d’autrefois. Avec qui on vit aussi. Le ton de nos anciennes paroles, la roulette usée d’un briquet à pierre sous le pouce. Un seau rouillé qui goutte une trace de Petit Poucet que le soleil sèche vite. L’enfance autorise au mot comme un jouet. Une balle. Une corde à sauter dans le vide. Un palet de marelle poussé d’un coup vers le ciel.
Mais il n’y a pas d’autre ogre que nos propres bouches. A leur morsures. A leurs dévorations. A leurs baisers aussi.
(...)