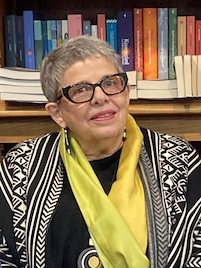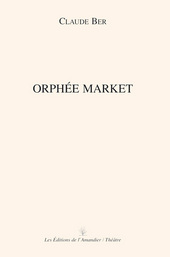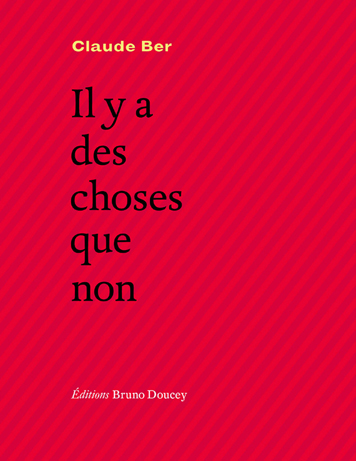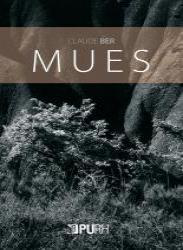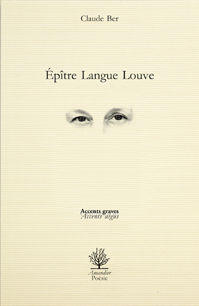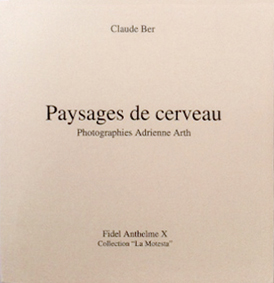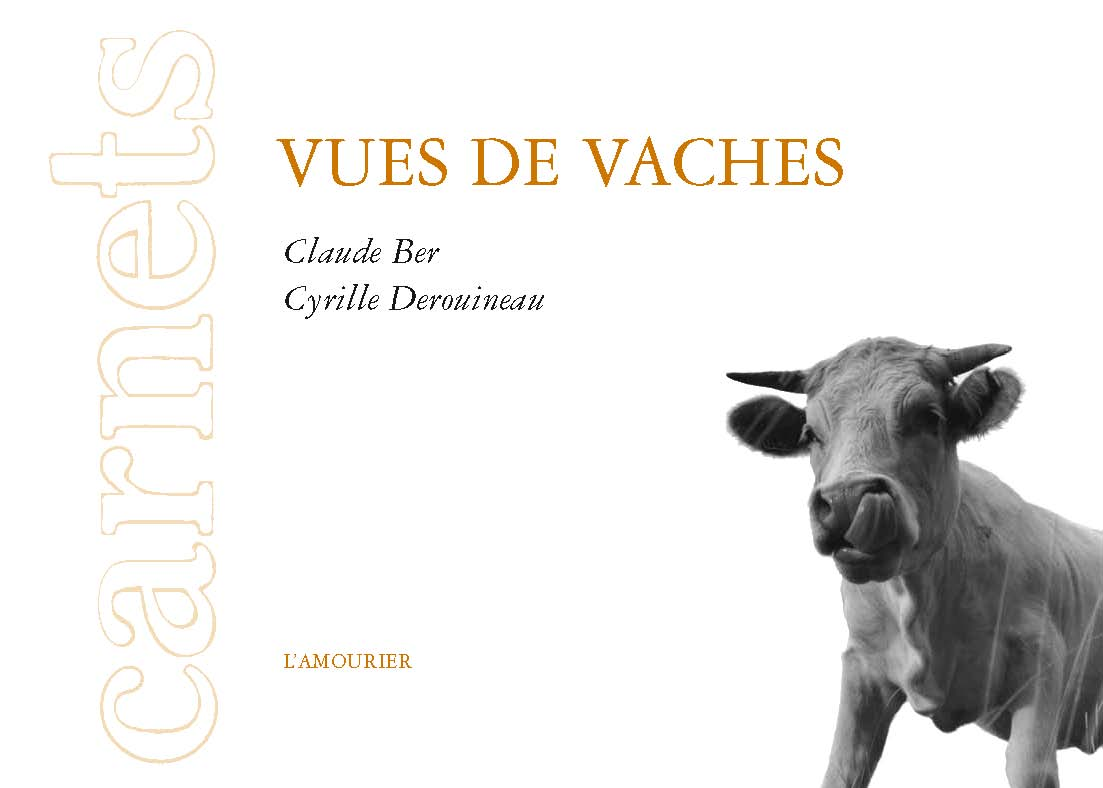REVUE EUROPE AVRIL 2010 par Marie-Claire BANCQUART
Claude BER, Pierre DUBRUNQUEZ: L'Inachevé de soi (éditions de l'Amandier, 25 €)
Auteur et peintre signent conjointement ce livre, qui présente de beaux "tableaux rêvés" de Pierre Dubrunquez, à la poursuite, écrit-il, de ce "reste" qu'on n'atteint jamais, dans aucune forme d'art . "Figures de vent et d'eau qui ne me sont pas un sujet, un mobile plutôt", elles correspondent fort bien à un texte qui cherche en effet à exprimer ce qui est par nature insaisissable, le "pourquoi" de notre vie et de notre mort, le "comment" et les limites des mots, à travers de minces choses pourtant fondamentales. "Misère du dedans. Riche et lâche. Des débris de crevettes et de crabes crissent sous les semelles. A force du sel crisse aussi dans les yeux."
La méditerranéenne Claude Ber sait dire fortement , à travers des souvenirs de village , de ménage, de jardin arrosé, la splendeur et la misère mêlées, comme d'autre part sont mêlés le mystique et l'érotique . Jean de la Croix est évoqué avec "la pulpe de l'être comme une figue ouverte dans la bouche" . Les mains lavent un verre ,pendant que la "tête montgolfière" s'en va vers les "fractals, les neutrinos". "L'éveil l'espace d'une assiette qui goutte sur l'évier.Le satori en lavant la vaisselle". Cette pensée mystique et matérielle à la fois n'est pas, ne peut pas être repliée sur elle-même. Les mots de poésie sont bien obligés d'admettre le meurtre universel, celui des animaux entre eux, et celui que la cupidité des "usines à mort" inflige aux hommes. Donc, ces mots souffrent d'une terrible insuffisance "dans tout l'empan inhumain de l'humain". Et ils souffrent aussi d'une mort plus personnellement cruelle à Claude Ber, qu'elle a évoquée dans son recueil de 2004, La mort n'est jamais comme . On rêve d'un orage dans le "gris" duquel demeurer, sans mots, dans un apaisement de voix, de corps… On rêve de "s'écarter. Faire écart et s'écarter. Au grand écart de la langue;"
Mais "vivre n'est accordé que par intermittence", et l'on revient à la "parole provisoire". Qui évoque aussi le père, les vieilles de la famille: autant de disparus. Comme les Anciens jetaient un pierre dans l'ombre du premier vivant qui s'approchait d'une construction en cours, puis emmuraient ce vivant, la parole évoque tous ces défunts. Ainsi les pierres tombales portent les surnoms évocateurs de ceux qui ont disparu.
Et celle qui écrit ,elle aussi, prend part à "l'humanité carnassière" en cueillant camomille et verveine, en empalant les coquillages "crus sur les canines". Décidément "Le coeur des mots ne bat pas dans le nôtre". Sans doute, ces mots ont leur ardeur… Mais ils sont "grignotage de furet" .Les lieux du souvenir: un portail, des herbes, des fleurs sauvages , "la clef de la porte la légère odeur de moisi , le paquet de soleil chaud comme un pain posé sur la table", sont chaleureusement ressuscités par eux. Mais l'âme ne s'apaise pas où le regard trouve refuge…"Aucune laisse ne te lie à la meute des mots que tu siffles".Le livre se termine comme une pièce de théâtre à la fin de laquelle est évoquée "la barque d'Ulysse rentrée au port avec son tangage de mémoire. Ses flancs repus d'aventures. Ses possibles à narrer . L'inabouti increvable". Puis c'est l'exhortation aux spectateurs .."Applaudissez sans réserve"...Mais pour finir, "Le meilleur s'arrête en nous et y demeure"… L'inachevé de soi : un beau texte très dense, très dur, parsemé de sentences fortes et désespérées, et à la fois un texte ensoleillé, plein de la saveur des choses . On souhaite l'entendre, appuyé de la voix et du geste, mais on le découvre autrement et plus posément à la lecture, rythmé par les toiles fortes et éclatées de Pierre Dubrunquez.
POEZIBAO 24 mars 2010
par Alexis Pelletier
L'Inachevé de soi, de Claude Ber et Pierre Dubrunquez (lecture d'Alexis Pelletier)
Poésie et peinture. Point n’est besoin d’une très grande érudition pour savoir que la rencontre est nourrie d’une longue histoire, à tous les sens de ce substantif qui remonte, notamment à Horace, dont on me permettra de rappeler les vers de son Art poétique (V, 361- 365) :
Un poème est comme une peinture. L’une te séduira davantage
te tenant auprès d’elle, et l’autre, si tu t’éloignes.
L’une aime l’obscurité, l’autre voudra la pleine lumière,
Ne redoutant point le regard acéré du critique.
L’une ne plait qu’une fois, quand l’autre plait encore, après dix fois.
C’est le fameux « Ut pictura poesis », que je traduis sans doute approximativement et qui me paraît l’enjeu de cette rencontre entre Claude Ber et Pierre Dubrunquez.
À première vue et à première lecture, si je peux dire : non, le poème (de Claude Ber) n’est pas comme la peinture (de Pierre Dubrunquez). Cette dernière crée l’évidence de la rapidité du geste, en désignant une quête de la figuration que certains poètes appelleraient peut-être présence et qui pour le peintre renvoie à l’idée d’une figuration voire d’une œuvre originelle perdues. Et, de son côté, la poésie de Claude Ber est celle d’une abondance figurative qui, de références en souvenirs fait signe vers ce que j’appellerai la raréfaction d’un verbe, unissant, au-delà de l’expérience terrestre de la mort, l’amour et l’enfance : « Le mot est un lièvre dont on attend le bond ». Pour me faire comprendre, la peinture désigne, sans ambiguïté, une sorte d’ascèse du travail, tandis que la poésie ouvre l’éventail de sensations délibérément liées à la terre. Mais ce constat ne signifie pas que la rencontre n’a pas lieu. Au contraire même, une fois que les différences sont nommées, elle se produit. Et de pouvoir même avoir le sentiment que le poème est comme la peinture et vice-versa. Les œuvres de Pierre Dubrunquez sont, dans cet ouvrage, celles d’une répétition et d’une profusion qui fait apparaître la figure humaine. Entre elles se créent comme un dialogue, un écho qui provoquent une sorte de surgissement du trait et de la matière, quelque chose qui dit, en somme, « l’illusion du nécessaire ». Or cette dernière expression, qui me semble établir un rapport de justesse avec la peinture vient du poème de Claude Ber. Et, à chaque page du poème la même impression se produit : poème et peinture se complètent, s’interpénètrent. C’est un vrai dialogue amoureux, c’est-à-dire un dialogue conscient de l’irréductibilité des différences entre les deux arts. Et de quoi « parle » ce dialogue. Une phrase comme un long vers permet peut-être de le saisir : « Il est dur de dire le simple, l’émotion ténue, la crainte que demain nous ne détruisions l’entier de la terre et pour la première fois peut-être l’angoisse de la mort de l’espèce plus grande que celle de sa propre mort. » (p.13) C’est notre époque qui est en jeu, dans la nécessité d’être toujours présents à elle, même à ce qu’elle tient de plus tragique. Peinture et poème « disent » le risque, non pas de l’improvisation dans l’époque, mais de la disponibilité. D’où cette forme du poème qui décline les possibles de la prose. Parfois celle-ci est très limpide (j’aurais voulu dire « libre » si ce n’était faire signe vers un ensemble trop vaste, le vers libre) : « Une lueur de mer – car la mer a sa lumière propre distincte de celle du ciel et de la terre – une lumière maritime passe à travers la fenêtre. Dans sa déchirure nocturne. Ou son décolleté. Et c’est une visitation. Parfois spirituelle. Parfois érotique. Ou les deux abouchées. » (p.12). Parfois cette prose devient vers, dans un énoncé qui touche à la grande morale : « Ne répète pas. / Ne récite pas. / N’implore pas. // Va droit. » Et le parcours du livre, dans ce dialogue entre peinture et poème a bien lié les deux expressions, les a confondues tout en maintenant les différences. Ainsi L’inachevé de soi est une chance : « Le meilleur s’arrête en nous et y demeure. » (p.41)
L’eau morte des canaux porte le poids du jour et
pue sous le soleil
de ce puanteur le cœur. Lui aussi est pourrissant.
Puanteur pour cœur pourrissant quel baiser réveillera nos cœurs au bois dormant ?
Eau emporte la barque et mots l’image. Des deux l’unique partir. Au fil du courant pirogue sans rames.
Simplement le vent. Ou la pensée du vent. Dans sa netteté rêche. Puis la bourrasque fraîche de la sensation.
Le vent se lève comme un livre.
Tu es l’aimé ou l’aimée le corps de mes mains. Et nous nous souvenons de caresses et de plénitude de la peau. Habitée. Bâtie. Fraisée sur le décisif de vivre.
Un horizon profond soudain
sa trouée. Une droite sur un plan d’architecte.
Le vent peut être une lumière. Et par instant nous aussi éclairer.
Revue de la maison de la Poésie de Saint Quentin en Yvelines
par Jacques Fournier
L’inachevé de soi
Claude Ber et Pierre Dubrunquez
Édition De l’Amandier, coll. Le Voir dit, 2010, 48 p., 25 €
© Le Voir Dit
Il s’agit bien d’une œuvre commune du poète Claude Ber et du peintre Pierre Dubrunquez. Parce que, jamais (sauf page 21, un corps esquissé au trait occupant le vide de la demi-page blanche) les œuvres du peintre ne viennent illustrées le texte, ni le texte faire redondance aux peintures. La mise en page propose une parfaite alternance (deux pages de texte, deux pages de peinture) laissant ainsi au lecteur le choix. Le titre même dit bien l’un et l’autre. Dans la peinture de Pierre Dubrunquez, l’inachevé des corps, fantomatiques dans des espaces où semblent (mais rien n’est jamais sûr) dominer le végétal. Corps en apparition ou en disparition ? Corps en mouvement, le plus souvent, laissant s’imprimer sur la toile des traces comme autant d’atomes échappés d’un tout qui serait un corps, en décomposition ? en recomposition ? Le texte aussi dit cet inachevé du corps (C’est à peine une loupiote le feu du cœur), du vivre qui n’est accordé que par intermittence et parce qu’on parle de la mort, mais on ne s’y attend pas. Elle surgit par effacement. Et le poète au verbe fluide tente cette composition, cette recomposition, par l’appel aux vivants épelés par la langue trieuse des registres et des pierres tombales (suit un bestiaire sonore des plus jouissifs à dire), par l’évocation des gestes anciens, rituels des vieux de Toscane qui jetaient une pierre à l’ombre du premier vivant qui s’approchait de leur maison en construction, et des gestes appris (Passe les prunes sous l’eau fraîche et n’oublie pas de mettre la bassine sous le robinet. L’eau est précieuse qui servira à arroser (…)), par l’incantation cyclique à la langue qui, ici court à l’excès, là est une torche qui brûle aussi sous l’eau. Mais au final, il n’y a pas de puits de langue où puiser parole qui désaltère. Alors, le poète, s’adressant tant à elle-même qu’à l’homme en tant qu’espèce (dont l’angoisse de la mort est pour la première fois plus grande que celle de sa propre mort), tout en sachant qu’à te nommer tu disparais, parce que cela est inéluctable, nourrissant sa réflexion de son quotidien parfois le plus trivial et/ou le plus banal, nous jette en dernier conseil : Applaudissez sans réserve. Cela n’a pas éternellement lieu, parce que le meilleur s’arrête en nous et y demeure. Même inachevé (et parce que l’inabouti est increvable), vivons puisqu’il nous faut mourir.
TERRES DE FEMMES
par Angèle Paoli
Claude Ber, Pierre Dubrunquez, L’Inachevé de soi,
Éditions de l’Amandier, Collection Le Voir Dit, 2009.
Pierre-DUBRUNQUEZ-Gisant-huile-sur-toile
Pierre Dubrunquez, Étude pour un gisant, 2007,
Huile sur toile, 146 x 114 cm
Collection particulière
in L’Inachevé de soi, page 31.
LE DÉCISIF DE VIVRE
C’est peut-être l’arrondi d’un ventre, cercle de blancheur troué en son centre par l’oculus du nombril et, tout autour de cet espace de rondeur, des flammèches folles qui s’échevèlent dans les blancs les gris les mauves. Un œuf chevelu émerge de son nid ou de plus loin encore. D’un sommeil des origines. C’est en réalité ― étrange réalité à dire ― le détail d’une huile sur toile. Étude pour un autoportrait. Avec ce détail, fragment d’une œuvre picturale de Pierre Dubrunquez, le peintre cosigne, en complicité artiste, L’Inachevé de soi, poème épico-intime de Claude Ber. L’ouvrage, pris dans son entier d’œuf primordial recomposé, est un incessant questionnement sur la plénitude perdue. La nécessité de dire pour tenter une percée au-delà du miroir. Le désir d’aller au-devant de ce « quelque chose de plus inquiet que moi qui me dépasse ». Et pour chacun des deux artistes, le poète et le peintre, le désir de mettre en résonance, dans la plus grande exigence, leur interrogation duelle du monde, cet « ennoiement de la terre », sans masque sans grimage, sans faux-semblant. À travers la corporéité du geste, inhérente à l’ouvrage du peintre et avec l’écriture, cette « juste obstination d’écrire qui pousse vers le clavier… ». Alternance et altérité se répondent se joignent, échos de sens et de partage. Une lecture en « vis-à-vis » qui demande au lecteur de cet échange une « posture d’éveil et d’attente. » Entre la matière des mots et la peinture. Indices de présence.
De ce travail complice du poète et du peintre, lequel précède l’autre ? Le « Dit » ou le « Voir » ? Il semble, à explorer ce « chantier de l’inachevé de soi », que s’abolisse l’interrogation première. Pour laisser place au regard dialogué des deux artistes, à leur interprétation contrapunctique du monde. Ce que l’un tente d’approcher par le travail tourmenté de la matière, l’autre le sonde à travers le forage des mots. Car le monde toujours se dérobe à nos sens amoindris. Et ce qu’il peut donner à entendre ou à voir ne peut s’appréhender en profondeur sans la médiation de l’art.
« L’homme n’est pas sûr de connaître le monde, de le voir, de l’entendre. Sinon il n’y aurait pas de peinture, de poésie, de musique ». Ainsi s’exprime Roger Munier dans l’exergue qui préside à l’ouverture de l’ouvrage partagé de Claude Ber et de Pierre Dubrunquez.
Photographiées par Jean-Marc Robion et Alain Hatat, les huiles sur toile de Pierre Dubrunquez sont habitées par les éléments. L’air et l’eau. L’averse bleue. Les Vents. Les toiles sans titre, elles aussi, rendent visibles leurs batailles, leurs mouvements, leurs zones d’incandescence et d’affrontements, leurs flottements dans l’espace. À la fois légère et dense, combative et fluide, la peinture de Pierre Dubrunquez, où joutent les bleus et les gris les blancs et les verts les marrons et les noirs, incite à la rêverie. Une rêverie aérienne menée en sarabande par toute une flottaison de particules, de têtards filandreux follicules fendant la masse liquide des couleurs, se frayant un passage sous les lianes qui zèbrent l’espace. Dans l’air tourbillonnant des tempêtes, au-delà des cercles mouvants d’où elles semblent surgir, les formes ovulaires remontent, ondulantes, vers la surface des eaux et l’en-deçà des airs. Tandis que La grande réserve tient serrés dans sa dure verticalité les éléments en germination. Taches et ovules, filaments drus qui tentent, ascensionnels, une évasion sur la toile.
Sans titre, les gouaches aquarellées, ébauches de danseurs ou de lutteurs, ombres en mouvement, hantent l’espace vide. Silhouettes inachevées. D’autres huiles sur toile imposent au regard les combats tourmentés que se livrent les corps. Palpables à l’œil, ils sculptent leurs formes à même la matière, dans l’attente peut-être de s’en dégager pour atteindre une forme accomplie. Les études enfin ― dont seul le titre oriente la lecture ― Étude d’après Poussin, Étude pour un gisant, Étude pour une mise au tombeau ― suggèrent l’inachèvement de l’œuvre davantage que le sujet qu’elle est censée aborder. Le désir de l’œuvre, la recherche qu’elle génère semblent compter davantage que l’œuvre aboutie. Sans doute l’essentiel de ce qui hante le peintre gît-il dans l’inaccompli. Cet inaccompli qui toujours insiste et sans cesse incite le peintre, « homme qui marche dans les images », à forcer son geste, toujours, dans les mêmes « retouches ». Pour se tenir debout. Ne pas s’égarer en elles.
L’écriture de Claude Ber, toute de mouvement et de tourbillons, est une écriture magicienne. Exploratrice des hauts-fonds, la langue du poète est comme la vague qui déferle, violente, imprévisible, et ramène sous elle, entre flux et reflux, mille trésors. Qu’elle dépose en offrande sur la page. Ou pique en « talisman ». Tout un théâtre de l’intime, mélange de tendresse et de subtile cruauté, est ramené ainsi, dans « l’herbu » de la langue. Images de l’enfance, lovées dans « l’intensité du détail ». Menues choses, expériences brèves, dont « la simplicité brûle aussi. » Amour : « Tu es l’aimé ou l’aimée le corps de mes mains. ». Évocation de ce qui fut, ces « deux pins jumelés de Philémon et Baucis que nous étions ». Et mort. Incompréhension de l’expérience liée à la mort. « Par exemple tu étais là. Et puis tu n’as plus été. J’écris mort la sachant mais ne sachant quelle syllabe de son nom va me couper la mort pour moi plus jamais dite. » Émotion à lire cet aveu. La mort n’est jamais comme n’est jamais loin.
Ailleurs, cosmique, multiple, visionnaire, la langue du poète, « autre version du feu », « court à l’excès ». Attachée en fureur aux éléments, elle « rameute en troupes totémiques » guépards et gazelles, puma, grizzli, tigres du Bengale, loups blancs de Laponie, dont la disparition prochaine signera le désaffection de l’homme : « laissés nous sommes à nos figures humaines dépeuplées. » Pareille à la divinité qui nomme, le poète convoque dans La Ténèbre qui « rassemble dans ses mailles », la multitude des poissons. Formes et noms étranges surgissent « dans le tunnel qui nous relie au rien ». Puis s’éteignent dans le silence. Car le silence existe aussi dans l’écriture de Claude Ber. Ne serait-ce que parce que le poète s’arrête pour interroger la langue, interroger le dire. « Dire est dur, je dis, qui cherche appui sur l’insaisissable ».Vertige à essayer de dire, à s’en tenir à dire :
« Simplement le vent. Ou la pensée du vent. »
« Fraisée sur le décisif de vivre. ».
Angèle Paoli, site Terres de Femmes, 2010
Claude BER, Pierre DUBRUNQUEZ: L'Inachevé de soi (éditions de l'Amandier, 25 €)
Auteur et peintre signent conjointement ce livre, qui présente de beaux "tableaux rêvés" de Pierre Dubrunquez, à la poursuite, écrit-il, de ce "reste" qu'on n'atteint jamais, dans aucune forme d'art . "Figures de vent et d'eau qui ne me sont pas un sujet, un mobile plutôt", elles correspondent fort bien à un texte qui cherche en effet à exprimer ce qui est par nature insaisissable, le "pourquoi" de notre vie et de notre mort, le "comment" et les limites des mots, à travers de minces choses pourtant fondamentales. "Misère du dedans. Riche et lâche. Des débris de crevettes et de crabes crissent sous les semelles. A force du sel crisse aussi dans les yeux."
La méditerranéenne Claude Ber sait dire fortement , à travers des souvenirs de village , de ménage, de jardin arrosé, la splendeur et la misère mêlées, comme d'autre part sont mêlés le mystique et l'érotique . Jean de la Croix est évoqué avec "la pulpe de l'être comme une figue ouverte dans la bouche" . Les mains lavent un verre ,pendant que la "tête montgolfière" s'en va vers les "fractals, les neutrinos". "L'éveil l'espace d'une assiette qui goutte sur l'évier.Le satori en lavant la vaisselle". Cette pensée mystique et matérielle à la fois n'est pas, ne peut pas être repliée sur elle-même. Les mots de poésie sont bien obligés d'admettre le meurtre universel, celui des animaux entre eux, et celui que la cupidité des "usines à mort" inflige aux hommes. Donc, ces mots souffrent d'une terrible insuffisance "dans tout l'empan inhumain de l'humain". Et ils souffrent aussi d'une mort plus personnellement cruelle à Claude Ber, qu'elle a évoquée dans son recueil de 2004, La mort n'est jamais comme . On rêve d'un orage dans le "gris" duquel demeurer, sans mots, dans un apaisement de voix, de corps… On rêve de "s'écarter. Faire écart et s'écarter. Au grand écart de la langue;"
Mais "vivre n'est accordé que par intermittence", et l'on revient à la "parole provisoire". Qui évoque aussi le père, les vieilles de la famille: autant de disparus. Comme les Anciens jetaient un pierre dans l'ombre du premier vivant qui s'approchait d'une construction en cours, puis emmuraient ce vivant, la parole évoque tous ces défunts. Ainsi les pierres tombales portent les surnoms évocateurs de ceux qui ont disparu.
Et celle qui écrit ,elle aussi, prend part à "l'humanité carnassière" en cueillant camomille et verveine, en empalant les coquillages "crus sur les canines". Décidément "Le coeur des mots ne bat pas dans le nôtre". Sans doute, ces mots ont leur ardeur… Mais ils sont "grignotage de furet" .Les lieux du souvenir: un portail, des herbes, des fleurs sauvages , "la clef de la porte la légère odeur de moisi , le paquet de soleil chaud comme un pain posé sur la table", sont chaleureusement ressuscités par eux. Mais l'âme ne s'apaise pas où le regard trouve refuge…"Aucune laisse ne te lie à la meute des mots que tu siffles".Le livre se termine comme une pièce de théâtre à la fin de laquelle est évoquée "la barque d'Ulysse rentrée au port avec son tangage de mémoire. Ses flancs repus d'aventures. Ses possibles à narrer . L'inabouti increvable". Puis c'est l'exhortation aux spectateurs .."Applaudissez sans réserve"...Mais pour finir, "Le meilleur s'arrête en nous et y demeure"… L'inachevé de soi : un beau texte très dense, très dur, parsemé de sentences fortes et désespérées, et à la fois un texte ensoleillé, plein de la saveur des choses . On souhaite l'entendre, appuyé de la voix et du geste, mais on le découvre autrement et plus posément à la lecture, rythmé par les toiles fortes et éclatées de Pierre Dubrunquez.
POEZIBAO 24 mars 2010
par Alexis Pelletier
L'Inachevé de soi, de Claude Ber et Pierre Dubrunquez (lecture d'Alexis Pelletier)
Poésie et peinture. Point n’est besoin d’une très grande érudition pour savoir que la rencontre est nourrie d’une longue histoire, à tous les sens de ce substantif qui remonte, notamment à Horace, dont on me permettra de rappeler les vers de son Art poétique (V, 361- 365) :
Un poème est comme une peinture. L’une te séduira davantage
te tenant auprès d’elle, et l’autre, si tu t’éloignes.
L’une aime l’obscurité, l’autre voudra la pleine lumière,
Ne redoutant point le regard acéré du critique.
L’une ne plait qu’une fois, quand l’autre plait encore, après dix fois.
C’est le fameux « Ut pictura poesis », que je traduis sans doute approximativement et qui me paraît l’enjeu de cette rencontre entre Claude Ber et Pierre Dubrunquez.
À première vue et à première lecture, si je peux dire : non, le poème (de Claude Ber) n’est pas comme la peinture (de Pierre Dubrunquez). Cette dernière crée l’évidence de la rapidité du geste, en désignant une quête de la figuration que certains poètes appelleraient peut-être présence et qui pour le peintre renvoie à l’idée d’une figuration voire d’une œuvre originelle perdues. Et, de son côté, la poésie de Claude Ber est celle d’une abondance figurative qui, de références en souvenirs fait signe vers ce que j’appellerai la raréfaction d’un verbe, unissant, au-delà de l’expérience terrestre de la mort, l’amour et l’enfance : « Le mot est un lièvre dont on attend le bond ». Pour me faire comprendre, la peinture désigne, sans ambiguïté, une sorte d’ascèse du travail, tandis que la poésie ouvre l’éventail de sensations délibérément liées à la terre. Mais ce constat ne signifie pas que la rencontre n’a pas lieu. Au contraire même, une fois que les différences sont nommées, elle se produit. Et de pouvoir même avoir le sentiment que le poème est comme la peinture et vice-versa. Les œuvres de Pierre Dubrunquez sont, dans cet ouvrage, celles d’une répétition et d’une profusion qui fait apparaître la figure humaine. Entre elles se créent comme un dialogue, un écho qui provoquent une sorte de surgissement du trait et de la matière, quelque chose qui dit, en somme, « l’illusion du nécessaire ». Or cette dernière expression, qui me semble établir un rapport de justesse avec la peinture vient du poème de Claude Ber. Et, à chaque page du poème la même impression se produit : poème et peinture se complètent, s’interpénètrent. C’est un vrai dialogue amoureux, c’est-à-dire un dialogue conscient de l’irréductibilité des différences entre les deux arts. Et de quoi « parle » ce dialogue. Une phrase comme un long vers permet peut-être de le saisir : « Il est dur de dire le simple, l’émotion ténue, la crainte que demain nous ne détruisions l’entier de la terre et pour la première fois peut-être l’angoisse de la mort de l’espèce plus grande que celle de sa propre mort. » (p.13) C’est notre époque qui est en jeu, dans la nécessité d’être toujours présents à elle, même à ce qu’elle tient de plus tragique. Peinture et poème « disent » le risque, non pas de l’improvisation dans l’époque, mais de la disponibilité. D’où cette forme du poème qui décline les possibles de la prose. Parfois celle-ci est très limpide (j’aurais voulu dire « libre » si ce n’était faire signe vers un ensemble trop vaste, le vers libre) : « Une lueur de mer – car la mer a sa lumière propre distincte de celle du ciel et de la terre – une lumière maritime passe à travers la fenêtre. Dans sa déchirure nocturne. Ou son décolleté. Et c’est une visitation. Parfois spirituelle. Parfois érotique. Ou les deux abouchées. » (p.12). Parfois cette prose devient vers, dans un énoncé qui touche à la grande morale : « Ne répète pas. / Ne récite pas. / N’implore pas. // Va droit. » Et le parcours du livre, dans ce dialogue entre peinture et poème a bien lié les deux expressions, les a confondues tout en maintenant les différences. Ainsi L’inachevé de soi est une chance : « Le meilleur s’arrête en nous et y demeure. » (p.41)
L’eau morte des canaux porte le poids du jour et
pue sous le soleil
de ce puanteur le cœur. Lui aussi est pourrissant.
Puanteur pour cœur pourrissant quel baiser réveillera nos cœurs au bois dormant ?
Eau emporte la barque et mots l’image. Des deux l’unique partir. Au fil du courant pirogue sans rames.
Simplement le vent. Ou la pensée du vent. Dans sa netteté rêche. Puis la bourrasque fraîche de la sensation.
Le vent se lève comme un livre.
Tu es l’aimé ou l’aimée le corps de mes mains. Et nous nous souvenons de caresses et de plénitude de la peau. Habitée. Bâtie. Fraisée sur le décisif de vivre.
Un horizon profond soudain
sa trouée. Une droite sur un plan d’architecte.
Le vent peut être une lumière. Et par instant nous aussi éclairer.
Revue de la maison de la Poésie de Saint Quentin en Yvelines
par Jacques Fournier
L’inachevé de soi
Claude Ber et Pierre Dubrunquez
Édition De l’Amandier, coll. Le Voir dit, 2010, 48 p., 25 €
© Le Voir Dit
Il s’agit bien d’une œuvre commune du poète Claude Ber et du peintre Pierre Dubrunquez. Parce que, jamais (sauf page 21, un corps esquissé au trait occupant le vide de la demi-page blanche) les œuvres du peintre ne viennent illustrées le texte, ni le texte faire redondance aux peintures. La mise en page propose une parfaite alternance (deux pages de texte, deux pages de peinture) laissant ainsi au lecteur le choix. Le titre même dit bien l’un et l’autre. Dans la peinture de Pierre Dubrunquez, l’inachevé des corps, fantomatiques dans des espaces où semblent (mais rien n’est jamais sûr) dominer le végétal. Corps en apparition ou en disparition ? Corps en mouvement, le plus souvent, laissant s’imprimer sur la toile des traces comme autant d’atomes échappés d’un tout qui serait un corps, en décomposition ? en recomposition ? Le texte aussi dit cet inachevé du corps (C’est à peine une loupiote le feu du cœur), du vivre qui n’est accordé que par intermittence et parce qu’on parle de la mort, mais on ne s’y attend pas. Elle surgit par effacement. Et le poète au verbe fluide tente cette composition, cette recomposition, par l’appel aux vivants épelés par la langue trieuse des registres et des pierres tombales (suit un bestiaire sonore des plus jouissifs à dire), par l’évocation des gestes anciens, rituels des vieux de Toscane qui jetaient une pierre à l’ombre du premier vivant qui s’approchait de leur maison en construction, et des gestes appris (Passe les prunes sous l’eau fraîche et n’oublie pas de mettre la bassine sous le robinet. L’eau est précieuse qui servira à arroser (…)), par l’incantation cyclique à la langue qui, ici court à l’excès, là est une torche qui brûle aussi sous l’eau. Mais au final, il n’y a pas de puits de langue où puiser parole qui désaltère. Alors, le poète, s’adressant tant à elle-même qu’à l’homme en tant qu’espèce (dont l’angoisse de la mort est pour la première fois plus grande que celle de sa propre mort), tout en sachant qu’à te nommer tu disparais, parce que cela est inéluctable, nourrissant sa réflexion de son quotidien parfois le plus trivial et/ou le plus banal, nous jette en dernier conseil : Applaudissez sans réserve. Cela n’a pas éternellement lieu, parce que le meilleur s’arrête en nous et y demeure. Même inachevé (et parce que l’inabouti est increvable), vivons puisqu’il nous faut mourir.
TERRES DE FEMMES
par Angèle Paoli
Claude Ber, Pierre Dubrunquez, L’Inachevé de soi,
Éditions de l’Amandier, Collection Le Voir Dit, 2009.
Pierre-DUBRUNQUEZ-Gisant-huile-sur-toile
Pierre Dubrunquez, Étude pour un gisant, 2007,
Huile sur toile, 146 x 114 cm
Collection particulière
in L’Inachevé de soi, page 31.
LE DÉCISIF DE VIVRE
C’est peut-être l’arrondi d’un ventre, cercle de blancheur troué en son centre par l’oculus du nombril et, tout autour de cet espace de rondeur, des flammèches folles qui s’échevèlent dans les blancs les gris les mauves. Un œuf chevelu émerge de son nid ou de plus loin encore. D’un sommeil des origines. C’est en réalité ― étrange réalité à dire ― le détail d’une huile sur toile. Étude pour un autoportrait. Avec ce détail, fragment d’une œuvre picturale de Pierre Dubrunquez, le peintre cosigne, en complicité artiste, L’Inachevé de soi, poème épico-intime de Claude Ber. L’ouvrage, pris dans son entier d’œuf primordial recomposé, est un incessant questionnement sur la plénitude perdue. La nécessité de dire pour tenter une percée au-delà du miroir. Le désir d’aller au-devant de ce « quelque chose de plus inquiet que moi qui me dépasse ». Et pour chacun des deux artistes, le poète et le peintre, le désir de mettre en résonance, dans la plus grande exigence, leur interrogation duelle du monde, cet « ennoiement de la terre », sans masque sans grimage, sans faux-semblant. À travers la corporéité du geste, inhérente à l’ouvrage du peintre et avec l’écriture, cette « juste obstination d’écrire qui pousse vers le clavier… ». Alternance et altérité se répondent se joignent, échos de sens et de partage. Une lecture en « vis-à-vis » qui demande au lecteur de cet échange une « posture d’éveil et d’attente. » Entre la matière des mots et la peinture. Indices de présence.
De ce travail complice du poète et du peintre, lequel précède l’autre ? Le « Dit » ou le « Voir » ? Il semble, à explorer ce « chantier de l’inachevé de soi », que s’abolisse l’interrogation première. Pour laisser place au regard dialogué des deux artistes, à leur interprétation contrapunctique du monde. Ce que l’un tente d’approcher par le travail tourmenté de la matière, l’autre le sonde à travers le forage des mots. Car le monde toujours se dérobe à nos sens amoindris. Et ce qu’il peut donner à entendre ou à voir ne peut s’appréhender en profondeur sans la médiation de l’art.
« L’homme n’est pas sûr de connaître le monde, de le voir, de l’entendre. Sinon il n’y aurait pas de peinture, de poésie, de musique ». Ainsi s’exprime Roger Munier dans l’exergue qui préside à l’ouverture de l’ouvrage partagé de Claude Ber et de Pierre Dubrunquez.
Photographiées par Jean-Marc Robion et Alain Hatat, les huiles sur toile de Pierre Dubrunquez sont habitées par les éléments. L’air et l’eau. L’averse bleue. Les Vents. Les toiles sans titre, elles aussi, rendent visibles leurs batailles, leurs mouvements, leurs zones d’incandescence et d’affrontements, leurs flottements dans l’espace. À la fois légère et dense, combative et fluide, la peinture de Pierre Dubrunquez, où joutent les bleus et les gris les blancs et les verts les marrons et les noirs, incite à la rêverie. Une rêverie aérienne menée en sarabande par toute une flottaison de particules, de têtards filandreux follicules fendant la masse liquide des couleurs, se frayant un passage sous les lianes qui zèbrent l’espace. Dans l’air tourbillonnant des tempêtes, au-delà des cercles mouvants d’où elles semblent surgir, les formes ovulaires remontent, ondulantes, vers la surface des eaux et l’en-deçà des airs. Tandis que La grande réserve tient serrés dans sa dure verticalité les éléments en germination. Taches et ovules, filaments drus qui tentent, ascensionnels, une évasion sur la toile.
Sans titre, les gouaches aquarellées, ébauches de danseurs ou de lutteurs, ombres en mouvement, hantent l’espace vide. Silhouettes inachevées. D’autres huiles sur toile imposent au regard les combats tourmentés que se livrent les corps. Palpables à l’œil, ils sculptent leurs formes à même la matière, dans l’attente peut-être de s’en dégager pour atteindre une forme accomplie. Les études enfin ― dont seul le titre oriente la lecture ― Étude d’après Poussin, Étude pour un gisant, Étude pour une mise au tombeau ― suggèrent l’inachèvement de l’œuvre davantage que le sujet qu’elle est censée aborder. Le désir de l’œuvre, la recherche qu’elle génère semblent compter davantage que l’œuvre aboutie. Sans doute l’essentiel de ce qui hante le peintre gît-il dans l’inaccompli. Cet inaccompli qui toujours insiste et sans cesse incite le peintre, « homme qui marche dans les images », à forcer son geste, toujours, dans les mêmes « retouches ». Pour se tenir debout. Ne pas s’égarer en elles.
L’écriture de Claude Ber, toute de mouvement et de tourbillons, est une écriture magicienne. Exploratrice des hauts-fonds, la langue du poète est comme la vague qui déferle, violente, imprévisible, et ramène sous elle, entre flux et reflux, mille trésors. Qu’elle dépose en offrande sur la page. Ou pique en « talisman ». Tout un théâtre de l’intime, mélange de tendresse et de subtile cruauté, est ramené ainsi, dans « l’herbu » de la langue. Images de l’enfance, lovées dans « l’intensité du détail ». Menues choses, expériences brèves, dont « la simplicité brûle aussi. » Amour : « Tu es l’aimé ou l’aimée le corps de mes mains. ». Évocation de ce qui fut, ces « deux pins jumelés de Philémon et Baucis que nous étions ». Et mort. Incompréhension de l’expérience liée à la mort. « Par exemple tu étais là. Et puis tu n’as plus été. J’écris mort la sachant mais ne sachant quelle syllabe de son nom va me couper la mort pour moi plus jamais dite. » Émotion à lire cet aveu. La mort n’est jamais comme n’est jamais loin.
Ailleurs, cosmique, multiple, visionnaire, la langue du poète, « autre version du feu », « court à l’excès ». Attachée en fureur aux éléments, elle « rameute en troupes totémiques » guépards et gazelles, puma, grizzli, tigres du Bengale, loups blancs de Laponie, dont la disparition prochaine signera le désaffection de l’homme : « laissés nous sommes à nos figures humaines dépeuplées. » Pareille à la divinité qui nomme, le poète convoque dans La Ténèbre qui « rassemble dans ses mailles », la multitude des poissons. Formes et noms étranges surgissent « dans le tunnel qui nous relie au rien ». Puis s’éteignent dans le silence. Car le silence existe aussi dans l’écriture de Claude Ber. Ne serait-ce que parce que le poète s’arrête pour interroger la langue, interroger le dire. « Dire est dur, je dis, qui cherche appui sur l’insaisissable ».Vertige à essayer de dire, à s’en tenir à dire :
« Simplement le vent. Ou la pensée du vent. »
« Fraisée sur le décisif de vivre. ».
Angèle Paoli, site Terres de Femmes, 2010