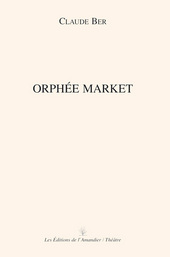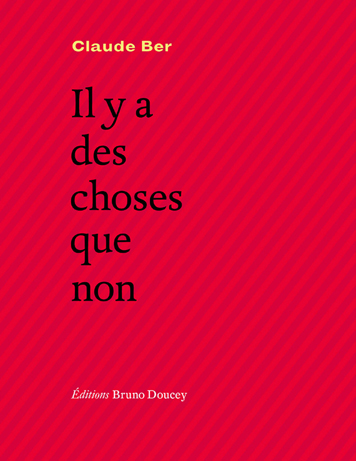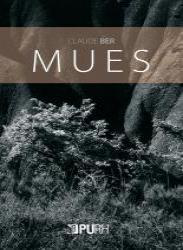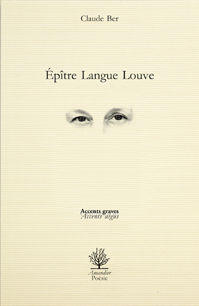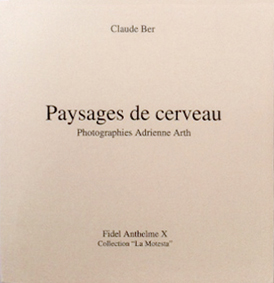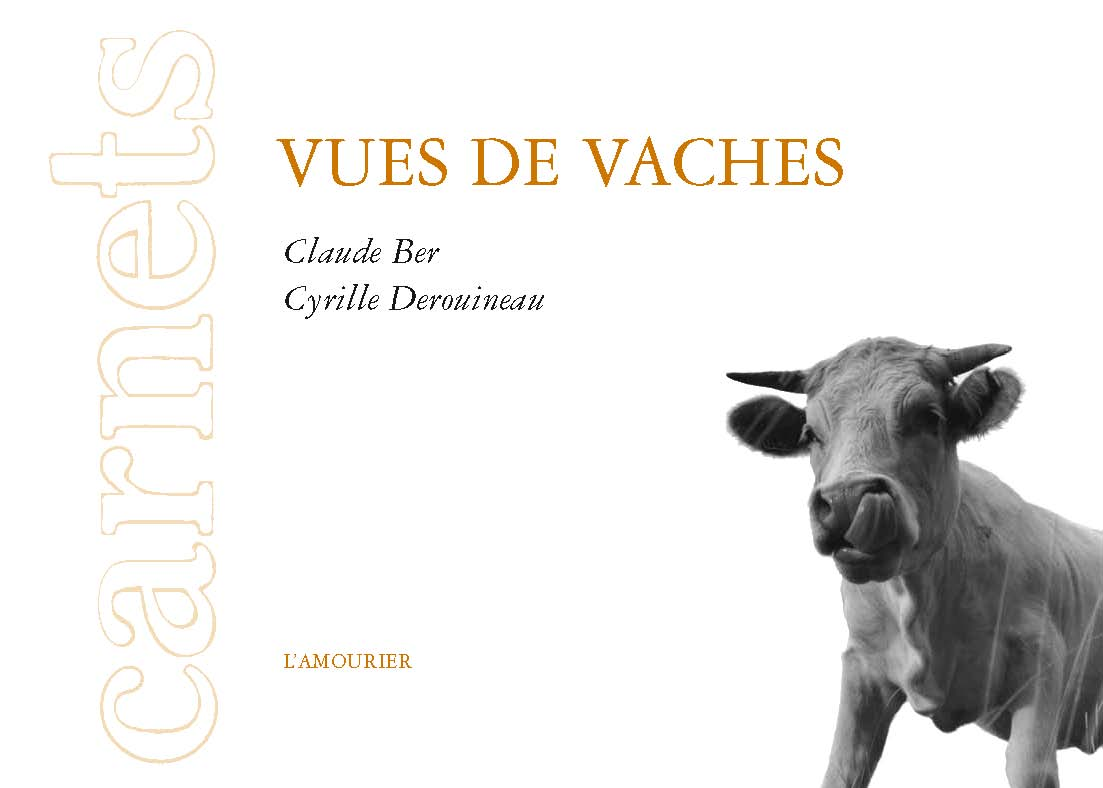BIOBIBLIOGRAPHIE

Mon parti pris est de ne jamais présenter ni commenter le travail de mes invités, auxquels je donne carte blanche sur mon site, mais la publication d’Evelyne Encelot étant posthume et réalisée par mes soins avec l’aide de Frédérique Wolf-Michaux et de Jean Rubin, je présenterai ci-dessous par les quelques lignes rédigées pour la 4ème de couverture de son livre, cette écriture inédite qui me paraît essentielle. C. BER
« Ce recueil est une publication posthume rassemblant des inédits d’Evelyne Encelot (1948-1998). Les dates et la nature des textes retenus constituent un cycle majeur de son écriture. D’autres textes ont été écrits antérieurement, qui paraîtront un jour, mais il y a un « avant » et un « après » circonscrits par l’épreuve de la souffrance psychique. Evelyne Encelot tenait à témoigner de ce parcours tant est mal dite – « mau-dite »- la souffrance psychique, tant est dépossédé celui qui en souffre et qui est trop souvent celui dont on parle, sur lequel on parle et non celui qui parle. Ecrire de ces lieux des confins de l’esprit, ce courage-là, cet effort-là – car c’est travail de Sisyphe- est une réappropriation de soi et du monde. L’écriture se fait à la fois acte de résistance et délivrance.
C’est à simplement, pleinement écrire qu’elle témoigne le mieux, au delà de toute anecdote biographique, de l’inscription de l’humain dans et par la langue. Et tout se dit de là-bas, d’ici, des joies, des souffrances, du quotidien et de « l’extra-ordinaire », de l’obscur de nous mêmes et de la plus éclatante lumière, de la légèreté et du poids de vivre …
Le but de ce livre est de permettre la découverte de l’écriture d’ Evelyne Encelot dans sa diversité, écriture « régulière » plus que « séculière » et qui s’élabore à la fois dans la plus grande singularité et dans une présence attentive à l’autre et au monde. Nous souhaitons qu’il suscite intérêt et adhésion pour l’authenticité et l’originalité de ce travail élaboré dans une confrontation personnelle à l’écriture comme manière d’exister. »
EVELYNE ENCELOT, A PARTIR D'ÉCRIRE, ED. DE L'AMANDIER
La poésie d’Evelyne Encelot est douce et violente. Pas seulement dans le jeu du contrepoint qui fait alterner le charme d’une chanson à l’éclat coupant d’un texte qui fait entendre la douleur, la brisure d’un « soleil pulvérisé », mais dans la rencontre qui allie, au coeur même du poème, présence et absence, ouverture et repli, réparation et déchirure. Elle vit d’une tension constante où se dit l’intense contradiction du vivre, du « être là » dans le monde, du « être là » du monde.
Le monde, c’est d’abord le ciel « couleur de pêcher », le soleil, le vent, la pluie et la mer, constamment évoquée, convoquée dans un face à face où le vide de l’âme se creuse de l’immensité immuable, de l’immensité fracassante jusqu’à l’effacement, l’anéantissement. « Je m’amenuise, je m’atténue, je me distingue à peine du ramassis auditif qu’elle rythme et enfièvre. ». Le monde se manifeste alors dans une sorte de dessaisissement où l’être se retire, s’évide jusqu’à l’absolue béance : « le vent souffle dans mon âme ». C’est sans doute la condition pour que s’élève le chant « Pour la mer, et l’eau lumineuse de sa dalle qui glisse et reglisse / Dans le brouhaha du soleil» (« Ex-voto »). Mais le monde c’est aussi les lieux du voyage et du repli : les rues, l’appartement vide, la maison. Si la mer est (l’ouvert), la maison est le lieu de l’infime, de l’intime, le lieu d’un possible ressaisissement. Ouvrir et fermer les volets. « J’ai jeté mes habits marchands et laissé les apparences/ Je me claquemure… ». La maison, « maison fermée sur la nuit », est alors un refuge où il s’agit de tenir à distance le dehors pour que vivre soit possible dans l’émerveillement simple d’un matin d’été « voir par la porte entrebâillée les petits poiriers et pommiers luisants aiguisés par des souffles de brise ». La nuit, pourtant, les fenêtres s’ouvrent, les murs se dissipent, la porte cède et « la peur énorme s’ouvrit sur du vide » (« les Akènes de la nuit »).
PRÉFACE DE JEAN RUBIN
La poésie d’Evelyne Encelot est ainsi travaillée par le vide, par la mort ; ou plutôt elle s’accomplit à partir, autour du trou qu’elle cerne d’un fil ténu. « Je parlais et ma vie se dévidait, se bobinait » (« Silences »). Elle est en ce sens arachnéenne et se revendique comme telle dans deux poèmes intitulés « la leçon d’Arachné ».
« Happant de ses toiles fines
La douceur de l’humide et du sec
Et patiente, patiente, filant
De sa patte prudente… »
Ces vers définissent un parti pris de légèreté, de délicatesse, une poétique de la fragilité. La soie est de langage, elle recouvre le vivre, le retisse autour de la béance, en restitue les « déchirures irrémédiables » dans la trame même du tissu. « Elle s’active et tisse d’imperceptibles réseaux. » Ainsi le fragment avec ses élans, ses ruptures représente une des données essentielles de cette écriture. Il montre le mouvement vers l’unité, la forme accomplie qui répare et déchire dans le même geste. Douceur et violence. Il suffit parfois de quelques mots, en un ultime trait, pour désorganiser la belle harmonie, la faire vaciller et donner à entendre le vibrato de la douleur (« Paysage en bleu »). Ou bien c’est une phrase qui, à l’entame du poème, ramasse en une image fulgurante la vie et la mort : «Les ramiers descendent du ciel en virevoltant comme des feuilles mortes » (« Novembre »).
La poésie d’Evelyne Encelot se tient à ce point d’équilibre, impossible mais tenu, où, entre réparation et déchirure, en un instant suspendu comme un infini, elle capte un « Eden furtif dans le soleil en pluie ».
Jean RUBIN
Juillet 2006
« Ce recueil est une publication posthume rassemblant des inédits d’Evelyne Encelot (1948-1998). Les dates et la nature des textes retenus constituent un cycle majeur de son écriture. D’autres textes ont été écrits antérieurement, qui paraîtront un jour, mais il y a un « avant » et un « après » circonscrits par l’épreuve de la souffrance psychique. Evelyne Encelot tenait à témoigner de ce parcours tant est mal dite – « mau-dite »- la souffrance psychique, tant est dépossédé celui qui en souffre et qui est trop souvent celui dont on parle, sur lequel on parle et non celui qui parle. Ecrire de ces lieux des confins de l’esprit, ce courage-là, cet effort-là – car c’est travail de Sisyphe- est une réappropriation de soi et du monde. L’écriture se fait à la fois acte de résistance et délivrance.
C’est à simplement, pleinement écrire qu’elle témoigne le mieux, au delà de toute anecdote biographique, de l’inscription de l’humain dans et par la langue. Et tout se dit de là-bas, d’ici, des joies, des souffrances, du quotidien et de « l’extra-ordinaire », de l’obscur de nous mêmes et de la plus éclatante lumière, de la légèreté et du poids de vivre …
Le but de ce livre est de permettre la découverte de l’écriture d’ Evelyne Encelot dans sa diversité, écriture « régulière » plus que « séculière » et qui s’élabore à la fois dans la plus grande singularité et dans une présence attentive à l’autre et au monde. Nous souhaitons qu’il suscite intérêt et adhésion pour l’authenticité et l’originalité de ce travail élaboré dans une confrontation personnelle à l’écriture comme manière d’exister. »
EVELYNE ENCELOT, A PARTIR D'ÉCRIRE, ED. DE L'AMANDIER
La poésie d’Evelyne Encelot est douce et violente. Pas seulement dans le jeu du contrepoint qui fait alterner le charme d’une chanson à l’éclat coupant d’un texte qui fait entendre la douleur, la brisure d’un « soleil pulvérisé », mais dans la rencontre qui allie, au coeur même du poème, présence et absence, ouverture et repli, réparation et déchirure. Elle vit d’une tension constante où se dit l’intense contradiction du vivre, du « être là » dans le monde, du « être là » du monde.
Le monde, c’est d’abord le ciel « couleur de pêcher », le soleil, le vent, la pluie et la mer, constamment évoquée, convoquée dans un face à face où le vide de l’âme se creuse de l’immensité immuable, de l’immensité fracassante jusqu’à l’effacement, l’anéantissement. « Je m’amenuise, je m’atténue, je me distingue à peine du ramassis auditif qu’elle rythme et enfièvre. ». Le monde se manifeste alors dans une sorte de dessaisissement où l’être se retire, s’évide jusqu’à l’absolue béance : « le vent souffle dans mon âme ». C’est sans doute la condition pour que s’élève le chant « Pour la mer, et l’eau lumineuse de sa dalle qui glisse et reglisse / Dans le brouhaha du soleil» (« Ex-voto »). Mais le monde c’est aussi les lieux du voyage et du repli : les rues, l’appartement vide, la maison. Si la mer est (l’ouvert), la maison est le lieu de l’infime, de l’intime, le lieu d’un possible ressaisissement. Ouvrir et fermer les volets. « J’ai jeté mes habits marchands et laissé les apparences/ Je me claquemure… ». La maison, « maison fermée sur la nuit », est alors un refuge où il s’agit de tenir à distance le dehors pour que vivre soit possible dans l’émerveillement simple d’un matin d’été « voir par la porte entrebâillée les petits poiriers et pommiers luisants aiguisés par des souffles de brise ». La nuit, pourtant, les fenêtres s’ouvrent, les murs se dissipent, la porte cède et « la peur énorme s’ouvrit sur du vide » (« les Akènes de la nuit »).
PRÉFACE DE JEAN RUBIN
La poésie d’Evelyne Encelot est ainsi travaillée par le vide, par la mort ; ou plutôt elle s’accomplit à partir, autour du trou qu’elle cerne d’un fil ténu. « Je parlais et ma vie se dévidait, se bobinait » (« Silences »). Elle est en ce sens arachnéenne et se revendique comme telle dans deux poèmes intitulés « la leçon d’Arachné ».
« Happant de ses toiles fines
La douceur de l’humide et du sec
Et patiente, patiente, filant
De sa patte prudente… »
Ces vers définissent un parti pris de légèreté, de délicatesse, une poétique de la fragilité. La soie est de langage, elle recouvre le vivre, le retisse autour de la béance, en restitue les « déchirures irrémédiables » dans la trame même du tissu. « Elle s’active et tisse d’imperceptibles réseaux. » Ainsi le fragment avec ses élans, ses ruptures représente une des données essentielles de cette écriture. Il montre le mouvement vers l’unité, la forme accomplie qui répare et déchire dans le même geste. Douceur et violence. Il suffit parfois de quelques mots, en un ultime trait, pour désorganiser la belle harmonie, la faire vaciller et donner à entendre le vibrato de la douleur (« Paysage en bleu »). Ou bien c’est une phrase qui, à l’entame du poème, ramasse en une image fulgurante la vie et la mort : «Les ramiers descendent du ciel en virevoltant comme des feuilles mortes » (« Novembre »).
La poésie d’Evelyne Encelot se tient à ce point d’équilibre, impossible mais tenu, où, entre réparation et déchirure, en un instant suspendu comme un infini, elle capte un « Eden furtif dans le soleil en pluie ».
Jean RUBIN
Juillet 2006
EXTRAITS

Recueil d'Evelyne Encelot à paraître 6 septembre 2006
A partir d’écrire…
Fragment du journal d’une traversée de la souffrance psychique
-1-
Je suis sortie de l'hôpital. Le médecin se cantonne aux jours de repos, remèdes et tous les gens de la rue faisaient le dos rond, le regard au sol, c'était horrible à regarder. Je me sens épiée, entendue, toujours sous le regard d'autrui. Je me vaporise littéralement.
Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de m'éloigner de la vie et de moi-même chaque jour davantage? Je ne me retrouve pas, j'ai peur de cette énorme couronne oppressive autour de moi. Il me faudrait une muraille en acier pour résister... ou une autre façon de lire le monde et moi-même.
C'est une journée couleur de drapeau. Dans les rues, les gens font des signes. Je ne sais pas toujours les lire... Ma direction est livrée aux gens de la rue, aux gens qui font des signes.
Moi à moi crie de douleur.
Il y a un vent frais, presque froid, qui bouscule la lumière, et elle passe en vagues au dessus des maisons avec parfois sur les murs des ombres immenses d'oiseaux.
C'est comme si ma vie était mangée par un hanneton géant.
La rue - la rue à voir simplement- bouleversée de voitures, de piétons silencieux, tout le monde me regardant, de quoi pleurer en pleine rue à être si seule. Que de gestes obliques, de fronts penchés, de mines retournées comme après un tremblement de terre et je suis là au milieu, bête, et constituant l'épicentre de cette catastrophe.
Impression que tout de ma vie est écouté et vu par des gens, qu'il n'y a plus de barrières privées entre lesquelles vivre. Mais évidemment que peut-on dire de cela sous peine que ce soit considéré comme fait de démence ? Et dans la rue, ils en font des mimiques silencieuses, ils en dressent des théâtres vivants, je marche environnée par des puits de mine. Qu'est-ce qu'ils condamnent avec tant de véhémence?
-2-
G.B. décide cet après midi de sortir. Sortir réaffronter ces yeux, ces mines, tout l'effrayant attirail. C'est non et la honte de dire non, de ne pas vouloir affronter. C'est ça se sentir écrasé.
Une armée intérieure - vous telle la nuit du fond de l'oeil la photographie - une armée de gens de la rue pour m'envoyer au mouroir.
Laisse-la moi encore, ma vie, telle qu'elle est venue au monde au coin d'une maison en pisé qui dormait sur la route et sous les phalles rougeâtres des cheminées d'usine. Elle avait un goût d'urine croupie et de froid et je la regardais, rosie sous les anglaises claires, dans mon tablier en vichy tout gonflé des épaisseurs en tricot que je portais en dessous. Je regardais mes mains, pas longues, des sortes de petites pattes et le majeur droit était douloureux, épaissi de la corne qui y est restée parce que j'avais peur et que je serrais trop fort le porte-plume et il y avait là des rainures encrées qui ne s'enlevaient pas.
(…)
Je me souviens d'après-midi dans les genévriers, près du socle roux d'une vigne, je me souviens de toute la campagne austère et sèche du Sud et tout se mêle dans une lumière de bonheur, la vigne, la couleuvre qui dormait dans le raidillon, les empreintes étoilées des pins maritimes dans l'ocre des chemins, le goût du vent affûté à tous les escarpements de pierre, la voiture crapaudinement amarrée dans un chemin creux et renvoyant d'un coup de vitres le soleil en plein ciel, la saison des cerises et la saison des raisins, celle de la lagramue et celle des asperges sauvages tout en vrac de bonheur, à savoir la vie partagée. Dieux qui dormez dans le bleu lointain du ciel, dieux qui transmuez votre sèche noirceur et fracas de soleil, écoutez d'une mortelle la prière, que s'en vienne et puis revienne le jour de demain et celui d'encore demain, qu'ils nous protègent avec dans la coupelle de leurs mains l'eau transparente et imperceptible du bonheur.
-3- (…)
-4-
Impression par moments de marcher dans une plaie ouverte. Sur quoi tu roules? " Des rails d'acier et des ornières de boue". Quelle violence dans l'image. Mon esprit endolori en saigne un peu mais je ne sais pas le traduire; je l'enregistre comme des mots violents.
Je pense aux marécages des mots, aux étiers où ils dorment, aux larmes où ils se roulent, au souffle qui les fait filer et tournoyer, aux bonaces où ils tombent grain à grain, chacun embarquant une histoire...
Leurs yeux fixent. Ils sont à côté, on pourrait dire à un jet de pierre parce que c'est bien la dureté qu'ils sont. Sur eux peut passer la cavalcade des orages, la campagne des cannes creusées, la fournaise des retours. Ils regardent mais juste à côté, détournés, pour bien signifier. On se sent vieux, si vieux et faible. C'est l'immense peuple des mange-cervelle...
D'ailleurs ils me l'ont mangée la cervelle. Ca a fui mine de rien. Ils déjeunaient comme ça, détournés, sur le pouce. Moi j'ouvrais à la nuit mes yeux vides. Dans cette nuit là, j'ai rencontre des frères. Si démantelés, si ravagés. Et puis après, j'allais criant partout: où est mon cervelet? Qui a mon lobe? Ma dure-mère? ( il me revenait toutes sortes d'expressions que je n'avais jamais connues). Ca choquait. Ca faisait ricaner. J'avais perdu l'amour. Toute ma vie, tout mon corps déshabité. Tout trop grand pour moi. Vague chaleur sans cesse menacée d'extinction. "Glop glop glop" faisait le Grand Glop.
C'est le crapaud hurleur. Il gonfle, il gonfle et il jette son cri triomphal. Il vous les enroule, il les suborne, il les menace pour mieux charmer, il importe avant tout qu'il ouvre le bec, il connaît le poids des mots, il y va à grandes pelletées, l'énormité des tas ainsi formés sidère le monde naturellement, alors, là, tous, bouche bée et d'autant plus le crapaud hurleur "couaque! couaque! couaque!"
-5-
(…)
Je les vois. Ils s'alentissent, m'adressent un signe (yeux à droite, yeux à gauche) ou regard au ciel ou geste de soulever une poussière sur eux et de l'écraser du talon, toutes mimiques qui disparaissent quand la rue approche d'eux sa vague d'autres gens. A quoi et pour quoi jouent-ils?
Des heures à se sentir épiée, espionnée dans tous les gestes comme sous une observation radar. Tous ces gens qui ont le défaut insigne d'aimer quelqu'un usent probablement de mots ridicules, lapin lapinowitch, olé panda et autres inconséquences d'une fantaisie mal morte de l'enfance, pourraient-ils couramment les utiliser devant cinquante regards sans prendre un recul qui leur ôte leur bienheureux engourdissement de vivre, de vivre quelques moments à son mode, à sa fantaisie, pour rien?
Depuis si longtemps, GB, depuis tellement de temps, j'ai l'impression qu'ils veulent me faire mourir.
(...)
-6-
(…)
Quand je suis dans le noir pour écrire, j'entends les rames bourdonnantes des ourdisseurs, en bas. Qu' est-ce qui est tombé pour que tout soit devenu impossible? Ma vie ne se ressemble plus. "Un jour, dit le Docteur N., tu verras l'autre rive..." Je ne vois rien. J'abandonne. peut-être qu'ils se lasseront de m'observer. Peut-être ne trouveront-ils plus d'aliment sur moi à leur voracité.
Quel sens cela aurait-il de devenir simple spectateur de la vie des autres? Ca a immédiatement un goût de mort. Qui veux-tu être, que veux-tu faire? Je les entends, je les écoute, mais je n'arrive pas à organiser la ménagerie des gestes et des mots pour grimper à une ou une autre de ces identités telles qu'on (qui est "on"?) les envisage. Je ne les perçois que définies de l'extérieur comme si, de l'intérieur, j'étais une terre aride et chaude comme les déserts.
Je n'ai pas installé un moi. Il est aujourd'hui cette proie essoufflée dont on disperse partout les lambeaux.
-7-
(…)
Sortir réaffronter ces yeux, ces mines, tout l'effrayant attirail. C'est non et la honte de dire non, de ne pas vouloir affronter. C'est ça se sentir écrasé. Une armée intérieure - vous telle la nuit du fond de l'oeil la photographie - une armée de gens de la rue pour m'envoyer au mouroir.
Où faut-il aller? Que faut-il faire pour amadouer Moloch? Il fait froid et c'est déjà la nuit. Jamais ne je les ai vu tant s'agiter les voisins d'en face. Jamais ils n'avaient tant lavé de voitures, sonné de sonnettes, ramassé de papiers chewing-gum, déversé de l'eau devant leur seuil. Et la maison reste toujours morte, fenêtres fermées hormis l'entrebâillement des volets d'une là-haut. Que me dites-vous serviteurs du dieu Moloch? Où tentez-vous de me diriger? Où est la lueur rouge de la vie? Jamais je n'ai tant vu de vieilles à cabas, tant de couples tenant par la main des tout petits, tant de gens signifiant tant de choses et je tiens mon coeur comprimé et je frotte mon bras régulièrement, serré, serré, pour que le champ de la douleur n'explose pas....
-8-
Les feuilles s'agitent devant la mer. Comme souvent je pleure. Où est la liberté? La mer roule à rouleaux d'argent. Comme souvent je pleure. Après je vois la forêt perdue. Après je sens les dures épines qui me poignent le coeur - mon coeur en débris, mon coeur en morceaux, mon coeur-poubelle, mon coeur ruiné.
Les feuilles s'agitent devant la mer. Dans la forêt de cartilages où je m'enfonce, les signes seront épars et lointains - lumières amies pourquoi me suis-je tant trompée de chemin? Tortueuse, et hérissée d'épines, à couteaux, telle est la terre. De temps en temps une lueur gaie, si vite effacée.
Coupable? Sûrement - de n'avoir pas su choisir, de n'avoir su agir, coupable sûrement. C'est pourquoi si abîmée, si lassée, si pleurant.
Les feuilles s'agitent devant la mer. La mer frémit et le vent la traverse oblique. Ma vie cassée, bousculée, qu'en reste-t-il? Que cet instant présent que la mer incante. Pour le reste, je vous aimais. Je vous aimais tant. Mais aujourd'hui mes mains sont si vides et mes vêtements leur font des poignets de deuil.
Le vent traverse les iris et bouscule le rosier. La mer s'en va à l'infini. Herbes de terrasse par le vent agitées, j'ai trouvé comme vous un "modus moriendi" ( après bien des manuels bourrés de barbarisme et de barbarie). Nous avons le même. Que l'on me brûle et que l'on jette mes cendres dans la mer, la mer qui court et frémit, en l'honneur de l'amour et que l'on lève son verre à l'infini, à un autre endroit de lumière où enfin nous serons accomplis.
Des grilles grincent que le vent emporte. Il y a peu d'habitants c'est pourquoi le mufle de la mer est d'autant plus présent mâchonnant et ruminant et ressassant. La lumière exalte le petit jardin de la terrasse. Où, vers où, l'avenir?
-9- (…)
-10-
Soirée. Profusion des plats, préparatifs toute la journée, la maison rutile mais où est ma place, qu'est-ce que je peux faire là? Toujours une impression de "pas droit à " " pas droit à". On dirait que, par beaucoup de côtés, vivre est interdit, que la seule position que je me donne est l'exclusion. Idiot finalement. Mais je le dis quand c'est fait. Pourquoi raconter des choses aussi sombres? Qui cela avance-t-il et moi-même? Décentrée. J'arrive à une impasse telle qu'il faudra bien que cela éclate et que j'entre dans une terre plus raisonnable où vivre est possible, où la fraternité existe. Au loin le monde. Près, moi: spectatrice et cela seulement.
Moi, je suis là avec mes persécutions fantômes et les nuages qui s'effilochent derrière la fenêtre.
-11- (…)
-12-
C'est elle, l'angoisse familière ( à laquelle je ne me suis d'ailleurs jamais vraiment habituée), la peur de ne plus savoir déchiffrer le monde. Ce dernier prend des allures fantasmagoriques.
Tout le lexique s'illustre non plus sur des pages mais dans la vie même; les métaphores ont quitté le papier et vivent leur vie urbaine.
-13-
Je n'ai pas compris grand chose au tourbillon qui m'a enveloppée. D'ailleurs que de fois, j'ai entendu siffler près de moi des invectives qui allaient en ce sens. Je sais simplement que j'ai souffert sur une lande d'épines où je me blessais à chaque fois. Mes mains sont vides et j'espère ne pas avoir eu au bout des doigts des ongles coupants comme des tranchoirs. Dites-moi que je n'ai abîmé personne et je regarderai par delà une vitre double, la mer qui change, passe et est toujours là.
Et la langue des humains, leur langage poignant et fourbe et cruel. Le sombre taillis de leur savoir et la méchanceté avec laquelle ils s'en servent.
L'appareil gris tremble d'un son qui va éclater quelques secondes après: téléphone. rares voix, mais amies, pas trop semées de pièges et d'embûches. Ils disent ma douleur, ils disent leur douleur. Ils parlent. Moi, comme interdite de vivre, je me tais.
M'en relèverai-je? Je ne sais pas. Je me sens condamnable, condamnée. Bien sûr, beaucoup d'imperfections, mais ai-je voulu du tort aux autres? Quand je repense au cauchemar...Comment après cela vais-je pouvoir recommencer?
Ce fut un matin de gel que je partis en ambulance pour l'hôpital. Des enfants qui attendaient le car scolaire, toute une troupe agitèrent la main. J'attendis au rez-de chaussée de l'hôpital; je n'avais rien à faire que de collecter des signes, encore d'autres signes... Ces deux gendarmes munis d'un walkman, cet homme et cette femme immobiles devant une fenêtre où tombait la neige. Et dire que j'avais gardé mes bottes rouges!
Et puis un camion aux vitres peintes est venu. Nous allions à l'annexe dans la campagne. Je ne savais pas où c'était. Simplement ça s'appelait D. et voilà. Du côté du village au nord où vivaient mes parents. Dans le camion deux vieilles femmes quasi séniles, une que des lunettes épaisses rendaient comme aveugle, un invraisemblable assemblage de pansements, de vieux vêtements, d'épingles de nourrice, et une autre assise elle, alors que l'autre était étendue sur une civière, le bras pris dans une gouttière de plâtre. Personne ne parlait, personne ne se regardait. On est arrivé devant des bâtiments gris estompés par le rideau de la neige. Je suis entrée dans un couloir. Gravi un escalier. Ai dit "bonjour" à quelqu'un, un homme je crois, qui poussait un chariot et qui a eu l'air surpris. Et puis j'ai entendu la porte se fermer à double tour derrière moi. On m'a conduite à une chambre où j'ai immédiatement vu en entrant que les fenêtres étaient condamnées. Mon père était là quand on a apporté le plateau repas. Il était triste. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il parte pour attraper son car. Il est parti. On a fermé la porte à clef. J'ai regardé la fenêtre et j'ai vu les voitures noires sur la neige qui s'enfuyaient comme une colonne de cafards. Le jeu avait cessé. Il y eut un sursaut dans la nuit. A la nuit tombée, un homme et une femme sont venus, qui n'ont pas allumé la lampe, me poser un feu de questions indiscrètes. On m'a fait des piqûres de je ne sais quoi. Dans la nuit une voix comme avinée a entonné une chanson sentimentale. Ca m'a effrayée. Le matelas me brûlait. Les jours suivants, je tremblais tellement que je n'en ai plus guère de mémoire.
Je revois ces déjeuners fantomatiques du matin où des gens se traînaient jusqu'à une table où on leur donnait des potions. On entendait les noms. On voyait le petit tas à chacun imparti. On absorbait cela. Après le déjeuner, servi sur des tables roulantes. Aujourd'hui, je retrouve sur une feuille de dessin un arc-en-ciel dessiné au pastel avec les crayons apportés par GB et je lis "Hôpital de D. mardi 12 décembre 19.." Un arc en ciel sur le mur de la chambre et je me souris à travers le temps.
Où sont mes copains des mauvais jours, bavant, criant, s'agitant? Oh mes copains des mauvais jours, je pense à votre guérison, à notre aventure, à notre vie.
-14- (…)
-15- (…)
-16-
Le complot s'estompe. La réalité enflée comme un bruit de conque de mer dégorge et peut-être se réduit. Il y reste l'idée d'un outil mal sûr, de quelque chose de tuméfié et lésé au fond si bien qu'on ne peut pas être sûr et qu'on n'ira pas s'appuyer là-dessus en cas d'incertitude.
La nuit dehors au dessus des immeubles a le ciel mauve, je paresse à la raconter, à me faire des compte rendus de mon après-midi, à me souvenir.
(…)
J'ai retrouvé la maison sourde enfouie dans les herbes démesurément hautes, sentant un peu le moisi d'hiver mais tous ses membres en ordre. Quand je me souviens que là, on voulait m'assassiner, que je pensais avoir perdu mon métier, mes amis, que j'étais dénudée jusqu'à l'os et qu'il faisait en moi une panique effrayante... Et ce petit matin à ronces nues, quelques oiseaux dans l'air d'hiver, la rue et les villas dormant de l'assoupissement d'un dimanche matin ou d'une vague demi-mort épante de toutes les fenêtres et que je pensais qu'il m'était interdit de m'en aller, qu' « on » ne voulait pas que je m'en aille, que j'étais piégée. La maison a gardé un goût de cauchemar - mais je reviens.
Je décide d'écrire tous les jours; ça ne veut rien dire de plus. Simplement, si possible, m'aider à survivre. Je vis suspendue à mon stylo. Le sang coule à l'encre et les mots font sur l'espace des traces sombres.
Le malheur bouge en moi. Il laisse partout sa trace. Il ne se passe rien. Le chat est parti dehors. Ma lumière brille dans le quartier sombre. Le malheur bouge avec ses vieux ravages. Dix heures sonnent. Ils sonnent comme dans le lointain village de mon enfance.
Alors je replie mes papiers.
-17- (…)
-18- (…)
-19- (…)
-20-
En miettes, en morceaux, raclant les fonds comme une barge hors d'état.
J'étais sous haute surveillance et châtiée à la moindre incartade, on me faisait exactement payer le moindre faux pas. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeu là mais enfin...
Croyable? Pas croyable? J'oscillais, je finissais par croire que le but était de déconstruire, de réduire à néant. Il s'agissait de dissoudre et certains, parmi les plus grossiers, me trimballant des chrysanthèmes sous le nez et me faisant assister à des enterrements. Quelle damnée cruauté: le téléphone s'interrompait, on me réclamait des factures, on me tracassait pour des histoires de clefs, le bureau multipliait les réunions où traînaient devant moi de lourds annuaires téléphoniques et dans l'appareil j'entendais parfois des airs, parfois des bribes de phrases. L'étau se resserrait et j'allais à la mort. Je pris l'espace mesuré d'une chambre à l'hôpital psychiatrique. Un temps effrayant à essayer de refaire surface. J'avais réinventé Dieu et lui et moi ça n'allait pas bien fort ensemble. Bref, j'étais drôlement toquée.
Maintenant que j'ai retrouvé la boussole à se conduire quand on est humanoïde et que j'y pense, je me dis, oui c'était tout faux mais qu'il y a dans nos vies d'insupportables tyrannies dont celle d'être toujours fixé, répertorié - sécurité sociale impôts banque, emploi de telle date à telle date et j'en passe - des sédentarisés technologisés; on a en tous des classeurs trieurs et par divertissement on épie devant des écrans des gens qui ne vous voient pas...
-21- (…)
-22-
Je me rends compte à quel point je marche à travers mon néant. Pendant ce temps là des gens poursuivis réellement par la faim, par la maladie organique, des femmes surchargées d'enfants vivent. Quelle pusillanimité de ma part. J'hésite et je chancelle comme si je marchais dans le vide- mais je ne marche pourtant pas dans la vide. Le soleil est sur ma tête. Je me souviens de tous les jeux pervers du soleil pendant la maladie: soleil sur tête, tu joues ta tête, soleil sur table joue ta table et ainsi de suite jusqu'au dénuement absolu, à la paralysie.
Il faut que je retrouve le soleil clair et sain de la raison - qui n'est en somme que le soleil banal et superbe d'un jour d'hiver dans le Sud.
-23-
Sur la douleur. Le bon rhumatologue de GB lui a conseillé d'éviter la douleur; en effet, elle maintient certains muscles en état de crispation et fait s'adapter de travers d'autres muscles. Intéressant. Il faudrait prescrire pour le mental ce qui est prescrit pour le physique. Réduire les faits de caractère; augmenter ceux de raison.
La maladie mentale est vue bien autrement que la maladie des artères ou du foie. Pourquoi ne veut-on pas soigner son cerveau?
Ma tendance persécutive: "Les Marseillais! Ils sont perdus!" dans une rue de G. . En fait, c'était: "Les Marseillais! ils ont perdu". Ca nous informait de l'échec de l'équipe de foot. La préoccupation c'était l'équipe de foot, pas nous. Et GB a clairement répondu en ce sens! J'ai aussitôt rectifié mon erreur - mais je l'avais faite! Insignifiant, mais caractéristique. Il faut que je veille de ce côté.
-24- (…)
-25-
(…)
Ce que j'écris (je le relis) n'est pas exact. Le chemin va être long vers l'écriture, vers la vie. J'ai téléphoné à ma mère dans la matinée. Elle a répondu. j'ai reçu la réalité comme un choc qui ferait éclater du verre. Elle est comme je l'ai toujours connue dans mon enfance, dans tout son silence, son inaltérable banalité. J'ai pensé que, pendant tout ce temps, j'avais traversé toutes sortes de contrées et d'étapes. Il m'a semblé alors que mes parents étaient restés éternellement silencieux, moi j'avais appris à parler. J'avais rencontré GB. Nous avons tellement eu d'amour. Maintenant J.P. est entré dans ma vie. Histoire longue? Courte parenthèse? Qu'est-ce qui est en jeu. Je m'évertue à y réfléchir et j'y arrive mal.
-26-(…)
-27-
Maintenant que je suis guérie, je me situe de nouveau par rapport à mon métier, aux gens, aux choses qui m'entourent. J'ai été très malade.
Ma vie ne se résume pas à mon histoire. Elle se trouve dans les lignes imperceptiblement divergentes qui font les heures, toutes ces heures passées à quoi? C'était au mieux le temps (mais combien recensé) d'une conversation, d'une promenade, mais c'était aussi ce temps-à-rien qu'on a passé parfois sous le prétexte de quelque chose. Qui peut comptabiliser ce temps-à-rien où un radiateur craquait, où je suis restée, les yeux dans le vide, semi allongée et je disais "j'attends la mort" et je ne voyais rien de plus important à faire... C'est de tous ces moments là qu'il faudrait écrire, parce qu'écrire s'enracine en eux, comme peut-être l'énorme pas qui consiste à vouloir vivre - que l'on fait à partir d'écrire...
LES AKENES DE LA NUIT
Choix de textes
Douleur au coeur rapide
Douleur aux bruits sans présence
Douleur en sonnerie des abonnés absents
Douleur sans amarrage
Jusqu'où est-ce que tu vas flotter comme ça? Je n'arriverai pas au bord du jour qui vient.
Dehors les vies cocardent
Et toi, pliée, essorée, dans un mouchoir qui doit encore une fois renoncer...
L'amour, ce sera, à cuisses tièdes, quelque chose pour encombrer ce vaste flottement, l'amour à calcul, un moyen de connaître comme un autre avant de s'en aller.
Renonce à signifier ton passage, les choses ou les gens d'une marque où tu te reconnaisses
Plie ton échine, laisse passage vertical à la douleur, de la tête aux talons, elle laisse sa colonne d'absence.
Quelque chose s'arrache s'arrache.
On peut dire " "Tiens, la mort, prends ta brisure, c'est ta part, j'essaierai de vivre avec le reste... Rien à faire. Une facilité sans doute. Ca s'arrache et continue encore de s'arracher pendant que le corps se tord et assiste, pendant que se fait l'inondation du dedans.
Voilà le futur ample comme les dix centimètres de la main au mur et ce présent désastreux, défait, insupportable.
Et tu le dis: "Reprenez. C'est invivable".
Et tu sais aussi que tu ne t'égareras pas à en penser plus - qu'il faut faire une digue contre la mort, loin, et en silence.
Tout est tel maintenant que la vie lui ressemble. Te voilà de sa saisine. De sa désaffection, de son anonymat, de sa fadeur.
Tu sais que le menteur et toi pourrirez ensemble et que ce sera vivre. On dira que c'est aimer.
Et c'est avec ces bras de sable qu'il faudra demain ouvrir la fenêtre.
Boule de soleil galopant dans le ciel. On a la peau lisse; on a retrouvé son rire sous ses dents. Le coeur change d'adresse. Voyages...
Il est là. Il porte un maillot bleu et des chaussures à grosses lanières; C'est moche - et la beauté de son corps éclate dans le demi-jour quotidien d'un couloir.
J'entends chanter la chanson un peu pute, la chanson du vent qu'il n'y a pas dans les voiles, la chanson de la vie imprécise, celle de la vie qui recuit dans le bain tiède des jour après jour, j'entends chanter la chanson des brasiers, celle des regards arrêtés et des corps qui bougent en faisant basculer l'univers, la chanson des goûts - quel est celui de ta bouche, de ta peau, de ton sperme, je te regarde tu sens encore le lait - mais que faire de ce petit regard?
Voyages...
Il passe, tige mâle dure et douce.
Je me cache et j'oublie.
C'était hier, c'était une douleur.
Oublie.
Aujourd'hui, huileux et souple comme un cachalot a des rires de plateformes obscur
Quand ma vie fera douleur au bout des doigts, au bout des yeux, quand le langage ne sera plus cette masse mouvante en plein vent, j'aimerais qu'il reste en branches et brindilles quelques ramures de mots à la bise de l'hiver, et ceux que j'aurai trouvé les plus beaux, tout poudrés du givre des apprentissages passés
22/01/1993
Ronce
Ce qui était endormi, flottant, s'est réveillé. L'ancienne ronce a ressurgi. Nous nous aimions dans les couloirs en croix des bâtisses qui sentaient le désinfectant... D'abord le ciel gris a crevé en pluie, c'étaient aussi les mauvais jours, lui il passait et repassait au bord de mes cauchemars, ensuite le soleil a ébloui les rues et l'histoire continuait... C'était il y a bien longtemps. Chacun s'en est allé, suivant le chemin qu'il avait déjà choisi et le temps a passé, historié de saisons, de péripéties, lent et chamarré. Le hasard et la mort de celui qui n'apparut plus que comme un intermédiaire nous ont remis face à face (et pourtant, que la petite maison des faubourgs était douce avec sa glycine et son rosier au milieu de sa population mêlée d'étrangers. Depuis la mort de son habitant, je n'en ai jamais plus repris le chemin, comme si tout un quartier de la ville avait été englouti).
Maintenant nous revoici, avec nos vies faites et nos regards qui se croisent... Je pose mes mains sur mon coeur et je me raconte d'autres épreuves, encore plus dures et qui demandèrent encore plus de courage. C'est un avril froid, trempé d'averses serré de lointaines roues de soleil... Lui, là-bas, il a fait provision de bois au coin de ses cheminées, ajouté un tableau à la mine de crayon aux autres, et l'a mis de guingois sur le bois coupé. Il est chez lui. Dehors les arbres penchent et le bruit de la ville ronronne dans l'avenue. Bien plus loin, par delà deltas et collines, armée d'un sécateur, je taille les ressauts des arbres à lierre aux clôtures de mon jardin, et j'ôte du sol les longues griffes étouffantes: j'ai les mains noires de courbatures.
Pendant tout le temps que tombent les petits pentagrammes vernissés du lierre, pendant que je libère les herbes et les violettes de son étreinte, je songe aux attachements et au vide, puissant et libératoire - ainsi le disent, croit-on, les Chinois. Je regarde la jatte lisse où les chats mettent à tremper pour leur boisson des feuilles vertes de rosier. Par le ciel et l'eau, que soit la paix... mais c'est chez le voisin, familier et lointain, que pousse l'olivier...
Le soir venu, quand derrière la buée verte des feuillages, j'allume les lampes, je sors de sa boite ancienne le jeu de cartes qui dort entre l'as et le dix de coeur. Les cartons glissent les uns sur les autres, tombent en grains serrés, se rebattent, ramènent Pallas, Hector et la cruelle Penthésilée... Nous avons passé convention, les cartes et moi: Je leur demande des nouvelles de lui... En fait, elles glissent, se battent, reglissent tant, que je ne parle de personne, que du hasard et de la durée, eux que je ne maîtrise pas... Et le hasard et le temps s'usent, se polissent, à ce komboloï occidental... et moi aussi mes doigts se fatiguent, je me lasse, je me détache, le jeu de cartes se referme, la nuit tombe, et le silence vient sur mon esprit blessé et inquiet.
Signe
Nous sommes gens d'un nouveau siècle... Plus d'un est fier de son dernier engin ménager. Plus que jamais cependant, le frère trahit le frère et l'homme vit traqué jusqu'à ce que ses entrailles fument au grand soleil; on affûte le métal des aiguilles, des compteurs mesurent, les affaires optiques se sont perfectionnées, un raz-de-marée de brimborions bon marché submerge les magasins et toutes sortes de guerres ouvertes ou secrètes, font rage.
Que dire à de jeunes visages qui en sont tout juste à épeler le monde?
Et cependant dans le ciel, passent les nuages, aussi divers, aussi nombreux que les humains, incessants, jamais entièrement déroulés, certains isolés, innombrables, multiples.
Et cependant sur la mer la vague chasse la vague, crête après crête, et dans le bois de pins sur la colline frémissent toutes les aiguilles. Chaque chose suit son destin. L'humanité ses carnages, l'eau son chemin de ronde sur le globe, les arbres leur fredon dans le vent.
Nous passerons, ceux que j'ai aimés et moi-même. Notre vie n'est pas celle que j'avais rêvée... Nous avons fait ce que nous avons pu. D'autres peut-être seront plus libres et plus heureux. J'en doute...Certains, peut-être, à travers les coupantes mailles d'acier de ce qu'on appelle leur civilisation.
De là où j'en suis cependant, sur ce versant sombre et tourmenté, je lève une main qu'ils n'ont que peu de chance d'apercevoir, et dans le lent moutonnement des exécutés, des persécutés, des fous, de ceux qui ont tenté de résister, des rêveurs, des poètes, je leur souhaite bonne route.
D'une vie l'autre
Un voile sapide enveloppait le ciel. Il faisait froid. Tu lisais dans le cercle vert d'une lampe. C'était dans la salle Labrouste de l'ancienne bibliothèque. Autour du silence le cocon doux et animé de la ville, la chaleur et au-dehors les vitres embuées des cafés. Ces manuscrits-là étaient déjà loin de ta vie - Déjà pressée de chercher on ne sait quoi ailleurs…
Tu verras les écureuils gris de Central Park.
Tu chercheras des médicaments dans la tourmente de neige à Moscou.
Déjà ces multiples conversations te sont promesse. Tu voudrais tout retenir: l'écharpe désinvolte de celui-ci, les ongles carminés des belles causeuses, les diamants taillés en poire rue de la Paix, la minceur interminable d'une passante effilée, les touffes de chrysanthèmes jaunes sur les tombes du cimetière du Montparnasse où tu allais saluer tes pères spirituels et l'hôtel de la rue Delambre où tu te retrouvais toujours.
Dans le mouvement sans fin de la foule et des lumières tout ce que fait l'humanité te semblait quotidiennement possible et les fronts gris des palais se fronçaient. Les chevaux de pierre s'élançaient et le fleuve coulait. Il naissait un chef-d'oeuvre sous tous les pinceaux roux des artistes des quais.
Les pigeons emmenaient le jour dans leurs ailes et tu allais dormir dans la chambre où peut-être écrivit Breton.
Des années après le jour se lève dans le village où tu habites. L'amour a dédoré ses ailes d'ange au plafond. C'est un printemps humide tout imbibé de vert.
Tu te trouves sur la colline, près de la collégiale. Tu n'écris plus de chansons, tu t'enveloppes d'ombre.Tu te nourris et te fortifies d'obscurité.Tu es souterraine et jumelle à la nuit.
Le temps voyage comme une plume sur l'eau noire.
Tu as abandonné bien des choses et il te reste vivre.
RITOURNELLES
A la ronde des amants
A la ronde des amants
Le temps est doux-acide
C'est l'automne des feuilles
Dans la fontaine aux tritons.
A l'homme de l'Hellespont un plumet de soleil.
J'errais dans les hameaux perchés
Il bruissait, les forêts étaient à marée haute
Nous n'osions pas nous rencontrer
Nous le fîmes, ce n'était plus pareil
Et l'homme de l'Hellespont
Qui l'eût dit? ne savait pas parler.
Une palme de soleil pour sa barbe bouclée
Pour son corps médique et sa langue coupée
A la ronde des amants
Durer est sapide
La flèche est empennée
Le jour est si lucide
Pour qui a mal au temps.
Il y eut l'homme qui s'usait de se laver
Et qui allait, au gouvernail de sa montre
Construire et industrialiser.
C'était un petit homme
Qui aimait l'eau et l'amour
Et qui tenait le compte de ses grains de café.
Petit homme venu de la chaleur et du désert,
Quel bon amant ce fut!
Précis comme sa montre, tenace comme une saladelle
Quel dommage qu'il ne m'ait pas plu!
A la ronde des amants
Le jeu est bien rapide
Même s'il dure longtemps.
Le temps est trompeur
Nous eûmes tant de plaisir
Et du désagrément.
A l'homme de Normandie
Qui pleurait en riant
Un sainfoin de mélancolie
Car il fut laid et intelligent.
A l'antiquaire qui possédait
Dans les larmes et le sang
Toute ma guerre - et les blessures que j'infligeai.
Puis ce fut l'homme des passions
A l'âme comme un ciel d'orage
Nous eûmes des lits de blé sauvage
Et des arrêts de tragédie
A tordre le corps comme du linge mouillé.
Nous eûmes des attentes, des plages noires faisant le tour de la terre
Et des étés rouges d'incendie
Ardents d'aimer.
Amants, beaux amis
Dont la ronde n'est pas finie
Nous allons nos chemins de poussière.
Aux éclairs du désir
Nous avons si bien inventé
Nous avons si bien concilié
Ce qu'on appelle demain et hier
Nous avons si bien voyagé
En des barques de rêves
Sur le fleuve oubli.
16/05/1984
Elle
Occupée à ses tâches modestes
Patience, oh ma patiente,
Refaire l'ourlet d'une robe,
Essuyer la corniche d'un meuble,
Ecouter au-dehors l'averse de grésil
Veiller sur l'enfant, sur le chat,
Semer des graines de lupin
Pour l'été, pailler le camélia
Pour l'hiver, surveiller le peuple des plantes,
Peuple hasardeux et peuple éclatant,
Le mimosa a gelé mais les capucines claironnent dans le massif
Et débordent en flamboyant sur l'étang,
Oh, que tu en as lavé du linge dans l'eau glacée
Au temps de ta jeunesse.
La bouche d'eau faisait un torrent dans le déversoir
Et se hérissait en crinière de gel en janvier
Et nous courions dans les allées
Enfants -enfants aux joues rondes.
Au fil des ans, à tant laver et à tant coudre
Tu en as cousu des années
Jusqu'à être maintenant cette brindille de femme âgée
Qui s'en va chez le pharmacien dans la bourrasque
Fermement agrippée à son parapluie,
Cette femme au corps abîmé
Qui coud, inlassablement, au chevet de mes malheurs,
Point de feston et point de chaînette
Surfil et surjet, reprise fine, bouton recousu,
Cet hiver -là tu reprisais mon manteau qui en avait besoin
Et le jour était cette même lame blanche
A goût de désespoir...
Je me répétais les mots de la femme Narses et du mendiant
La lumière était ce livre déchiré
Et toi, inlassable, tu cousais les jours,
Lavant le linge aux armoires
Effeuillant le céleri, rendant compte du ciel et des saisons
Au tréfil du chas de ton aiguille
Qu'il devient doux, le temps.
Il devient un monde habitable
Les années se retournent sur elles-mêmes
Comme dorment les enfants
Ma mère, que tu as cousu longtemps.
13/01/1994
L' Etrangère
Le mélèze lisse ses bourgeons ronds
Qui s'y frotte, qui s'y colle?
Et de grands pans de montagne montent jusqu'au ciel
Faire leurs zigzags blancs au-dessus du chaos de pierres
Pierres cassées, pierres coupantes, pierres vertes, pierres sous une robe d'eau pâle
Pierres dures à grimper,
Couverts de neige descendant en coulées dans les lignes des sapins
Si haut, là-haut, le ciel.
Soleil sur les aiguilles brunes - se dégage une austère essence
A-t-il neigé jusqu'ici?
Non, c'est un semis de crocus blancs s'ouvrant au ras de la terre
Et là le coeur tigré de la pensée jaune
Là la trompe bleu profond de la gentiane
Silence.
Et puis là-haut, sur l'arête, on a rencontré le vent
S'époumone et siffle dans les branches
Nous nous plions pour nous reposer dans les racines des arbres
La neige étincelle
Dans les espaces secs, les fourmilières s'activent...
Privilégieras-tu la pierre
Le chamois au versant d'une pente tournant sa tête fine
Le ruisseau qui va sans fin à grand bruit d'un tronc creux
L'oiseau tête noire
Le minuscule scarabée
Les humains que nous sommes?
Chacun marmonne ce qu'il sait de son histoire
A travers le prisme immense
Je serre ma veste contre moi et je pense
Vie, infinité et multitude, comme tu es l'Etrangère...
Voix
Du passé noir
Que d'être obscur
Des branches et ramures
Au vent
Des bruissements, craquements
Au fil des bois
Du passé noir
Du froid
De l'haleine en allée
Des bêtes de la forêt,
Molles vapeurs montant dans l'épais du versant
Hésitant
Et bouclant; puis rebouclant; à effets lents
De l'air de nuit
Heurté aux cailloux du grand chemin
-Qu'entend-on sinon le hibou?
Monte une voix.
C'est une vieille voix qui tremble
Mêlée à l'odeur du chaudron
Où cuisent les pommes de terre
C'est une vieille voix
Qui tisse ce que savent les siens
La dureté du temps
Les capacités et les saisons
La santée avec deux "e"
Et le grésil ce matin,
Septembre qui suit l'août-tournesol
Et le malheur et la pitié
Il y aura de la semoule au goûter
D'où vient ce glas au clocher?
Que la paix soit aux trépassés
Et au vivant
-Entre eux, mince pelure.
Qu'il fasse nuit
Qu'il fasse froid
Tricote aux aiguilles
Les pans de brouillard
Où coucher toutes les fougères de la forêt
L'aiguail c'est la rougie.
Qu'elle retisse,
La vieille voix.
Complainte de la travailleuse
Je laisserais bien tout tomber
Les heures balisées des journées
Le temps aménagé
La roue inexorable des travaux
Oh tous les impôts
Les petites têtes de plomb de Nidussandec
Et toutes celles qui balisent l'avenue Nedelec
Les chers vieux amis
O inexorable ennui...
Je laisserais bien tout tomber
Les sentiments domestiqués
Le prix de l'électricité
Les réactions qui vont en rond
Et dans ma supérette le thon
Et dans ma supérette les commissions
A l'heure où j'ai fini le travail
Et où je traîne, humble piétaille
Ma fatigue d'écrazibouillée.
Oh oui je laisserais bien tout tomber
Plutôt que de compter les années
Qui me séparent de la liberté
Que c'en sera peut-être fini pour ta pomme
Rideau sur la bête de somme
Avec l'enterrement qui convient
Toute seule dans son petit lopin
Loué pour cent ans grand maximum
Il en tombe et il en pleut des hommes
morts, comme brindilles dans le bois
Et il en naît plus encore ma foi...
Dans cette universelle logorrhée
Je laisserais bien tout tomber
Je dirais à la soeur, au mari, au bof
Je ne vais plus à la foire à Saint Christophe
Je vous laisse toute ma panoplie
Le grand carcan des heures vannées
Et cet énorme boulet de mes années
Je fais ma valise, je pars au Chili
A moins que ce soit à Helsinki
Je passerai peut-être par Issoire
Mais je n'y resterai pas plus d'un soir
Je m'en vais, c'est le grand au-revoir
Vous fêterez sans moi la Saint Grégoire
Salut les gens et les bestiaux
Retournez sans moi à vos travaux
A qui rit le dimanche
Pleure toute la semaine dans ses manches
J' pars regarder les baleines
Et chercher des endroits ousque les gens ont de la veine...
Ils disent rien, ils sont gênés
Les amis, les maris et les têtes de buis
Ils replient leurs bras sur leurs nez
Tout ça sera vite oublié,
Et à nous la liberté.
PANDRAGON
Dehors le monde bouge, les fumigènes crépitent, les trains stoppent, la foule coule le long des rues, enfant, il est temps de relire le Talon de fer,
Lis les pages écrites à la sueur et au sang du peuple. Il y en a tant...Le monde bouge, les feux s'allument, les huées montent, on sourit fin dans les immeubles de luxe,
Vois les ruisseaux noirs de la misère et tous ses avatars.
C'est le temps que j'ai dû m'aliter, je devais soigner mes reins. Il n'y a personne dans la maison, que le chat fidèle. Quel silence!
Il y a eu les heures aux yeux ouverts et les heures aux yeux fermés.
J'ai laissé la maison ouverte pour l'infirmière.
Il y a eu d'éblouissants soleils remués de vent bondissant le jour entier dans le ciel puis sont venus les nuages et aujourd'hui il neige sur les roses d'hiver restées au jardin.
La neige est descendue en oblique dans les branches de l'acacia. Je ne sais si elle durera... Je reste longtemps immobile, je me remémore et me récite des temps de ma vie, des villages et des villes, des intérieurs différents, et toutes sortes de choses, les chapeaux de ma grand-mère paternelle, le pied de mauve du Pré-aux-chevaux en été, cette photo d'août prise sur les Champs-Elysées dans une robe d'étamine à motifs bleus et orange, j'avançai la main contre mon front, un geste beau et timide, et Paris comme un gigantesque cabinet de curiosités, rosace aux trente printemps, quelle lumière!...
Elle glisse sous mes yeux aujourd'hui, du soleil à la neige.
On peut penser que je suis là une personne bien inutile, C'est certainement vrai, mais je n'y puis rien. Je salue cet effet malencontreux de la douleur comme un privilège.
C'est comme si on m'avait redonné dans ma vie bourdonnante tout le quai dei Schiavoni, et le vieux pont doré sur l'Arno, et ceux de l'hiver sur les voies d'eau de Venise, et surtout le grand parquet du Trocadéro, et ces vastes avenues qui s'en vont chez Chirico pour y flâner le pas tranquille, réfléchissant et rêvant.
Je m'accommode de ce silence immobile, Le temps passe. Les feuilles de tilleul que nous avions cueillies ce début d'été au bord du Rhône infusent.
C'est toute la vie qui macère.
A dix-huit heures trente, l'infirmière reviendra. Avec elle, un air froid des chemins.
Son fils travaille au sud dans la zone portuaire
- Les brillantes rivières de lumières ceignant la baie de colliers doubles et triples avec, à l'arrière, perçant vaguement l'obscurité, les falaises blanches au-dessus des collines, que de fois je les aurais longées sur la route familière,
Me disant "Et voici la mer! La mer!" Là-bas, la nuit se précipitait.
Le matériel de l'infirmière fait de petits cliquetis précis,
Quand elle réapparaît, c'est aussi le temps qui revient.
Revoici les efforts, le travail quotidien et son rythme continu, l'émaillage des préoccupations, et derrière, aux franges, les convulsions du monde, le brasier dans la gueule du dragon, le chevauchement des formes, les cris, et dans l'espace inconnu, demain, aux improbables décours.
Destruction
La nuit est tombée depuis longtemps, les lampes sont éteintes. Là-bas, le disque continuait à tourner. Et puis, les bruits se sont rassemblés en une couronne qui s'éloignait. Quelqu'un était allongé près de moi. Vague forme masculine. Christophe? Jean-Christophe? La nuit avait bu le prénom et toutes les marques. Il y a eu un sursaut, une déchirure. Mais oui, voyons, Jean-Paul et les jours qui lui sont liés, un visage... Quelque chose a fait machine arrière.
Et pourtant j'ai pu voir, nuit, comme tu étais en train de boire, en train d'effacer vertigineusement autour de moi les présences et les récits de ma vie. J'allais m'engouffrer dans une obscurité qui, en quelques secondes, avait digéré toute ma mémoire.
J'avais appréhendé la décrépitude comme dénervement, ramollissement, envahissement d'humeurs, ou bien comme explosion de la chair, devenue comme du verre, ou bien comme pourrissement des moelles, ou bien comme rigidification des muscles... Cette manière-là est toute nouvelle et de caractère décisif...
Dans mon pays natal, autrefois, les paysans qui allaient sur les chemins, les villageois qui hélaient en passant le seuil des portes, les parents de multiples et lointains cousinages que l'on croisait sur la place aux sorties d'office, avant de conter leur affaire s'interpellaient: "Frère!" "Soeur!"
Si les choses basculent si vite dans la mort, frère, soeur, laissons-nous à Dieu. C'est simplement d'un bon pas qu'il faudra avancer.
Là-bas il y a une maison. Longère au toit gris aux fenêtres closes. Une maison un peu maudite puisque c'est ma maison
Une maison seule
dont l'intérieur n'est qu'une ruine...
Les brumes passent sur son toit, les pluies et aussi les soleils, soleils froids et nuancés du vieux pays.
Quel sens a une maison qu'on ne peut habiter?
C'est une drôle de maison qui n'a de sens que pour moi. Elle abrite dans ses murs noirs mon enfance pâle et sage - Fantôme de la petite fille qui marchait sur les chemins- Elle abrite nos retrouvailles par delà l'horizon de la mort. Elle abrite quelques araignées, peut-être quelque souris agile.
C'est une maison qui se tait.
La fougère et la vigne vierge lui sont voisines.
Elle va dans le courant invisible des rêves.
Nudité
Maintenant que je n'ai quasi plus rien que mes mots
Alors j'ai tout le temps
Et je voyage avec les survivants
Avec ce qu'il y a
Comme c'est
Seulement
Seulement...
Que faites-vous?
Parfois des spectres sombres courent sur mes nuits
Et je les entends, ceux que l'histoire a calcinés
Par millions ils crient et leur cri n'est pourtant pas si fort que d'autres hommes aujourd'hui ne soient massacrés.
Et il passe dans mon esprit des ombres glacées
Et c'est une femme douce à la fontaine aux pleurs...
Pourtant dans le matin le peuplier ruisselle sa chanson
Sont aux arbres les premières cerises
Sur un ciel bleu comme lavé par les pluies
Que faites-vous? Et il faudra porter ces actes.
Tu vas dans la grande presse de ceux qui sont humiliés. Tellement qu'ils ne le savent pas. Toi tu le sais.
Tu as de grands yeux doux et sagaces. Et la volonté du guerrier. Etrange mélange.
Mes pensées t'accompagnent.
Que peuvent des pensées?
Que peuvent mes pensées dans l'activité et la fébrilité de tes jours?
Pourtant elles sont là, présentes, tenaces, aussi douces que sont durs les combats pour ceux qui vont dans le soleil des puissants.
Elles t'accompagnent, formant d'invisibles lacs.
Puisses-tu croire à la toute présence de ce qui ne semble pas
Et qui porte la vie.
EVELYNE ENCELOT, A PARTIR D'ÉCRIRE, ED. DE L'AMANDIER
Fragment du journal d’une traversée de la souffrance psychique
-1-
Je suis sortie de l'hôpital. Le médecin se cantonne aux jours de repos, remèdes et tous les gens de la rue faisaient le dos rond, le regard au sol, c'était horrible à regarder. Je me sens épiée, entendue, toujours sous le regard d'autrui. Je me vaporise littéralement.
Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de m'éloigner de la vie et de moi-même chaque jour davantage? Je ne me retrouve pas, j'ai peur de cette énorme couronne oppressive autour de moi. Il me faudrait une muraille en acier pour résister... ou une autre façon de lire le monde et moi-même.
C'est une journée couleur de drapeau. Dans les rues, les gens font des signes. Je ne sais pas toujours les lire... Ma direction est livrée aux gens de la rue, aux gens qui font des signes.
Moi à moi crie de douleur.
Il y a un vent frais, presque froid, qui bouscule la lumière, et elle passe en vagues au dessus des maisons avec parfois sur les murs des ombres immenses d'oiseaux.
C'est comme si ma vie était mangée par un hanneton géant.
La rue - la rue à voir simplement- bouleversée de voitures, de piétons silencieux, tout le monde me regardant, de quoi pleurer en pleine rue à être si seule. Que de gestes obliques, de fronts penchés, de mines retournées comme après un tremblement de terre et je suis là au milieu, bête, et constituant l'épicentre de cette catastrophe.
Impression que tout de ma vie est écouté et vu par des gens, qu'il n'y a plus de barrières privées entre lesquelles vivre. Mais évidemment que peut-on dire de cela sous peine que ce soit considéré comme fait de démence ? Et dans la rue, ils en font des mimiques silencieuses, ils en dressent des théâtres vivants, je marche environnée par des puits de mine. Qu'est-ce qu'ils condamnent avec tant de véhémence?
-2-
G.B. décide cet après midi de sortir. Sortir réaffronter ces yeux, ces mines, tout l'effrayant attirail. C'est non et la honte de dire non, de ne pas vouloir affronter. C'est ça se sentir écrasé.
Une armée intérieure - vous telle la nuit du fond de l'oeil la photographie - une armée de gens de la rue pour m'envoyer au mouroir.
Laisse-la moi encore, ma vie, telle qu'elle est venue au monde au coin d'une maison en pisé qui dormait sur la route et sous les phalles rougeâtres des cheminées d'usine. Elle avait un goût d'urine croupie et de froid et je la regardais, rosie sous les anglaises claires, dans mon tablier en vichy tout gonflé des épaisseurs en tricot que je portais en dessous. Je regardais mes mains, pas longues, des sortes de petites pattes et le majeur droit était douloureux, épaissi de la corne qui y est restée parce que j'avais peur et que je serrais trop fort le porte-plume et il y avait là des rainures encrées qui ne s'enlevaient pas.
(…)
Je me souviens d'après-midi dans les genévriers, près du socle roux d'une vigne, je me souviens de toute la campagne austère et sèche du Sud et tout se mêle dans une lumière de bonheur, la vigne, la couleuvre qui dormait dans le raidillon, les empreintes étoilées des pins maritimes dans l'ocre des chemins, le goût du vent affûté à tous les escarpements de pierre, la voiture crapaudinement amarrée dans un chemin creux et renvoyant d'un coup de vitres le soleil en plein ciel, la saison des cerises et la saison des raisins, celle de la lagramue et celle des asperges sauvages tout en vrac de bonheur, à savoir la vie partagée. Dieux qui dormez dans le bleu lointain du ciel, dieux qui transmuez votre sèche noirceur et fracas de soleil, écoutez d'une mortelle la prière, que s'en vienne et puis revienne le jour de demain et celui d'encore demain, qu'ils nous protègent avec dans la coupelle de leurs mains l'eau transparente et imperceptible du bonheur.
-3- (…)
-4-
Impression par moments de marcher dans une plaie ouverte. Sur quoi tu roules? " Des rails d'acier et des ornières de boue". Quelle violence dans l'image. Mon esprit endolori en saigne un peu mais je ne sais pas le traduire; je l'enregistre comme des mots violents.
Je pense aux marécages des mots, aux étiers où ils dorment, aux larmes où ils se roulent, au souffle qui les fait filer et tournoyer, aux bonaces où ils tombent grain à grain, chacun embarquant une histoire...
Leurs yeux fixent. Ils sont à côté, on pourrait dire à un jet de pierre parce que c'est bien la dureté qu'ils sont. Sur eux peut passer la cavalcade des orages, la campagne des cannes creusées, la fournaise des retours. Ils regardent mais juste à côté, détournés, pour bien signifier. On se sent vieux, si vieux et faible. C'est l'immense peuple des mange-cervelle...
D'ailleurs ils me l'ont mangée la cervelle. Ca a fui mine de rien. Ils déjeunaient comme ça, détournés, sur le pouce. Moi j'ouvrais à la nuit mes yeux vides. Dans cette nuit là, j'ai rencontre des frères. Si démantelés, si ravagés. Et puis après, j'allais criant partout: où est mon cervelet? Qui a mon lobe? Ma dure-mère? ( il me revenait toutes sortes d'expressions que je n'avais jamais connues). Ca choquait. Ca faisait ricaner. J'avais perdu l'amour. Toute ma vie, tout mon corps déshabité. Tout trop grand pour moi. Vague chaleur sans cesse menacée d'extinction. "Glop glop glop" faisait le Grand Glop.
C'est le crapaud hurleur. Il gonfle, il gonfle et il jette son cri triomphal. Il vous les enroule, il les suborne, il les menace pour mieux charmer, il importe avant tout qu'il ouvre le bec, il connaît le poids des mots, il y va à grandes pelletées, l'énormité des tas ainsi formés sidère le monde naturellement, alors, là, tous, bouche bée et d'autant plus le crapaud hurleur "couaque! couaque! couaque!"
-5-
(…)
Je les vois. Ils s'alentissent, m'adressent un signe (yeux à droite, yeux à gauche) ou regard au ciel ou geste de soulever une poussière sur eux et de l'écraser du talon, toutes mimiques qui disparaissent quand la rue approche d'eux sa vague d'autres gens. A quoi et pour quoi jouent-ils?
Des heures à se sentir épiée, espionnée dans tous les gestes comme sous une observation radar. Tous ces gens qui ont le défaut insigne d'aimer quelqu'un usent probablement de mots ridicules, lapin lapinowitch, olé panda et autres inconséquences d'une fantaisie mal morte de l'enfance, pourraient-ils couramment les utiliser devant cinquante regards sans prendre un recul qui leur ôte leur bienheureux engourdissement de vivre, de vivre quelques moments à son mode, à sa fantaisie, pour rien?
Depuis si longtemps, GB, depuis tellement de temps, j'ai l'impression qu'ils veulent me faire mourir.
(...)
-6-
(…)
Quand je suis dans le noir pour écrire, j'entends les rames bourdonnantes des ourdisseurs, en bas. Qu' est-ce qui est tombé pour que tout soit devenu impossible? Ma vie ne se ressemble plus. "Un jour, dit le Docteur N., tu verras l'autre rive..." Je ne vois rien. J'abandonne. peut-être qu'ils se lasseront de m'observer. Peut-être ne trouveront-ils plus d'aliment sur moi à leur voracité.
Quel sens cela aurait-il de devenir simple spectateur de la vie des autres? Ca a immédiatement un goût de mort. Qui veux-tu être, que veux-tu faire? Je les entends, je les écoute, mais je n'arrive pas à organiser la ménagerie des gestes et des mots pour grimper à une ou une autre de ces identités telles qu'on (qui est "on"?) les envisage. Je ne les perçois que définies de l'extérieur comme si, de l'intérieur, j'étais une terre aride et chaude comme les déserts.
Je n'ai pas installé un moi. Il est aujourd'hui cette proie essoufflée dont on disperse partout les lambeaux.
-7-
(…)
Sortir réaffronter ces yeux, ces mines, tout l'effrayant attirail. C'est non et la honte de dire non, de ne pas vouloir affronter. C'est ça se sentir écrasé. Une armée intérieure - vous telle la nuit du fond de l'oeil la photographie - une armée de gens de la rue pour m'envoyer au mouroir.
Où faut-il aller? Que faut-il faire pour amadouer Moloch? Il fait froid et c'est déjà la nuit. Jamais ne je les ai vu tant s'agiter les voisins d'en face. Jamais ils n'avaient tant lavé de voitures, sonné de sonnettes, ramassé de papiers chewing-gum, déversé de l'eau devant leur seuil. Et la maison reste toujours morte, fenêtres fermées hormis l'entrebâillement des volets d'une là-haut. Que me dites-vous serviteurs du dieu Moloch? Où tentez-vous de me diriger? Où est la lueur rouge de la vie? Jamais je n'ai tant vu de vieilles à cabas, tant de couples tenant par la main des tout petits, tant de gens signifiant tant de choses et je tiens mon coeur comprimé et je frotte mon bras régulièrement, serré, serré, pour que le champ de la douleur n'explose pas....
-8-
Les feuilles s'agitent devant la mer. Comme souvent je pleure. Où est la liberté? La mer roule à rouleaux d'argent. Comme souvent je pleure. Après je vois la forêt perdue. Après je sens les dures épines qui me poignent le coeur - mon coeur en débris, mon coeur en morceaux, mon coeur-poubelle, mon coeur ruiné.
Les feuilles s'agitent devant la mer. Dans la forêt de cartilages où je m'enfonce, les signes seront épars et lointains - lumières amies pourquoi me suis-je tant trompée de chemin? Tortueuse, et hérissée d'épines, à couteaux, telle est la terre. De temps en temps une lueur gaie, si vite effacée.
Coupable? Sûrement - de n'avoir pas su choisir, de n'avoir su agir, coupable sûrement. C'est pourquoi si abîmée, si lassée, si pleurant.
Les feuilles s'agitent devant la mer. La mer frémit et le vent la traverse oblique. Ma vie cassée, bousculée, qu'en reste-t-il? Que cet instant présent que la mer incante. Pour le reste, je vous aimais. Je vous aimais tant. Mais aujourd'hui mes mains sont si vides et mes vêtements leur font des poignets de deuil.
Le vent traverse les iris et bouscule le rosier. La mer s'en va à l'infini. Herbes de terrasse par le vent agitées, j'ai trouvé comme vous un "modus moriendi" ( après bien des manuels bourrés de barbarisme et de barbarie). Nous avons le même. Que l'on me brûle et que l'on jette mes cendres dans la mer, la mer qui court et frémit, en l'honneur de l'amour et que l'on lève son verre à l'infini, à un autre endroit de lumière où enfin nous serons accomplis.
Des grilles grincent que le vent emporte. Il y a peu d'habitants c'est pourquoi le mufle de la mer est d'autant plus présent mâchonnant et ruminant et ressassant. La lumière exalte le petit jardin de la terrasse. Où, vers où, l'avenir?
-9- (…)
-10-
Soirée. Profusion des plats, préparatifs toute la journée, la maison rutile mais où est ma place, qu'est-ce que je peux faire là? Toujours une impression de "pas droit à " " pas droit à". On dirait que, par beaucoup de côtés, vivre est interdit, que la seule position que je me donne est l'exclusion. Idiot finalement. Mais je le dis quand c'est fait. Pourquoi raconter des choses aussi sombres? Qui cela avance-t-il et moi-même? Décentrée. J'arrive à une impasse telle qu'il faudra bien que cela éclate et que j'entre dans une terre plus raisonnable où vivre est possible, où la fraternité existe. Au loin le monde. Près, moi: spectatrice et cela seulement.
Moi, je suis là avec mes persécutions fantômes et les nuages qui s'effilochent derrière la fenêtre.
-11- (…)
-12-
C'est elle, l'angoisse familière ( à laquelle je ne me suis d'ailleurs jamais vraiment habituée), la peur de ne plus savoir déchiffrer le monde. Ce dernier prend des allures fantasmagoriques.
Tout le lexique s'illustre non plus sur des pages mais dans la vie même; les métaphores ont quitté le papier et vivent leur vie urbaine.
-13-
Je n'ai pas compris grand chose au tourbillon qui m'a enveloppée. D'ailleurs que de fois, j'ai entendu siffler près de moi des invectives qui allaient en ce sens. Je sais simplement que j'ai souffert sur une lande d'épines où je me blessais à chaque fois. Mes mains sont vides et j'espère ne pas avoir eu au bout des doigts des ongles coupants comme des tranchoirs. Dites-moi que je n'ai abîmé personne et je regarderai par delà une vitre double, la mer qui change, passe et est toujours là.
Et la langue des humains, leur langage poignant et fourbe et cruel. Le sombre taillis de leur savoir et la méchanceté avec laquelle ils s'en servent.
L'appareil gris tremble d'un son qui va éclater quelques secondes après: téléphone. rares voix, mais amies, pas trop semées de pièges et d'embûches. Ils disent ma douleur, ils disent leur douleur. Ils parlent. Moi, comme interdite de vivre, je me tais.
M'en relèverai-je? Je ne sais pas. Je me sens condamnable, condamnée. Bien sûr, beaucoup d'imperfections, mais ai-je voulu du tort aux autres? Quand je repense au cauchemar...Comment après cela vais-je pouvoir recommencer?
Ce fut un matin de gel que je partis en ambulance pour l'hôpital. Des enfants qui attendaient le car scolaire, toute une troupe agitèrent la main. J'attendis au rez-de chaussée de l'hôpital; je n'avais rien à faire que de collecter des signes, encore d'autres signes... Ces deux gendarmes munis d'un walkman, cet homme et cette femme immobiles devant une fenêtre où tombait la neige. Et dire que j'avais gardé mes bottes rouges!
Et puis un camion aux vitres peintes est venu. Nous allions à l'annexe dans la campagne. Je ne savais pas où c'était. Simplement ça s'appelait D. et voilà. Du côté du village au nord où vivaient mes parents. Dans le camion deux vieilles femmes quasi séniles, une que des lunettes épaisses rendaient comme aveugle, un invraisemblable assemblage de pansements, de vieux vêtements, d'épingles de nourrice, et une autre assise elle, alors que l'autre était étendue sur une civière, le bras pris dans une gouttière de plâtre. Personne ne parlait, personne ne se regardait. On est arrivé devant des bâtiments gris estompés par le rideau de la neige. Je suis entrée dans un couloir. Gravi un escalier. Ai dit "bonjour" à quelqu'un, un homme je crois, qui poussait un chariot et qui a eu l'air surpris. Et puis j'ai entendu la porte se fermer à double tour derrière moi. On m'a conduite à une chambre où j'ai immédiatement vu en entrant que les fenêtres étaient condamnées. Mon père était là quand on a apporté le plateau repas. Il était triste. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il parte pour attraper son car. Il est parti. On a fermé la porte à clef. J'ai regardé la fenêtre et j'ai vu les voitures noires sur la neige qui s'enfuyaient comme une colonne de cafards. Le jeu avait cessé. Il y eut un sursaut dans la nuit. A la nuit tombée, un homme et une femme sont venus, qui n'ont pas allumé la lampe, me poser un feu de questions indiscrètes. On m'a fait des piqûres de je ne sais quoi. Dans la nuit une voix comme avinée a entonné une chanson sentimentale. Ca m'a effrayée. Le matelas me brûlait. Les jours suivants, je tremblais tellement que je n'en ai plus guère de mémoire.
Je revois ces déjeuners fantomatiques du matin où des gens se traînaient jusqu'à une table où on leur donnait des potions. On entendait les noms. On voyait le petit tas à chacun imparti. On absorbait cela. Après le déjeuner, servi sur des tables roulantes. Aujourd'hui, je retrouve sur une feuille de dessin un arc-en-ciel dessiné au pastel avec les crayons apportés par GB et je lis "Hôpital de D. mardi 12 décembre 19.." Un arc en ciel sur le mur de la chambre et je me souris à travers le temps.
Où sont mes copains des mauvais jours, bavant, criant, s'agitant? Oh mes copains des mauvais jours, je pense à votre guérison, à notre aventure, à notre vie.
-14- (…)
-15- (…)
-16-
Le complot s'estompe. La réalité enflée comme un bruit de conque de mer dégorge et peut-être se réduit. Il y reste l'idée d'un outil mal sûr, de quelque chose de tuméfié et lésé au fond si bien qu'on ne peut pas être sûr et qu'on n'ira pas s'appuyer là-dessus en cas d'incertitude.
La nuit dehors au dessus des immeubles a le ciel mauve, je paresse à la raconter, à me faire des compte rendus de mon après-midi, à me souvenir.
(…)
J'ai retrouvé la maison sourde enfouie dans les herbes démesurément hautes, sentant un peu le moisi d'hiver mais tous ses membres en ordre. Quand je me souviens que là, on voulait m'assassiner, que je pensais avoir perdu mon métier, mes amis, que j'étais dénudée jusqu'à l'os et qu'il faisait en moi une panique effrayante... Et ce petit matin à ronces nues, quelques oiseaux dans l'air d'hiver, la rue et les villas dormant de l'assoupissement d'un dimanche matin ou d'une vague demi-mort épante de toutes les fenêtres et que je pensais qu'il m'était interdit de m'en aller, qu' « on » ne voulait pas que je m'en aille, que j'étais piégée. La maison a gardé un goût de cauchemar - mais je reviens.
Je décide d'écrire tous les jours; ça ne veut rien dire de plus. Simplement, si possible, m'aider à survivre. Je vis suspendue à mon stylo. Le sang coule à l'encre et les mots font sur l'espace des traces sombres.
Le malheur bouge en moi. Il laisse partout sa trace. Il ne se passe rien. Le chat est parti dehors. Ma lumière brille dans le quartier sombre. Le malheur bouge avec ses vieux ravages. Dix heures sonnent. Ils sonnent comme dans le lointain village de mon enfance.
Alors je replie mes papiers.
-17- (…)
-18- (…)
-19- (…)
-20-
En miettes, en morceaux, raclant les fonds comme une barge hors d'état.
J'étais sous haute surveillance et châtiée à la moindre incartade, on me faisait exactement payer le moindre faux pas. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeu là mais enfin...
Croyable? Pas croyable? J'oscillais, je finissais par croire que le but était de déconstruire, de réduire à néant. Il s'agissait de dissoudre et certains, parmi les plus grossiers, me trimballant des chrysanthèmes sous le nez et me faisant assister à des enterrements. Quelle damnée cruauté: le téléphone s'interrompait, on me réclamait des factures, on me tracassait pour des histoires de clefs, le bureau multipliait les réunions où traînaient devant moi de lourds annuaires téléphoniques et dans l'appareil j'entendais parfois des airs, parfois des bribes de phrases. L'étau se resserrait et j'allais à la mort. Je pris l'espace mesuré d'une chambre à l'hôpital psychiatrique. Un temps effrayant à essayer de refaire surface. J'avais réinventé Dieu et lui et moi ça n'allait pas bien fort ensemble. Bref, j'étais drôlement toquée.
Maintenant que j'ai retrouvé la boussole à se conduire quand on est humanoïde et que j'y pense, je me dis, oui c'était tout faux mais qu'il y a dans nos vies d'insupportables tyrannies dont celle d'être toujours fixé, répertorié - sécurité sociale impôts banque, emploi de telle date à telle date et j'en passe - des sédentarisés technologisés; on a en tous des classeurs trieurs et par divertissement on épie devant des écrans des gens qui ne vous voient pas...
-21- (…)
-22-
Je me rends compte à quel point je marche à travers mon néant. Pendant ce temps là des gens poursuivis réellement par la faim, par la maladie organique, des femmes surchargées d'enfants vivent. Quelle pusillanimité de ma part. J'hésite et je chancelle comme si je marchais dans le vide- mais je ne marche pourtant pas dans la vide. Le soleil est sur ma tête. Je me souviens de tous les jeux pervers du soleil pendant la maladie: soleil sur tête, tu joues ta tête, soleil sur table joue ta table et ainsi de suite jusqu'au dénuement absolu, à la paralysie.
Il faut que je retrouve le soleil clair et sain de la raison - qui n'est en somme que le soleil banal et superbe d'un jour d'hiver dans le Sud.
-23-
Sur la douleur. Le bon rhumatologue de GB lui a conseillé d'éviter la douleur; en effet, elle maintient certains muscles en état de crispation et fait s'adapter de travers d'autres muscles. Intéressant. Il faudrait prescrire pour le mental ce qui est prescrit pour le physique. Réduire les faits de caractère; augmenter ceux de raison.
La maladie mentale est vue bien autrement que la maladie des artères ou du foie. Pourquoi ne veut-on pas soigner son cerveau?
Ma tendance persécutive: "Les Marseillais! Ils sont perdus!" dans une rue de G. . En fait, c'était: "Les Marseillais! ils ont perdu". Ca nous informait de l'échec de l'équipe de foot. La préoccupation c'était l'équipe de foot, pas nous. Et GB a clairement répondu en ce sens! J'ai aussitôt rectifié mon erreur - mais je l'avais faite! Insignifiant, mais caractéristique. Il faut que je veille de ce côté.
-24- (…)
-25-
(…)
Ce que j'écris (je le relis) n'est pas exact. Le chemin va être long vers l'écriture, vers la vie. J'ai téléphoné à ma mère dans la matinée. Elle a répondu. j'ai reçu la réalité comme un choc qui ferait éclater du verre. Elle est comme je l'ai toujours connue dans mon enfance, dans tout son silence, son inaltérable banalité. J'ai pensé que, pendant tout ce temps, j'avais traversé toutes sortes de contrées et d'étapes. Il m'a semblé alors que mes parents étaient restés éternellement silencieux, moi j'avais appris à parler. J'avais rencontré GB. Nous avons tellement eu d'amour. Maintenant J.P. est entré dans ma vie. Histoire longue? Courte parenthèse? Qu'est-ce qui est en jeu. Je m'évertue à y réfléchir et j'y arrive mal.
-26-(…)
-27-
Maintenant que je suis guérie, je me situe de nouveau par rapport à mon métier, aux gens, aux choses qui m'entourent. J'ai été très malade.
Ma vie ne se résume pas à mon histoire. Elle se trouve dans les lignes imperceptiblement divergentes qui font les heures, toutes ces heures passées à quoi? C'était au mieux le temps (mais combien recensé) d'une conversation, d'une promenade, mais c'était aussi ce temps-à-rien qu'on a passé parfois sous le prétexte de quelque chose. Qui peut comptabiliser ce temps-à-rien où un radiateur craquait, où je suis restée, les yeux dans le vide, semi allongée et je disais "j'attends la mort" et je ne voyais rien de plus important à faire... C'est de tous ces moments là qu'il faudrait écrire, parce qu'écrire s'enracine en eux, comme peut-être l'énorme pas qui consiste à vouloir vivre - que l'on fait à partir d'écrire...
LES AKENES DE LA NUIT
Choix de textes
Douleur au coeur rapide
Douleur aux bruits sans présence
Douleur en sonnerie des abonnés absents
Douleur sans amarrage
Jusqu'où est-ce que tu vas flotter comme ça? Je n'arriverai pas au bord du jour qui vient.
Dehors les vies cocardent
Et toi, pliée, essorée, dans un mouchoir qui doit encore une fois renoncer...
L'amour, ce sera, à cuisses tièdes, quelque chose pour encombrer ce vaste flottement, l'amour à calcul, un moyen de connaître comme un autre avant de s'en aller.
Renonce à signifier ton passage, les choses ou les gens d'une marque où tu te reconnaisses
Plie ton échine, laisse passage vertical à la douleur, de la tête aux talons, elle laisse sa colonne d'absence.
Quelque chose s'arrache s'arrache.
On peut dire " "Tiens, la mort, prends ta brisure, c'est ta part, j'essaierai de vivre avec le reste... Rien à faire. Une facilité sans doute. Ca s'arrache et continue encore de s'arracher pendant que le corps se tord et assiste, pendant que se fait l'inondation du dedans.
Voilà le futur ample comme les dix centimètres de la main au mur et ce présent désastreux, défait, insupportable.
Et tu le dis: "Reprenez. C'est invivable".
Et tu sais aussi que tu ne t'égareras pas à en penser plus - qu'il faut faire une digue contre la mort, loin, et en silence.
Tout est tel maintenant que la vie lui ressemble. Te voilà de sa saisine. De sa désaffection, de son anonymat, de sa fadeur.
Tu sais que le menteur et toi pourrirez ensemble et que ce sera vivre. On dira que c'est aimer.
Et c'est avec ces bras de sable qu'il faudra demain ouvrir la fenêtre.
Boule de soleil galopant dans le ciel. On a la peau lisse; on a retrouvé son rire sous ses dents. Le coeur change d'adresse. Voyages...
Il est là. Il porte un maillot bleu et des chaussures à grosses lanières; C'est moche - et la beauté de son corps éclate dans le demi-jour quotidien d'un couloir.
J'entends chanter la chanson un peu pute, la chanson du vent qu'il n'y a pas dans les voiles, la chanson de la vie imprécise, celle de la vie qui recuit dans le bain tiède des jour après jour, j'entends chanter la chanson des brasiers, celle des regards arrêtés et des corps qui bougent en faisant basculer l'univers, la chanson des goûts - quel est celui de ta bouche, de ta peau, de ton sperme, je te regarde tu sens encore le lait - mais que faire de ce petit regard?
Voyages...
Il passe, tige mâle dure et douce.
Je me cache et j'oublie.
C'était hier, c'était une douleur.
Oublie.
Aujourd'hui, huileux et souple comme un cachalot a des rires de plateformes obscur
Quand ma vie fera douleur au bout des doigts, au bout des yeux, quand le langage ne sera plus cette masse mouvante en plein vent, j'aimerais qu'il reste en branches et brindilles quelques ramures de mots à la bise de l'hiver, et ceux que j'aurai trouvé les plus beaux, tout poudrés du givre des apprentissages passés
22/01/1993
Ronce
Ce qui était endormi, flottant, s'est réveillé. L'ancienne ronce a ressurgi. Nous nous aimions dans les couloirs en croix des bâtisses qui sentaient le désinfectant... D'abord le ciel gris a crevé en pluie, c'étaient aussi les mauvais jours, lui il passait et repassait au bord de mes cauchemars, ensuite le soleil a ébloui les rues et l'histoire continuait... C'était il y a bien longtemps. Chacun s'en est allé, suivant le chemin qu'il avait déjà choisi et le temps a passé, historié de saisons, de péripéties, lent et chamarré. Le hasard et la mort de celui qui n'apparut plus que comme un intermédiaire nous ont remis face à face (et pourtant, que la petite maison des faubourgs était douce avec sa glycine et son rosier au milieu de sa population mêlée d'étrangers. Depuis la mort de son habitant, je n'en ai jamais plus repris le chemin, comme si tout un quartier de la ville avait été englouti).
Maintenant nous revoici, avec nos vies faites et nos regards qui se croisent... Je pose mes mains sur mon coeur et je me raconte d'autres épreuves, encore plus dures et qui demandèrent encore plus de courage. C'est un avril froid, trempé d'averses serré de lointaines roues de soleil... Lui, là-bas, il a fait provision de bois au coin de ses cheminées, ajouté un tableau à la mine de crayon aux autres, et l'a mis de guingois sur le bois coupé. Il est chez lui. Dehors les arbres penchent et le bruit de la ville ronronne dans l'avenue. Bien plus loin, par delà deltas et collines, armée d'un sécateur, je taille les ressauts des arbres à lierre aux clôtures de mon jardin, et j'ôte du sol les longues griffes étouffantes: j'ai les mains noires de courbatures.
Pendant tout le temps que tombent les petits pentagrammes vernissés du lierre, pendant que je libère les herbes et les violettes de son étreinte, je songe aux attachements et au vide, puissant et libératoire - ainsi le disent, croit-on, les Chinois. Je regarde la jatte lisse où les chats mettent à tremper pour leur boisson des feuilles vertes de rosier. Par le ciel et l'eau, que soit la paix... mais c'est chez le voisin, familier et lointain, que pousse l'olivier...
Le soir venu, quand derrière la buée verte des feuillages, j'allume les lampes, je sors de sa boite ancienne le jeu de cartes qui dort entre l'as et le dix de coeur. Les cartons glissent les uns sur les autres, tombent en grains serrés, se rebattent, ramènent Pallas, Hector et la cruelle Penthésilée... Nous avons passé convention, les cartes et moi: Je leur demande des nouvelles de lui... En fait, elles glissent, se battent, reglissent tant, que je ne parle de personne, que du hasard et de la durée, eux que je ne maîtrise pas... Et le hasard et le temps s'usent, se polissent, à ce komboloï occidental... et moi aussi mes doigts se fatiguent, je me lasse, je me détache, le jeu de cartes se referme, la nuit tombe, et le silence vient sur mon esprit blessé et inquiet.
Signe
Nous sommes gens d'un nouveau siècle... Plus d'un est fier de son dernier engin ménager. Plus que jamais cependant, le frère trahit le frère et l'homme vit traqué jusqu'à ce que ses entrailles fument au grand soleil; on affûte le métal des aiguilles, des compteurs mesurent, les affaires optiques se sont perfectionnées, un raz-de-marée de brimborions bon marché submerge les magasins et toutes sortes de guerres ouvertes ou secrètes, font rage.
Que dire à de jeunes visages qui en sont tout juste à épeler le monde?
Et cependant dans le ciel, passent les nuages, aussi divers, aussi nombreux que les humains, incessants, jamais entièrement déroulés, certains isolés, innombrables, multiples.
Et cependant sur la mer la vague chasse la vague, crête après crête, et dans le bois de pins sur la colline frémissent toutes les aiguilles. Chaque chose suit son destin. L'humanité ses carnages, l'eau son chemin de ronde sur le globe, les arbres leur fredon dans le vent.
Nous passerons, ceux que j'ai aimés et moi-même. Notre vie n'est pas celle que j'avais rêvée... Nous avons fait ce que nous avons pu. D'autres peut-être seront plus libres et plus heureux. J'en doute...Certains, peut-être, à travers les coupantes mailles d'acier de ce qu'on appelle leur civilisation.
De là où j'en suis cependant, sur ce versant sombre et tourmenté, je lève une main qu'ils n'ont que peu de chance d'apercevoir, et dans le lent moutonnement des exécutés, des persécutés, des fous, de ceux qui ont tenté de résister, des rêveurs, des poètes, je leur souhaite bonne route.
D'une vie l'autre
Un voile sapide enveloppait le ciel. Il faisait froid. Tu lisais dans le cercle vert d'une lampe. C'était dans la salle Labrouste de l'ancienne bibliothèque. Autour du silence le cocon doux et animé de la ville, la chaleur et au-dehors les vitres embuées des cafés. Ces manuscrits-là étaient déjà loin de ta vie - Déjà pressée de chercher on ne sait quoi ailleurs…
Tu verras les écureuils gris de Central Park.
Tu chercheras des médicaments dans la tourmente de neige à Moscou.
Déjà ces multiples conversations te sont promesse. Tu voudrais tout retenir: l'écharpe désinvolte de celui-ci, les ongles carminés des belles causeuses, les diamants taillés en poire rue de la Paix, la minceur interminable d'une passante effilée, les touffes de chrysanthèmes jaunes sur les tombes du cimetière du Montparnasse où tu allais saluer tes pères spirituels et l'hôtel de la rue Delambre où tu te retrouvais toujours.
Dans le mouvement sans fin de la foule et des lumières tout ce que fait l'humanité te semblait quotidiennement possible et les fronts gris des palais se fronçaient. Les chevaux de pierre s'élançaient et le fleuve coulait. Il naissait un chef-d'oeuvre sous tous les pinceaux roux des artistes des quais.
Les pigeons emmenaient le jour dans leurs ailes et tu allais dormir dans la chambre où peut-être écrivit Breton.
Des années après le jour se lève dans le village où tu habites. L'amour a dédoré ses ailes d'ange au plafond. C'est un printemps humide tout imbibé de vert.
Tu te trouves sur la colline, près de la collégiale. Tu n'écris plus de chansons, tu t'enveloppes d'ombre.Tu te nourris et te fortifies d'obscurité.Tu es souterraine et jumelle à la nuit.
Le temps voyage comme une plume sur l'eau noire.
Tu as abandonné bien des choses et il te reste vivre.
RITOURNELLES
A la ronde des amants
A la ronde des amants
Le temps est doux-acide
C'est l'automne des feuilles
Dans la fontaine aux tritons.
A l'homme de l'Hellespont un plumet de soleil.
J'errais dans les hameaux perchés
Il bruissait, les forêts étaient à marée haute
Nous n'osions pas nous rencontrer
Nous le fîmes, ce n'était plus pareil
Et l'homme de l'Hellespont
Qui l'eût dit? ne savait pas parler.
Une palme de soleil pour sa barbe bouclée
Pour son corps médique et sa langue coupée
A la ronde des amants
Durer est sapide
La flèche est empennée
Le jour est si lucide
Pour qui a mal au temps.
Il y eut l'homme qui s'usait de se laver
Et qui allait, au gouvernail de sa montre
Construire et industrialiser.
C'était un petit homme
Qui aimait l'eau et l'amour
Et qui tenait le compte de ses grains de café.
Petit homme venu de la chaleur et du désert,
Quel bon amant ce fut!
Précis comme sa montre, tenace comme une saladelle
Quel dommage qu'il ne m'ait pas plu!
A la ronde des amants
Le jeu est bien rapide
Même s'il dure longtemps.
Le temps est trompeur
Nous eûmes tant de plaisir
Et du désagrément.
A l'homme de Normandie
Qui pleurait en riant
Un sainfoin de mélancolie
Car il fut laid et intelligent.
A l'antiquaire qui possédait
Dans les larmes et le sang
Toute ma guerre - et les blessures que j'infligeai.
Puis ce fut l'homme des passions
A l'âme comme un ciel d'orage
Nous eûmes des lits de blé sauvage
Et des arrêts de tragédie
A tordre le corps comme du linge mouillé.
Nous eûmes des attentes, des plages noires faisant le tour de la terre
Et des étés rouges d'incendie
Ardents d'aimer.
Amants, beaux amis
Dont la ronde n'est pas finie
Nous allons nos chemins de poussière.
Aux éclairs du désir
Nous avons si bien inventé
Nous avons si bien concilié
Ce qu'on appelle demain et hier
Nous avons si bien voyagé
En des barques de rêves
Sur le fleuve oubli.
16/05/1984
Elle
Occupée à ses tâches modestes
Patience, oh ma patiente,
Refaire l'ourlet d'une robe,
Essuyer la corniche d'un meuble,
Ecouter au-dehors l'averse de grésil
Veiller sur l'enfant, sur le chat,
Semer des graines de lupin
Pour l'été, pailler le camélia
Pour l'hiver, surveiller le peuple des plantes,
Peuple hasardeux et peuple éclatant,
Le mimosa a gelé mais les capucines claironnent dans le massif
Et débordent en flamboyant sur l'étang,
Oh, que tu en as lavé du linge dans l'eau glacée
Au temps de ta jeunesse.
La bouche d'eau faisait un torrent dans le déversoir
Et se hérissait en crinière de gel en janvier
Et nous courions dans les allées
Enfants -enfants aux joues rondes.
Au fil des ans, à tant laver et à tant coudre
Tu en as cousu des années
Jusqu'à être maintenant cette brindille de femme âgée
Qui s'en va chez le pharmacien dans la bourrasque
Fermement agrippée à son parapluie,
Cette femme au corps abîmé
Qui coud, inlassablement, au chevet de mes malheurs,
Point de feston et point de chaînette
Surfil et surjet, reprise fine, bouton recousu,
Cet hiver -là tu reprisais mon manteau qui en avait besoin
Et le jour était cette même lame blanche
A goût de désespoir...
Je me répétais les mots de la femme Narses et du mendiant
La lumière était ce livre déchiré
Et toi, inlassable, tu cousais les jours,
Lavant le linge aux armoires
Effeuillant le céleri, rendant compte du ciel et des saisons
Au tréfil du chas de ton aiguille
Qu'il devient doux, le temps.
Il devient un monde habitable
Les années se retournent sur elles-mêmes
Comme dorment les enfants
Ma mère, que tu as cousu longtemps.
13/01/1994
L' Etrangère
Le mélèze lisse ses bourgeons ronds
Qui s'y frotte, qui s'y colle?
Et de grands pans de montagne montent jusqu'au ciel
Faire leurs zigzags blancs au-dessus du chaos de pierres
Pierres cassées, pierres coupantes, pierres vertes, pierres sous une robe d'eau pâle
Pierres dures à grimper,
Couverts de neige descendant en coulées dans les lignes des sapins
Si haut, là-haut, le ciel.
Soleil sur les aiguilles brunes - se dégage une austère essence
A-t-il neigé jusqu'ici?
Non, c'est un semis de crocus blancs s'ouvrant au ras de la terre
Et là le coeur tigré de la pensée jaune
Là la trompe bleu profond de la gentiane
Silence.
Et puis là-haut, sur l'arête, on a rencontré le vent
S'époumone et siffle dans les branches
Nous nous plions pour nous reposer dans les racines des arbres
La neige étincelle
Dans les espaces secs, les fourmilières s'activent...
Privilégieras-tu la pierre
Le chamois au versant d'une pente tournant sa tête fine
Le ruisseau qui va sans fin à grand bruit d'un tronc creux
L'oiseau tête noire
Le minuscule scarabée
Les humains que nous sommes?
Chacun marmonne ce qu'il sait de son histoire
A travers le prisme immense
Je serre ma veste contre moi et je pense
Vie, infinité et multitude, comme tu es l'Etrangère...
Voix
Du passé noir
Que d'être obscur
Des branches et ramures
Au vent
Des bruissements, craquements
Au fil des bois
Du passé noir
Du froid
De l'haleine en allée
Des bêtes de la forêt,
Molles vapeurs montant dans l'épais du versant
Hésitant
Et bouclant; puis rebouclant; à effets lents
De l'air de nuit
Heurté aux cailloux du grand chemin
-Qu'entend-on sinon le hibou?
Monte une voix.
C'est une vieille voix qui tremble
Mêlée à l'odeur du chaudron
Où cuisent les pommes de terre
C'est une vieille voix
Qui tisse ce que savent les siens
La dureté du temps
Les capacités et les saisons
La santée avec deux "e"
Et le grésil ce matin,
Septembre qui suit l'août-tournesol
Et le malheur et la pitié
Il y aura de la semoule au goûter
D'où vient ce glas au clocher?
Que la paix soit aux trépassés
Et au vivant
-Entre eux, mince pelure.
Qu'il fasse nuit
Qu'il fasse froid
Tricote aux aiguilles
Les pans de brouillard
Où coucher toutes les fougères de la forêt
L'aiguail c'est la rougie.
Qu'elle retisse,
La vieille voix.
Complainte de la travailleuse
Je laisserais bien tout tomber
Les heures balisées des journées
Le temps aménagé
La roue inexorable des travaux
Oh tous les impôts
Les petites têtes de plomb de Nidussandec
Et toutes celles qui balisent l'avenue Nedelec
Les chers vieux amis
O inexorable ennui...
Je laisserais bien tout tomber
Les sentiments domestiqués
Le prix de l'électricité
Les réactions qui vont en rond
Et dans ma supérette le thon
Et dans ma supérette les commissions
A l'heure où j'ai fini le travail
Et où je traîne, humble piétaille
Ma fatigue d'écrazibouillée.
Oh oui je laisserais bien tout tomber
Plutôt que de compter les années
Qui me séparent de la liberté
Que c'en sera peut-être fini pour ta pomme
Rideau sur la bête de somme
Avec l'enterrement qui convient
Toute seule dans son petit lopin
Loué pour cent ans grand maximum
Il en tombe et il en pleut des hommes
morts, comme brindilles dans le bois
Et il en naît plus encore ma foi...
Dans cette universelle logorrhée
Je laisserais bien tout tomber
Je dirais à la soeur, au mari, au bof
Je ne vais plus à la foire à Saint Christophe
Je vous laisse toute ma panoplie
Le grand carcan des heures vannées
Et cet énorme boulet de mes années
Je fais ma valise, je pars au Chili
A moins que ce soit à Helsinki
Je passerai peut-être par Issoire
Mais je n'y resterai pas plus d'un soir
Je m'en vais, c'est le grand au-revoir
Vous fêterez sans moi la Saint Grégoire
Salut les gens et les bestiaux
Retournez sans moi à vos travaux
A qui rit le dimanche
Pleure toute la semaine dans ses manches
J' pars regarder les baleines
Et chercher des endroits ousque les gens ont de la veine...
Ils disent rien, ils sont gênés
Les amis, les maris et les têtes de buis
Ils replient leurs bras sur leurs nez
Tout ça sera vite oublié,
Et à nous la liberté.
PANDRAGON
Dehors le monde bouge, les fumigènes crépitent, les trains stoppent, la foule coule le long des rues, enfant, il est temps de relire le Talon de fer,
Lis les pages écrites à la sueur et au sang du peuple. Il y en a tant...Le monde bouge, les feux s'allument, les huées montent, on sourit fin dans les immeubles de luxe,
Vois les ruisseaux noirs de la misère et tous ses avatars.
C'est le temps que j'ai dû m'aliter, je devais soigner mes reins. Il n'y a personne dans la maison, que le chat fidèle. Quel silence!
Il y a eu les heures aux yeux ouverts et les heures aux yeux fermés.
J'ai laissé la maison ouverte pour l'infirmière.
Il y a eu d'éblouissants soleils remués de vent bondissant le jour entier dans le ciel puis sont venus les nuages et aujourd'hui il neige sur les roses d'hiver restées au jardin.
La neige est descendue en oblique dans les branches de l'acacia. Je ne sais si elle durera... Je reste longtemps immobile, je me remémore et me récite des temps de ma vie, des villages et des villes, des intérieurs différents, et toutes sortes de choses, les chapeaux de ma grand-mère paternelle, le pied de mauve du Pré-aux-chevaux en été, cette photo d'août prise sur les Champs-Elysées dans une robe d'étamine à motifs bleus et orange, j'avançai la main contre mon front, un geste beau et timide, et Paris comme un gigantesque cabinet de curiosités, rosace aux trente printemps, quelle lumière!...
Elle glisse sous mes yeux aujourd'hui, du soleil à la neige.
On peut penser que je suis là une personne bien inutile, C'est certainement vrai, mais je n'y puis rien. Je salue cet effet malencontreux de la douleur comme un privilège.
C'est comme si on m'avait redonné dans ma vie bourdonnante tout le quai dei Schiavoni, et le vieux pont doré sur l'Arno, et ceux de l'hiver sur les voies d'eau de Venise, et surtout le grand parquet du Trocadéro, et ces vastes avenues qui s'en vont chez Chirico pour y flâner le pas tranquille, réfléchissant et rêvant.
Je m'accommode de ce silence immobile, Le temps passe. Les feuilles de tilleul que nous avions cueillies ce début d'été au bord du Rhône infusent.
C'est toute la vie qui macère.
A dix-huit heures trente, l'infirmière reviendra. Avec elle, un air froid des chemins.
Son fils travaille au sud dans la zone portuaire
- Les brillantes rivières de lumières ceignant la baie de colliers doubles et triples avec, à l'arrière, perçant vaguement l'obscurité, les falaises blanches au-dessus des collines, que de fois je les aurais longées sur la route familière,
Me disant "Et voici la mer! La mer!" Là-bas, la nuit se précipitait.
Le matériel de l'infirmière fait de petits cliquetis précis,
Quand elle réapparaît, c'est aussi le temps qui revient.
Revoici les efforts, le travail quotidien et son rythme continu, l'émaillage des préoccupations, et derrière, aux franges, les convulsions du monde, le brasier dans la gueule du dragon, le chevauchement des formes, les cris, et dans l'espace inconnu, demain, aux improbables décours.
Destruction
La nuit est tombée depuis longtemps, les lampes sont éteintes. Là-bas, le disque continuait à tourner. Et puis, les bruits se sont rassemblés en une couronne qui s'éloignait. Quelqu'un était allongé près de moi. Vague forme masculine. Christophe? Jean-Christophe? La nuit avait bu le prénom et toutes les marques. Il y a eu un sursaut, une déchirure. Mais oui, voyons, Jean-Paul et les jours qui lui sont liés, un visage... Quelque chose a fait machine arrière.
Et pourtant j'ai pu voir, nuit, comme tu étais en train de boire, en train d'effacer vertigineusement autour de moi les présences et les récits de ma vie. J'allais m'engouffrer dans une obscurité qui, en quelques secondes, avait digéré toute ma mémoire.
J'avais appréhendé la décrépitude comme dénervement, ramollissement, envahissement d'humeurs, ou bien comme explosion de la chair, devenue comme du verre, ou bien comme pourrissement des moelles, ou bien comme rigidification des muscles... Cette manière-là est toute nouvelle et de caractère décisif...
Dans mon pays natal, autrefois, les paysans qui allaient sur les chemins, les villageois qui hélaient en passant le seuil des portes, les parents de multiples et lointains cousinages que l'on croisait sur la place aux sorties d'office, avant de conter leur affaire s'interpellaient: "Frère!" "Soeur!"
Si les choses basculent si vite dans la mort, frère, soeur, laissons-nous à Dieu. C'est simplement d'un bon pas qu'il faudra avancer.
Là-bas il y a une maison. Longère au toit gris aux fenêtres closes. Une maison un peu maudite puisque c'est ma maison
Une maison seule
dont l'intérieur n'est qu'une ruine...
Les brumes passent sur son toit, les pluies et aussi les soleils, soleils froids et nuancés du vieux pays.
Quel sens a une maison qu'on ne peut habiter?
C'est une drôle de maison qui n'a de sens que pour moi. Elle abrite dans ses murs noirs mon enfance pâle et sage - Fantôme de la petite fille qui marchait sur les chemins- Elle abrite nos retrouvailles par delà l'horizon de la mort. Elle abrite quelques araignées, peut-être quelque souris agile.
C'est une maison qui se tait.
La fougère et la vigne vierge lui sont voisines.
Elle va dans le courant invisible des rêves.
Nudité
Maintenant que je n'ai quasi plus rien que mes mots
Alors j'ai tout le temps
Et je voyage avec les survivants
Avec ce qu'il y a
Comme c'est
Seulement
Seulement...
Que faites-vous?
Parfois des spectres sombres courent sur mes nuits
Et je les entends, ceux que l'histoire a calcinés
Par millions ils crient et leur cri n'est pourtant pas si fort que d'autres hommes aujourd'hui ne soient massacrés.
Et il passe dans mon esprit des ombres glacées
Et c'est une femme douce à la fontaine aux pleurs...
Pourtant dans le matin le peuplier ruisselle sa chanson
Sont aux arbres les premières cerises
Sur un ciel bleu comme lavé par les pluies
Que faites-vous? Et il faudra porter ces actes.
Tu vas dans la grande presse de ceux qui sont humiliés. Tellement qu'ils ne le savent pas. Toi tu le sais.
Tu as de grands yeux doux et sagaces. Et la volonté du guerrier. Etrange mélange.
Mes pensées t'accompagnent.
Que peuvent des pensées?
Que peuvent mes pensées dans l'activité et la fébrilité de tes jours?
Pourtant elles sont là, présentes, tenaces, aussi douces que sont durs les combats pour ceux qui vont dans le soleil des puissants.
Elles t'accompagnent, formant d'invisibles lacs.
Puisses-tu croire à la toute présence de ce qui ne semble pas
Et qui porte la vie.
EVELYNE ENCELOT, A PARTIR D'ÉCRIRE, ED. DE L'AMANDIER
ARTICLES SUR EVELYNE ENCELOT
Jean-Marie BARNAUD
Article sur le site <www.revue.net>
JOËLLE GARDES
Europe n° 936, avril 2007
Évelyne Encelot, À partir d’écrire, textes réunis pas Claude Ber, Jean Rubin et Frédérique Wolf-Michaux, Éditions de l’Amandier, Paris, 2006, 18 €
À partir d’écrire, rassemblé avec ferveur et publié par Claude Ber, Jean Rubin et Frédérique Wolf-Michaux, comprend des textes majoritairement écrits par Évelyne Encelot entre 1993 et sa mort, en 1998, après l’expérience de la « la traversée de la souffrance psychique », selon l’expression de Claude Ber. Ils sont divisés en quatre sections qui empruntent leur titre à des poèmes : « À partir d’écrire », fragments du journal, de la maladie à la guérison, toujours provisoire, qui décrit « l’énorme pas qui consiste à vouloir vivre — que l’on fait à partir d’écrire… », « Les Akènes de la nuit », qui témoigne de la lutte de « ceux dont le monde bascule sous le poids de la souffrance », « Ritournelles », où l’emploi de vers libres, parfois de refrains, rend la poésie, toujours grave, cependant plus légère, et enfin « Pandragon », dont l’inspiration n’est pas différente de celle des « Akènes », mais où l’urgence d’écrire et de vivre est rendue plus sensible pour le lecteur par le fait qu’il s’agit des derniers poèmes, rédigés de 1997 à 1998. Une profonde unité, cependant, confère au volume sa densité, l’intensité d’une douleur qui ressemble à celle de tant d’autres, Virginia Woolf par exemple, mais qui est cependant toujours unique, douleur devant l’échec, devant la culpabilité de ne pas avoir réussi à « faire les choses justes, accordées aux saisons, aux heures, aux gens », devant le constat qu’ « il n’y aura pas de répétition générale ». Et pourtant, il n’était pas possible de réussir à mieux vivre, tant le monde est « une membrane noire », tant la vie « est une cuisante énigme » : comment concilier sa splendeur, ses « pyramides de lys », son « tuyautage de tulipes » avec ses « lames, tranchoirs, hachoirs, pièges » ?
Tous ceux qui parlent « du fond de la détresse » ne sont pas poètes. Évelyne Encelot, parce qu’elle ne manie pas le vers régulier et la rime se refusait parfois ce titre : « Je ne suis pas poète… / Mes mots sont fragiles, hissés à grand-peine de la douleur ». Pourtant, poète, elle l’est bel et bien. Par l’attention à ce que V. Woolf appelait « instants de vie », la « lumière de bonheur » du Sud, la vigne, la couleuvre, les pins et les mimosas, et les « giroflées à l’odeur de pain d’épices », les petits pommiers et poiriers du pays de l’enfance et le Pré-aux-chevaux, la Fontaine des Bellandrons dont le chemin ne s’est jamais effacé de la mémoire. Par la formule fulgurante qui sait si bien résumer l’immensité d’un sentiment (« Impression par moments de marcher dans une plaie ouverte », ou encore, « Moi, comme interdite de vivre »).
C’est une poésie lyrique, qui a tantôt la forme du poème, tantôt celle de la prose, qui se déplie dans les recueils. On y entend une voix narrative qui cherche à retrouver, à reconstruire un moi éclaté, à rassembler une personnalité « déchirée et éparse ». Ce travail quotidien, sans cesse menacé, il a pour matériaux les mots, car « c’est de leur endroit que […] coule la vie ». Quand le monde et le moi sont miettes et lambeaux, l’écriture donne une continuité, tisse une toile comme Arachné. Cette voix raconte, cherche à donner forme à l’informe à travers le fil du temps dévidé de poème en poème. « Curriculum vitae » : ce titre d’un des textes de « Pandragon » aurait aussi pu servir de guide pour l’ensemble. L’écriture évoque des souvenirs pour avoir prise sur l’avancée des heures, pour arracher à l’inconsistance les années « perdues, envolées, gaspillées », pour retrouver la petite fille « douce ». Au loin dans le temps, il y a la maison de l’enfance, les villes habitées, les paysages regardés et traversés, les êtres aimés. Dorénavant, les chemins ne mènent plus nulle part, la « rumeur humaine » s’est tue, les mains sont vides. Dorénavant, le temps ne déroule plus ses aventures et ses rencontres, dans l’incertitude d’un demain menaçant, il est devenu attente de la mort, à laquelle l’écriture essaie de voler des éclats de vie.
Revue ICI ET LÀ n°6, mars 2007,
Revue de la Maison de la Poésie de St Quentin en Yvelines
À partir d’écrire, Évelyne Encelot, textes réunis par Claude Ber, Jean Rubin et Frédérique Wolf-Michaux, éd. L’Amandier, 2006, 288 p., 18 €, www.editionsamandier.fr
Il s’agit d’un aperçu de l’œuvre d’Évelyne Encelot. La préface de Claude Ber, l’amie fidèle, est éclairante tant sur la personnalité de l’auteure que sur la démarche qui a présidé à ce choix. Décédée en 1998 à 50 ans, Évelyne Encelot voulait témoigner «de l’intérieur» de sa souffrance psychique même si (s)a vie ne se résume pas à (s)on histoire. Quand l’écriture (Je décide d’écrire tous les jours ; ça ne veut rien dire de plus. Simplement, si possible, m’aider à survivre) s’avère nécessaire pour dire la douleur, non par plainte, mais pour tenter de la comprendre, de la cerner au plus près (Mon temps est mangé à l’horloge / Et la douleur a repris ses gants de plomb). La première partie est un fragment de journal qui dit, avec acuité, la vie qui louvoie dans le noir, le regard des autres, le bonheur de la rémission, la vigilance de tous les instants. Suivent, en trois parties bien définies, le choix des textes, proses resserrées et poèmes en vers irréguliers (je ne suis pas poète… / Mes mots sont fragiles, hissés à grand-peine de la douleur), qui mêlent instants de vie (Je traînaille d’une pièce à l’autre / J’agite de menus projets / Je réponds par bribes (…)), réflexions, doutes (Je vais te dire : je n’y crois pas. Je n’habite pas mes contours. Je n’y suis pas, ça n’est pas moi ? Alors qui c’est ?), le monde du dehors (Ciel sombre, mer turquine, au milieu, une langue de roches et de sable) qui interpénètre celui du dedans (C’est l’équinoxe (…) / Elle apaise le bien, si enfiévré de son mélange au mal) qui sont autant de bouteilles à la mer. Un cheminement essentiel, douloureux et profondément touchant, sans apitoiement. J.F.
Claude BER
in Poésie 2001 Seghers- janvier 2001
EVELYNE ENCELOT
(1948-1998)
Les textes d'Evelyne Encelot jalonnent un parcours extrême; leur limpidité, leur volonté de transparence sont l'expression d'un cheminement hors des ténèbres de la souffrance psychique dans laquelle elle ne se laissa jamais enfermer et qui ne parvint jamais à la vaincre.
Par conscience de sa fragilité et plus encore par indifférence à toute forme de reconnaissance, Evelyne Encelot n'a pas souhaité, à quelques textes près, être publiée de son vivant, mais elle laisse à découvrir une oeuvre protéiforme qui vient d'un lieu à la fois proche et éloigné, où l'inachevé côtoie l'accomplissement, où la frontière entre les genres tantôt s'abolit, tantôt marque les faces opposées d'une psyché torturée telle que la découvre le journal et de la psyché reconquise du poème.
Ecrire et vivre sont là indissociables et le second dépend du premier sans que l'on puisse réduire l'écriture d'Evelyne Encelot au témoignage. Elle est, certes, la trace d'un parcours intérieur, et plus que la trace, comme le sous bassement même de ce parcours qui affleure, mais elle est surtout, dans son évidence et son dépouillement, le rappel de la trame de toute démarche créatrice en ce qu'elle est, au bout du bout, l'expression la plus profonde de notre humanité et avant tout un moyen de mieux vivre et simplement de vivre.
Lorsque l'intégrité du moi est menacée et que se vit l'angoisse du risque ne plus pouvoir se penser ni se reconnaître, la langue, l'écriture deviennent le lieu même où se jouent à la fois la possibilité d'être et celle de continuer à se percevoir et s'affirmer comme un sujet à part entière, un sujet non aliéné dont la langue recueille la conscience.
La quête de la plus grande clarté et de la simplicité ne se conçoit chez Evelyne Encelot que dans cette perspective d'un combat de l'esprit qui sent passer dans la matière même de sa chair "le vent de l'imbécillité". Elle savait les destins d'Artaud, de Nerval, d'Hölderlin, elle les savait par corps. Elle n'y a jamais sombré, de manière surprenante même au regard des assauts qu'elle subissait et cette résistance plonge au plus profond dans le rapport qu'elle entretenait avec l'écriture et avec la langue.
A qui contemple face à face les visages de l'obscur, de l'indicible, de la perte de la possibilité même de la parole, les vertiges rhétoriques offrent peu de séductions. Evelyne Encelot savait d'expérience cette menace qui plonge davantage dans l'enfer de la répétition que dans l'antre créateur de l'imaginaire que lui prête parfois une fascination toute littéraire croyant y voir le versant dionysiaque et obscur de chacun. Ce dernier est autre chose qui déborde, envahit, c'est le puits qui creuse toute parole, celle d'Evelyne Encelot comme tout autre, mais où existe encore la parole. Plus loin, encore plus loin, là où l'esprit se perd non pas en ses méandres mais en un lieu qui n'a pas de nom en sa langue car il n'a plus de langue, là sont la souffrance et le dénuement extrêmes peut-être plus redoutables encore que la mort parce qu'échappant à la mesure et au destin communs, sortant de ce "sens commun" dont même le non sens et les plus vertigineux délires de tous les sens supposent le partage.
C'est à partir de là, à partir du refus de cela, à partir de la victoire sur cela que se comprend toute l'écriture d'Evelyne Encelot quand par et dans la langue se disent la possibilité de soi, des autres et du monde. A partir de là se rouvre tout l'empan d'une parole sans cesse reconquise et qui émerge tantôt douloureuse, tantôt exultante, tantôt sereine et paisible, tantôt ludique et sensuelle, ici festive, là dénudée, parcourant l'espace de la langue qui est celui de l'identité et, indissociable d'elle, du rapport à l'altérité.
Et l'oeuvre - textes poétiques, nouvelles, journaux - s'impose dans sa diversité sous le triple signe de l'épreuve la plus âpre, d'un questionnement essentiel traversé d'accents mystiques et de cette légèreté du bonheur d'aimer et d'exister que connaissent ceux qui risquent à tout instant de le perdre, explorant le plaisir d'épeler le monde dans l'immédiateté de son spectacle au même titre que le dénuement de l'être et le creusement de la langue dans l'exigence de l'interroger comme de s'y interroger.
C'est un parcours, à terme, lumineux qui est donné à déchiffrer et c'est ainsi qu'Evelyne Encelot le concevait. Son écriture comme sa vie se placent consciemment, volontairement du côté de l'élucidation, de l'exigence éthique et du refus de toute forme de "diminution dans l'être" pour elle comme pour quiconque selon cette expression de Spinoza qu'elle affectionnait depuis la classe de khâgne où je l'ai rencontrée pour le première fois, du côté d'une verticalité plongeant dans les tréfonds autant que s'élevant dans l'affirmation de ce point étrange de soi-même qu'elle disait "nommer âme faute de mieux" et savoir d'expérience, demeurer intact. Elle se voulait sous le signe de son nom, Eve, qui signifie "vie" et dont elle revendiquait et revendique dans ses écrits l'héritage et le sens.
Article sur le site <www.revue.net>
JOËLLE GARDES
Europe n° 936, avril 2007
Évelyne Encelot, À partir d’écrire, textes réunis pas Claude Ber, Jean Rubin et Frédérique Wolf-Michaux, Éditions de l’Amandier, Paris, 2006, 18 €
À partir d’écrire, rassemblé avec ferveur et publié par Claude Ber, Jean Rubin et Frédérique Wolf-Michaux, comprend des textes majoritairement écrits par Évelyne Encelot entre 1993 et sa mort, en 1998, après l’expérience de la « la traversée de la souffrance psychique », selon l’expression de Claude Ber. Ils sont divisés en quatre sections qui empruntent leur titre à des poèmes : « À partir d’écrire », fragments du journal, de la maladie à la guérison, toujours provisoire, qui décrit « l’énorme pas qui consiste à vouloir vivre — que l’on fait à partir d’écrire… », « Les Akènes de la nuit », qui témoigne de la lutte de « ceux dont le monde bascule sous le poids de la souffrance », « Ritournelles », où l’emploi de vers libres, parfois de refrains, rend la poésie, toujours grave, cependant plus légère, et enfin « Pandragon », dont l’inspiration n’est pas différente de celle des « Akènes », mais où l’urgence d’écrire et de vivre est rendue plus sensible pour le lecteur par le fait qu’il s’agit des derniers poèmes, rédigés de 1997 à 1998. Une profonde unité, cependant, confère au volume sa densité, l’intensité d’une douleur qui ressemble à celle de tant d’autres, Virginia Woolf par exemple, mais qui est cependant toujours unique, douleur devant l’échec, devant la culpabilité de ne pas avoir réussi à « faire les choses justes, accordées aux saisons, aux heures, aux gens », devant le constat qu’ « il n’y aura pas de répétition générale ». Et pourtant, il n’était pas possible de réussir à mieux vivre, tant le monde est « une membrane noire », tant la vie « est une cuisante énigme » : comment concilier sa splendeur, ses « pyramides de lys », son « tuyautage de tulipes » avec ses « lames, tranchoirs, hachoirs, pièges » ?
Tous ceux qui parlent « du fond de la détresse » ne sont pas poètes. Évelyne Encelot, parce qu’elle ne manie pas le vers régulier et la rime se refusait parfois ce titre : « Je ne suis pas poète… / Mes mots sont fragiles, hissés à grand-peine de la douleur ». Pourtant, poète, elle l’est bel et bien. Par l’attention à ce que V. Woolf appelait « instants de vie », la « lumière de bonheur » du Sud, la vigne, la couleuvre, les pins et les mimosas, et les « giroflées à l’odeur de pain d’épices », les petits pommiers et poiriers du pays de l’enfance et le Pré-aux-chevaux, la Fontaine des Bellandrons dont le chemin ne s’est jamais effacé de la mémoire. Par la formule fulgurante qui sait si bien résumer l’immensité d’un sentiment (« Impression par moments de marcher dans une plaie ouverte », ou encore, « Moi, comme interdite de vivre »).
C’est une poésie lyrique, qui a tantôt la forme du poème, tantôt celle de la prose, qui se déplie dans les recueils. On y entend une voix narrative qui cherche à retrouver, à reconstruire un moi éclaté, à rassembler une personnalité « déchirée et éparse ». Ce travail quotidien, sans cesse menacé, il a pour matériaux les mots, car « c’est de leur endroit que […] coule la vie ». Quand le monde et le moi sont miettes et lambeaux, l’écriture donne une continuité, tisse une toile comme Arachné. Cette voix raconte, cherche à donner forme à l’informe à travers le fil du temps dévidé de poème en poème. « Curriculum vitae » : ce titre d’un des textes de « Pandragon » aurait aussi pu servir de guide pour l’ensemble. L’écriture évoque des souvenirs pour avoir prise sur l’avancée des heures, pour arracher à l’inconsistance les années « perdues, envolées, gaspillées », pour retrouver la petite fille « douce ». Au loin dans le temps, il y a la maison de l’enfance, les villes habitées, les paysages regardés et traversés, les êtres aimés. Dorénavant, les chemins ne mènent plus nulle part, la « rumeur humaine » s’est tue, les mains sont vides. Dorénavant, le temps ne déroule plus ses aventures et ses rencontres, dans l’incertitude d’un demain menaçant, il est devenu attente de la mort, à laquelle l’écriture essaie de voler des éclats de vie.
Revue ICI ET LÀ n°6, mars 2007,
Revue de la Maison de la Poésie de St Quentin en Yvelines
À partir d’écrire, Évelyne Encelot, textes réunis par Claude Ber, Jean Rubin et Frédérique Wolf-Michaux, éd. L’Amandier, 2006, 288 p., 18 €, www.editionsamandier.fr
Il s’agit d’un aperçu de l’œuvre d’Évelyne Encelot. La préface de Claude Ber, l’amie fidèle, est éclairante tant sur la personnalité de l’auteure que sur la démarche qui a présidé à ce choix. Décédée en 1998 à 50 ans, Évelyne Encelot voulait témoigner «de l’intérieur» de sa souffrance psychique même si (s)a vie ne se résume pas à (s)on histoire. Quand l’écriture (Je décide d’écrire tous les jours ; ça ne veut rien dire de plus. Simplement, si possible, m’aider à survivre) s’avère nécessaire pour dire la douleur, non par plainte, mais pour tenter de la comprendre, de la cerner au plus près (Mon temps est mangé à l’horloge / Et la douleur a repris ses gants de plomb). La première partie est un fragment de journal qui dit, avec acuité, la vie qui louvoie dans le noir, le regard des autres, le bonheur de la rémission, la vigilance de tous les instants. Suivent, en trois parties bien définies, le choix des textes, proses resserrées et poèmes en vers irréguliers (je ne suis pas poète… / Mes mots sont fragiles, hissés à grand-peine de la douleur), qui mêlent instants de vie (Je traînaille d’une pièce à l’autre / J’agite de menus projets / Je réponds par bribes (…)), réflexions, doutes (Je vais te dire : je n’y crois pas. Je n’habite pas mes contours. Je n’y suis pas, ça n’est pas moi ? Alors qui c’est ?), le monde du dehors (Ciel sombre, mer turquine, au milieu, une langue de roches et de sable) qui interpénètre celui du dedans (C’est l’équinoxe (…) / Elle apaise le bien, si enfiévré de son mélange au mal) qui sont autant de bouteilles à la mer. Un cheminement essentiel, douloureux et profondément touchant, sans apitoiement. J.F.
Claude BER
in Poésie 2001 Seghers- janvier 2001
EVELYNE ENCELOT
(1948-1998)
Les textes d'Evelyne Encelot jalonnent un parcours extrême; leur limpidité, leur volonté de transparence sont l'expression d'un cheminement hors des ténèbres de la souffrance psychique dans laquelle elle ne se laissa jamais enfermer et qui ne parvint jamais à la vaincre.
Par conscience de sa fragilité et plus encore par indifférence à toute forme de reconnaissance, Evelyne Encelot n'a pas souhaité, à quelques textes près, être publiée de son vivant, mais elle laisse à découvrir une oeuvre protéiforme qui vient d'un lieu à la fois proche et éloigné, où l'inachevé côtoie l'accomplissement, où la frontière entre les genres tantôt s'abolit, tantôt marque les faces opposées d'une psyché torturée telle que la découvre le journal et de la psyché reconquise du poème.
Ecrire et vivre sont là indissociables et le second dépend du premier sans que l'on puisse réduire l'écriture d'Evelyne Encelot au témoignage. Elle est, certes, la trace d'un parcours intérieur, et plus que la trace, comme le sous bassement même de ce parcours qui affleure, mais elle est surtout, dans son évidence et son dépouillement, le rappel de la trame de toute démarche créatrice en ce qu'elle est, au bout du bout, l'expression la plus profonde de notre humanité et avant tout un moyen de mieux vivre et simplement de vivre.
Lorsque l'intégrité du moi est menacée et que se vit l'angoisse du risque ne plus pouvoir se penser ni se reconnaître, la langue, l'écriture deviennent le lieu même où se jouent à la fois la possibilité d'être et celle de continuer à se percevoir et s'affirmer comme un sujet à part entière, un sujet non aliéné dont la langue recueille la conscience.
La quête de la plus grande clarté et de la simplicité ne se conçoit chez Evelyne Encelot que dans cette perspective d'un combat de l'esprit qui sent passer dans la matière même de sa chair "le vent de l'imbécillité". Elle savait les destins d'Artaud, de Nerval, d'Hölderlin, elle les savait par corps. Elle n'y a jamais sombré, de manière surprenante même au regard des assauts qu'elle subissait et cette résistance plonge au plus profond dans le rapport qu'elle entretenait avec l'écriture et avec la langue.
A qui contemple face à face les visages de l'obscur, de l'indicible, de la perte de la possibilité même de la parole, les vertiges rhétoriques offrent peu de séductions. Evelyne Encelot savait d'expérience cette menace qui plonge davantage dans l'enfer de la répétition que dans l'antre créateur de l'imaginaire que lui prête parfois une fascination toute littéraire croyant y voir le versant dionysiaque et obscur de chacun. Ce dernier est autre chose qui déborde, envahit, c'est le puits qui creuse toute parole, celle d'Evelyne Encelot comme tout autre, mais où existe encore la parole. Plus loin, encore plus loin, là où l'esprit se perd non pas en ses méandres mais en un lieu qui n'a pas de nom en sa langue car il n'a plus de langue, là sont la souffrance et le dénuement extrêmes peut-être plus redoutables encore que la mort parce qu'échappant à la mesure et au destin communs, sortant de ce "sens commun" dont même le non sens et les plus vertigineux délires de tous les sens supposent le partage.
C'est à partir de là, à partir du refus de cela, à partir de la victoire sur cela que se comprend toute l'écriture d'Evelyne Encelot quand par et dans la langue se disent la possibilité de soi, des autres et du monde. A partir de là se rouvre tout l'empan d'une parole sans cesse reconquise et qui émerge tantôt douloureuse, tantôt exultante, tantôt sereine et paisible, tantôt ludique et sensuelle, ici festive, là dénudée, parcourant l'espace de la langue qui est celui de l'identité et, indissociable d'elle, du rapport à l'altérité.
Et l'oeuvre - textes poétiques, nouvelles, journaux - s'impose dans sa diversité sous le triple signe de l'épreuve la plus âpre, d'un questionnement essentiel traversé d'accents mystiques et de cette légèreté du bonheur d'aimer et d'exister que connaissent ceux qui risquent à tout instant de le perdre, explorant le plaisir d'épeler le monde dans l'immédiateté de son spectacle au même titre que le dénuement de l'être et le creusement de la langue dans l'exigence de l'interroger comme de s'y interroger.
C'est un parcours, à terme, lumineux qui est donné à déchiffrer et c'est ainsi qu'Evelyne Encelot le concevait. Son écriture comme sa vie se placent consciemment, volontairement du côté de l'élucidation, de l'exigence éthique et du refus de toute forme de "diminution dans l'être" pour elle comme pour quiconque selon cette expression de Spinoza qu'elle affectionnait depuis la classe de khâgne où je l'ai rencontrée pour le première fois, du côté d'une verticalité plongeant dans les tréfonds autant que s'élevant dans l'affirmation de ce point étrange de soi-même qu'elle disait "nommer âme faute de mieux" et savoir d'expérience, demeurer intact. Elle se voulait sous le signe de son nom, Eve, qui signifie "vie" et dont elle revendiquait et revendique dans ses écrits l'héritage et le sens.